
Taguilalett
Le choc culturel
Situé à 20 km de la ville de Mederdra et à 30km de Rkiz-ville, Taguilalett, un puits connu comme étant le principal lieu de regroupement des Oulad Sid’Elvalli, tribu filiale de Oulad Deymane.
Taguilalett, un point d’eau traditionnel, dont le puits a été renforcé depuis lors en béton armé. Un premier puits bétonné au milieu des années 50, séparé de l’autre par à peine une dizaine de mètres, fut vite abandonné après son achèvement. On avait constaté que son eau était salée. Le chef de l’équipe du forage, feu Ahmed Ould Memadi, laissera sur la margelle un souvenir exceptionnel: la calligraphie de son nom en entier ainsi que la date du forage, en lettres arabes, faits par des mains d’un calligraphe de talent.
Un calligraphe de talent
Les élèves de l’école moderne, ainsi que ceux des Mahedhras, ne cessent de s’y rendre pour contempler cette admirable prouesse calligraphique, véritable défi à l’adresse des lettrés d’une communauté maraboutique enracinée dans la tradition culturelle dans la zone d’Iguidi. Ici, on a l’habitude de s’adonner à une permanente compétition en matière d’écriture arabe. Le pittoresque sable mouvant des dunes sert souvent de tableau privilégié pour un tel exercice. Le petit doigt d’un enfant, à la place du pinceau, y a laisse souvent des miracles en lettres arabes
Sur ce plan, il faut reconnaître que personnellement je suis resté des plus nuls en matière d’écriture, aussi bien en arabe qu’en français. À ce niveau, je me rendrai compte plus tard, que mon handicap est plutôt héréditaire. Comme mes frères paternels, je me débrouille généralement bien dans presque toutes les matières(le dessin compris) sauf l’écriture.
Dans notre classe, après Elmouvid Ould Elhassène, en première année, plusieurs autres enseignants francisants se sont succédé. Parmi eux Mohamdi Ould Beddi, Mohemd Elhafedh Ould Ahmed Miské, le frère du célèbre politicien Ahmed Baba et Omar Ould Ssemane. Certains ont été mutés en pleine année scolaire. Les livres scolaires étaient exclusivement étrangers. Le syllabaire, Mamadou et Bineta, conçu pour décrire une réalité africaine, dans une logique coloniale subtile, demeure étranger à notre contexte culturel. Toto, Tata, Séni, Mamadou, Fofana, Fatou, Bineta et autres noms, sont caractéristiques du milieu négro-africain. Le milieu de la forêt et des marigots, bien qu’il me soit familier, était absolument inconnu des enfants de Taguilalett et de Mederdra.
Jusqu’à la fin des années 50, les Oulad Sid’Elvalli nomadisent dans un espace plus étendu. La décision de la création d’une école moderne fut à l’origine de leur fixation à Taguilalett, tranchant ainsi une polémique qui les a opposés sur le choix du lieu d’ouverture de l’école. Des habitants résidant à Baghasse, un point d’eau appartenant à la même collectivité, situé plus au nord, préféraient celui-ci. La première classe sera ouverte en 1956 à Baghass avant son transfert à Taguilalett. Ses élèves seront en 4e année(CE2) en octobre 1959, lors de mon arrivée à Taguilalett pour débuter mon CP1 ou cours préparatoire première année. Les premiers scolarisés de la tribu avaient fait l’école ailleurs, notamment à Boutilimitt et Mederdra.
Mon jeune âge aidant, je ne pris pas beaucoup de temps à m’adapter au nouveau milieu. Mon transfert chez Ehel Ahmeyada et les retrouvailles avec leur fils, Ould Oumer Ould Beybatt, mon ami d’enfance, va accélérer mon intégration. Dans cette famille je n’arrive pas à oublier la solidarité indéfectible de feue Touvla Mint Elmamehmed, la demi-sœur maternelle d’Ould Oumer. L’honneur revient à son cousin, Elmoctar Ould Elmamehmed, qui m’apprendra à réciter les premiers vingt chiffres en français, au cours d’une partie de thé dans la première semaine de mon arrivée à Taguilalett. Un mois après, les parents m’envoyèrent une vache laitière pour aider la famille qui m’hébergeait. La tradition est courante dans les Mahedhras. Là, on l’adaptera à l’école moderne.
Les petits salariés
Afin de juguler l’opposition des autochtones à l’école française, les autorités coloniales accordèrent une bourse mensuelle de 700F CFA, soit 70UM à l’époque, à chaque élève. Avec deux bourses, pour deux élèves, une famille rurale moyenne réussissait à vivre relativement bien. « Lekhlass » ou le salaire, était attendu avec impatience. L’agent spécial, le gros Lampsar, à bord de sa petite 2CV, était attendu chaque fin de mois pour nous distribuer les précieux papiers.
On contractait des dettes, entre nous ou chez le commerçant qu’on réglait à l’arrivée de lekhlass. Des jeunes, du groupe d’âge d’Oulad Ekhliva, commerçants au Sénégal, ont ouvert une boutique commune, dans une maison non loin de l’école. Avec leurs prix exorbitants, je me suis toujours demandé pourquoi leur commerce n’avait pas réussi. À titre d’exemple je me rappelle qu’ils nous vendaient des articles de pacotille à des prix inimaginables: une culotte, qui se déchire au niveau de la partie sensible au moindre mouvement à 100F, un fragile ballon ou une bague en caoutchouc à 150F.
Je me suis très vite lié aux jeunes de mon âge qui constituaient la majorité de mes collègues de la première année. J’ai surtout renoué avec la plupart des jeux connus chez moi. Seulement, ici, l’essentiel du temps était consacré à un jeu moderne, nouveau pour moi, le football.
Nos ballons étaient fragiles. Fabriqués à l’aide d’une mince pellicule en caoutchouc, ils crèvent au moindre contact d’une épine. D’après les amis, au football, je me distinguais par mon non-respect des règles du jeu. C’est pourquoi ils m’appelaient « Tayar » ou l’avion. Je ne comprends pas le rapport. L’avion a tout intérêt à respecter scrupuleusement les règles du vol.
À l’école nous jouissons de plusieurs heures par semaine réservées à l’éducation physique. Des moments sont consacrés à la lutte traditionnelle, « Rredhkh ou Attay-ouz». Une fois, le maître m’ordonna une confrontation de Attay-ouz contre Moctar Ould Hamnène, un jeune venant d’Aznavir, la collectivité, voisine de la nôtre. Ce dernier, malgré son âge, était relativement obèse, une sorte de « Bob », dans les récits anglais. « Ho ! Je ne peux rien contre cette Beriga ! », m’exclamai-je. « Beriga » veut dire barrique. Je le terrassai au premier contact. Tous rigolèrent. Depuis lors on lui colla le surnom de Beriga au pauvre petit Moctar. Il avait de sérieux problèmes à suivre les cours. Mais je crains fort que ce sobriquet, peu élogieux, avait contribué à son départ précoce de l’école. Les sobriquets collaient généralement aux individus qui ne se distinguaient pas par des noms particuliers et rares.
Quelques difficultés d’intégration
Si j’ai bonne mémoire, mon intégration au nouveau milieu a rencontré peu de rejet. J’étais surtout lié aux enfants dont les familles avaient fait un séjour chez nous, ou dont les parents vivent encore parmi nous, notamment Ould Oumer, Benamar et Kneine. Tous les élèves, même ceux de la classe supérieure, cherchaient à lier amitié avec moi. Je me souviens de quelques petites frictions de temps en temps. Je sais que ce sont des choses de routine qui pouvaient se passer, même entre frères germains, mais qui peuvent être chargées d’une signification particulière dans mon cas spécifique.
Quelques fois certains se permettent de me viser en particulier pour faire des commissions. À chaque fois je tenais à n’exécuter que les commissions à égalité avec les autres amis. On peut dire que mon combat pour l’égalité a commencé à partir de ce modeste niveau. Les frictions entre enfants sont fréquentes, mais rarement méchantes. Tant qu’il n’y a pas de susceptibilité, ça peut passer inaperçu. Je connus le plus violent incident contre mon ami Yeslem Ould Ebnou Abdem. C’était en deuxième année lorsque son frère Ebnou était déjà directeur de l’école de Taguilalett, Yeslem, qui est d’habitude de caractère pacifique, m’avait brutalisé une fois. Sans attendre je lui assénai une gifle sur le visage. Le sang coula aussitôt de sa bouche et de ses narines.
Il se mit à pleurer avant de regagner le domicile de ses parents. Leur maison se situait à quelques mètres de l’école. Deux à trois ou quatre maisons en dur, au toit en zinc, appartenant généralement à quelques fonctionnaires avaient vu le jour en l’espace d’une année. La première construite était celle d’Ebnou, le directeur de l’école à partir de la deuxième année et la seconde celle de son beau-frère Ahmed O Bàa.
Début d’urbanisation
Le campement était juché sur la dune Est du puits de Taguilalett, lorsqu’on remarqua un objet qui scintillait sous les rayons du soleil de l’après-midi non loin du puits, au creux du Gowd. On cria aussitôt qu’une maison venait d’être construite. On se précipita vers le lieu pour voir ce que la plupart d’entre nous n’avaient jamais eu la chance de voir: une maison ! Personnellement je garde une vague image des maisons en dur vues à Podor. Arrivés sur le lieu, on découvrit des piles de zincs appuyées sur des troncs d’arbres. Ce fut la déception. La maison d’Ahmed OuldBàa abritait désormais les deux classes de l’école.
Souvent les familles voisines demandaient au directeur de l’école les services d’un enfant. Le lendemain Ebnou m’appela et me demanda d’aller chez lui pour effectuer une commission à sa maman, la sage et respectable Aïcha. Arrivé chez elle, elle me surprit par une attitude, qui fut loin d’être sage. « Ould Elbou ! » ou « Ould Boushab ! », Je ne me rappelle pas exactement lequel des deux elle prononça, peut être les deux: « il ne faut plus frapper Yeslem ! » lâcha-t-elle sur un ton menaçant. Je lui répliquai calmement: « S’il me frappe je le frapperai ». Elle répéta à plusieurs reprises ses propos. Je fis la même chose. Peu après elle se ressaisit, se calma et me demanda de partir. Sa sagesse aura prévalu. Probablement elle prit en considération, entre autres, son intime amitié avec la grand’mère Mbarkaalina. Ici, Aïcha constitue sa principale cliente pour ses produits artisanaux. Une fois elle lui paya une natte 5.000F CFA, soit 1.000UM à l’époque ou le prix de plus d’une vingtaine de moutons.
Malgré mon jeune âge je n’avais pas bien apprécié que mon directeur d’école ne se chargeait pas lui-même de régler un incident entre deux de ses élèves. « Ould Elbou », « Ould Boushab », des références familiales, avec lesquelles, on m’interpelle souvent, des fois aimablement, mais souvent méchamment. Je me rappelle d’une fois où j’avais mal aux yeux. Une femme, chapelet en main, se précipita sur moi et me serra fortement le cou avec ses deux mains et tremblant de colère, elle vociféra: « Ould Boushab, Allah la chifte…! ». Elle implora Dieu de me priver de la vue parce que, disait-elle, je devançais leurs enfants dans les examens. Je n’ai pas souffert de son étreinte puisqu’elle fut rapide. Mais son effet psychologique demeurera en moi pendant longtemps.
Ce sera beaucoup plus tard que je réaliserai l’ampleur de la gravité de mon geste vis-à-vis de mon ami Yeslem. Non seulement je vais évaluer à sa juste dimension la position familiale centrale de Yeslem, mais aussi je vais faire le rapprochement entre mon geste sur le fils du chef de la tribu en 1961 à Taguilalett et celle du grand-père Bou sur le chef de la même tribu, Ahmed Bazeid, tout au début du 20e siècle.
Une année auparavant, en 1961, le même Ebnou s’était démené pour détourner, heureusement sans succès, de chez nous, la visite du président Mokhtar Ould Daddah. Il dévoilera plus tard et d’une façon plus ouverte, et certainement sans raison valable, son hostilité à notre collectivité. Il rata ainsi une occasion en or. Sa présence aux festivités organisées chez nous lui aurait permis d’apparaître comme son principal organisateur et d’empêcher ainsi un contact direct entre les parents et la délégation présidentielle.
Une grand’mère pas comme les autres
La grand-mère Mbarkaalina dit Kaaina, me rejoignit à Taguilalett au milieu de ma première année. Avec elle, on résidera chez différentes familles. Partout où on résidait, elle se mettait à fignoler son artisanat. Les commandes pleuvaient sur elle. Les gens recouraient aussi souvent à son « gzana » ou son exercice d’anticipation à partir d’un jeu de dessins sur une surface de sable. Habituellement cela se faisait à l’aide de cauris. Une fois on avait résidé chez MariemMintElkory dit Mmih. Une personnalité spirituelle de grande stature, connue pour sa sagesse et sa générosité. Son fils aîné était l’interprète Sid’AhmedOuldYaya, le premier enseignant de Mokhtar Ould Daddah au CP1 en 1929 à Boutilimitt.
Mmih me considérait comme son petit-fils parce qu’elle avait partagé avec le père Elmoctar le lait maternel de Sid’Ahmed. Je vivais avec ses neveux AbdellahiOuldKerim et Cheikh OuldSid’Ahmed, les deux plus jeunes que moi, ainsi que son parent, feu Elmoctar dit Nnani, un jeune, grand et un peu gauche, natif de chez nous, mais plus âgé que nous tous. Il avait l’habitude d’arracher de force à ses deux petits parents les succulentes dattes que Mmih nous offrait régulièrement. Mmih nous confia une fois, à lui et moi, une mission chez mes parents résidents au bord de la rive ouest du lac Rkiz. Malgré qu’il me devançait de quelques années, je me suis collé à lui sans éprouver la moindre fatigue. Nous fîmes Taguilalett-Dhahr-Ndir, soit 30 km, en moins de 3heures de temps. La Samoz, une marque de montre en vogue à l’époque, affichait 11 heures du matin dans le bras de feu Abdou OuldGueydiatt, le seul homme qu’on avait trouvé devant nous dans notre petit Nezla. Il n’a pas cru à notre exploit. Il ne savait pas qu’on avait couru presque toute la distance. On ralentissait notre course uniquement lors des montées des dunes.
(A suivre)



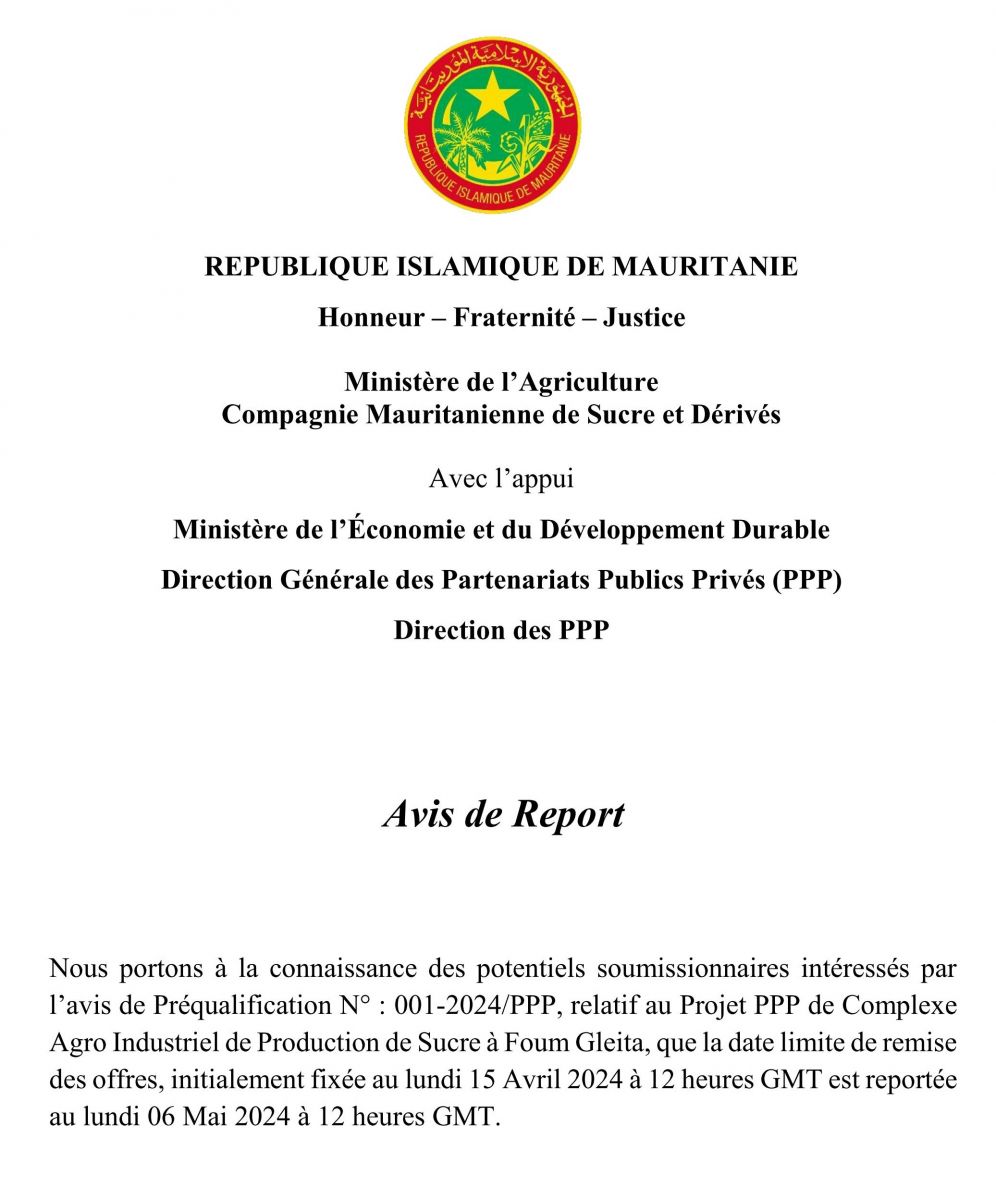









.gif)