
L’Administration me refusant la diffusion de mon rapport, tout mon rapport de mission, je réalisai qu’il ne servait à rien que je restasse au Journal, en journaliste à bouche cousue, la plume sans encre. Pour ne rien faire de bon, en fait. J’ai du coup compris ce qu’on voulait que je fusse, à savoir un griot de l’État, comme l’étaient et le sont encore aujourd’hui les journalistes mauritaniens, hormis une minorité courageuse et indépendante, qui s’est vaccinée contre la corruption et la peur de demain. Il se trouvait juste que le directeur de l’Office National du Cinéma(ONC) cherchait un collaborateur averti et expérimenté en matière d’audiovisuel. Une médiation entre nous s’établit et aboutit à mon détachement à l’ONC où je fus nommé chef de service d’importation et d’exploitation des films cinématographiques.
Ainsi l’exploitation de la Salle pilote de l’ONC relevait de mes compétences. L’ONC était en concurrence inégale et déloyale avec les exploitants des salles de cinéma privées. Il n’avait pas pu résister plus longtemps à cette impitoyable rivalité d’autant que l’État n’avait rien fait dans le sens du développement règlementé du septième art. L’entreprise, avec son personnel pléthore, trainant des arriérées de salaires, finit par être privatisée ou semi-privatisée. Et moi, de rejoindre de nouveau le Ministère de l’Information, lequel était alors rattaché au super Ministère de l’Intérieur, des postes et télécommunications, dont le Ministre était l’homme fort du régime à l’époque, j’ai nommé Djibril Ould Abdallah, plus connu Gabriel Semper.
Là au Ministère, je fus nommé au conseil des Ministres, chef de service de l’administration au sein de la direction de l’Audiovisuel, avant quelques mois plus tard d’être de nouveau nommé au conseil des Ministres, chef de service d’études, en cumul avec le secrétariat permanent de la commission nationale de censure des films cinématographiques, vidéocassettes, de la photographie, et des documents sonores. J’avais en face de moi une lourde responsabilité, en ce sens que, désormais, c’était moi qui validai les travaux de cette commission chargée du contrôler d’entrée et de sortie du pays, toute information audiovisuelle : l’exploitation des salles de cinéma, la diffusion de tout document sonore, les prises de vue et le tournage des films documentaires (par des nationaux, surtout par des étrangers) dans l’étendue du territoire national.
Bref, il fallait agir de sorte qu’aucune idée, idéologie, philosophie, culture, de nature à porter atteinte à la sécurité et la sureté du pays, ne s’infiltre, n’entre en Mauritanie. Ce rôle avait comme corollaire, l’attribution désormais d’un visa à toute diffusion sonore. C’était cette commission dont j’étais le secrétaire permanent qui était seule habilité de délivrer les visas de diffusion cinématographique, ou de tout support sonore ou visuel.
Cette commission était composée des secrétaires généraux des Ministères de l’intérieur, de l’orientation islamique, de l’information (fusionné avec celui de l’Intérieur), Un représentant de la direction de la sureté nationale, des directeurs des organes de presse, et du directeur de l’audiovisuel. La réunion était hebdomadaire. Et dès qu’elle s’installe, on me dit : « M. SY, fais nous un exposé bref sur tes décisions. Quels sont les films et vidéos cassettes retenus pour la diffusion ? On te fait confiance, si des têtes seront à couper, la tienne sera la première!" Me mettait en garde gentiment, mais fermement le représentant de la sureté nationale (je pourrais vous nommer toutes ces personnalités, mais à quoi bon de le faire ?) Ce qui signifie que c’était à moi de prendre la responsabilité de donner ou pas de visa à tous les films destinés à la diffusion dans les salles de cinéma. Parallèlement, je devais contrôler les maisons de vente ou de location des vidéocassettes, des librairies, des photographies. Une lourde responsabilité qui m’obligea de faire recours aux bénévoles pour m’aider à contrôler la diffusion des films dans les salles de cinéma. A cette fin, des cartes d’accès libres dans les salles de cinéma étaient mises à ma disposition par l’Autorité audiovisuelle (directeur). Je distribuais ces cartes à des amis de confiance qui m’avaient vraiment aidé dans ma mission du contrôle de la circulation des idées afin d'en extraire celles qui avaient comme but la subversion, l'intoxication ou la déstabilisation.
Ce travail impliquait que je visionnais tous les films avant la tenue de la réunion de la commission. Ainsi je veillais tous les jours, la moitié de la nuit, à visionner les films que me présentaient les exploitants des salles de cinéma. L’on peut imaginer quel effort j’avais fourni afin d’être imperméable à la corruption. Les exploitants importaient leurs films de l’étranger, du Sénégal le plus souvent. Imaginez quelle perte ils auraient subi si on leur refusait le visa de diffusion ! D’où j’étais très sollicité. Mais mon intégrité morale et mon sens de responsabilité étaient tels que je fus toujours imperméable à la corruption et c’était avec rigueur que je remplissais mon devoir de patriote et m’efforçais d’être à la hauteur de la confiance que la commission avait placée en moi. Avais-je d’ailleurs d'autres choix ? Je ne tenais pas à avoir la tête coupée ! J’avais l’opportunité d’être millionnaire, chose non facile à l’époque, où un million d’ouguiya équivalait à cinq(05) millions de Franc CFA. Mais comme depuis toujours, je privilégiais mon titre de bon musulman par rapport à tout. Évidemment, personne ne connait mieux que moi, combien il est difficile de résister contre la corruption. Surtout à l’époque, j’avais un salaire moins de VINGT MILLE OUGUIYA. Mais je ne me plaignais pas, car à côté de moi, je voyais des cadres (j’ignore comment ils l’étaient devenus. Certainement des hauts fonctionnaires non bacheliers qui ont fait des études de je ne sais où, et qui ont été nommés par la voie de magouille), dont les salaires étaient minables, moins que la charité.
Heureusement qu’à l’époque, c’était Monsieur Camara Saidou Boubou qui était directeur de la fonction publique. C’était un homme intègre, un fonctionnaire modèle qui ne blaguait pas avec des diplômes truqués, falsifiés. S’il eût été vivant aujourd’hui, avec la même fonction, il aurait systématiquement rejeté la pléthore de faux doctorats qui pullulent dans ce pays. Il n’était pas complaisant. Et ne se laissait jamais corrompre par qui que ce soit. Il était très légaliste, fidèlement. Est-ce pareil aujourd’hui, je n’en sais rien, j’en doute fort. A l’époque, quand un étudiant revint avec son doctorat, il lui demandait quand est ce qu’il avait obtenu son Bac. On sait bien qu’un doctorat authentique ne s’obtient pas avant au moins huit (08) ans post Bac.
J’étais très épanoui dans ce poste, puisque j’y étais très actif. Je ne m’ennuyais pas. Certes, je n’exerçais pas le métier du journalisme, si on se réfère à la définition d’un journaliste, mais je me sentais vivant et utile. L’emploi de mon temps n’était pas du temps perdu, fictif ! J’avais été très bien apprécié par toutes ces personnalités influentes qui m’avaient ouvert la porte vers le haut. Ils me vendaient partout, tellement ils étaient satisfaits de mon travail. D’autres horizons m’étaient ouverts ; petit à petit je sortais du tunnel. C’est alors que j’ai obtenu une pige au Journal Chaab, et obtenu un poste d’enseignant en tant que vacataire à l’Université, où je m’étais inscris pour une licence en sciences juridiques, avec l’appui de mon ami et collègue Mohamed Lémine Ould Dahi (ex- Directeur de Cabinet du Président) qui était alors le Doyen de l’Université. De plus, j’avais effectué deux missions à l’étranger, et plusieurs à l’intérieur du pays. Je devins populaire dans le milieu intellectuel qui avait découvert en moi des qualités, la modestie mise à part, rares. J’avais ouie dire que j'étais intègre, incorruptible, et cela me flattait, plutôt m'honorait à plus d'un titre. Dans n'importe quel milieu intellectuel, dans n'importe quel rassemblement d'individus d'initiés (ministres, ambassadeurs, directeurs, corps constitués...), quand on parlait de moi, les gens en réaction spontanée, disaient:"Wakhyert M. SY!". J’étais vraiment heureux dans ce poste ! J’étais déjà repéré par le pouvoir. Et peu après, une mission casse-tête chinois m’appela au Journal Chaab.
Une fois à la SMPI, Comment j'ai réussi à améliorer les "choses" au niveau du journal Chaab. Et même au niveau de la comptabilité.
Je rappelle que je n'étais pas tout à fait étranger à la SMPI lorsque j'y étais nommé le DGA en 1987. J'ai été, en une courte durée, rédacteur au Journal Chaab en 1980-1981, avant mon détachement à l'ONC. Je connaissais donc ce qui s'y passait: une pagaille inouïe, un sens dessus-dessous inacceptable, un désordre inexplicable. Un rayon d’espoir pour les lecteurs initiés, adeptes de l'information. D'autant qu'à l’époque, que je sache, un seul quotidien, et de surcroit, la voie du Régime, existait dans le pays. Aucune école pour le 4e pouvoir. Le 7e art se développant sauvagement. A l'époque, le nombre des journalistes sortant des écoles du Maroc, de l'Algérie et du Sénégal, principalement, se comptait au bout des doigts d'une seule main. Des reporters et des journaliers, plutôt des nouvellistes, ceux recrutés dans la rue, ou par le biais d'un chef de tribu "Khayma kbira" ou de "Galle mawdo", féodal, occupaient les médias embryonnaires. l
Aucune école du journalisme.
Le public souffrait de l'incompétence des informateurs inexpérimentés qui confondaient information et publicité, relations publiques et marketing, renseignement (au sens espionnage) et enseignement, éducation et formation, si bien qu'il était sous informé, ou intoxiqué, en dépit de son recours systématique aux médias internationaux qui, bien que plus ou moins crédibles, ne peuvent remplacer la presse nationale, et vous savez pourquoi. Celle plus proche de la réalité du pays, même si cette copie de la réalité n'était que le reflet des éloges de l’État dont les journalistes n'étaient que de fidèles griots. Je ne déforme pas les faits, j'étais là présent sous le poids du silence qui me pesait à mourir. Silence que j'ai souvent essayé de briser en vain, puisque je n'ai jamais pu aller jusqu'au bout de mes pensées, de peur d'être victime du pire que la simple mort. On était au temps de Maawiya entouré de ses conseillers corrompus, opportunistes, d'un extrême égoïsme, branchés de l’extérieur, dont on savait le boulot, bien connu de tout le monde, mais que personne n'osait indexer. Ils étaient les oreilles fidèles de Taya, l'homme bon auparavant (avant son accès au pouvoir de la dictature bureaucratique) transformé par son entourage opportuniste, âpre aux gains, et l'avidité du pouvoir absolu.
C’est pour cela que dès mon arrivée, tout frais, j'ai tenu à faire changer les choses, entreprise cependant quasiment impossible à l'époque où le tribalisme, le népotisme, le régionalisme, le clanisme, détenteurs du réel pouvoir, symboles de la réaction, et de la hiérarchisation de notre société, qui fabrique des nobles et des soumis injustement à l'esclavage, étaient à leur zénith en Mauritanie. J'ai convoqué une assemblée générale, réuni l'ensemble du personnel d’administration, d'imprimerie et du journal dans une salle bien aménagée à cette fin, au sein de l'établissement. Et j'ai ouvert mon discours (fleuve ce jour!) debout, par une frappe sur la table avec un air grave et sérieux, pour dire, d'abord aux journalistes que je n'admets plus des fautes grammaticales, d'orthographe ou/et de syntaxe dans les deux éditions arabe et française. Le quotidien était bourré de fautes, et d'incohérences inintelligibles, et cela faisait honte, et signifiait du coup un non respect inadmissible du public, des lecteurs: " Si vous ne pouvez pas écrire de longues phrases, correctes, bien construites, êtes incapables d'écrire comme vous parlez, c'est à dire simplement, sans tentation du pédantisme, sans fautes, alors faites de courtes phrases, simples, avec sujet, verbe et complément", avais-je recommandé aux journalistes.
Aux techniciens de l'imprimerie, ceux chargés de l'impression du quotidien, j'avais donné l'ordre de redoubler de vigilance afin de bien collaborer avec le service de la rédaction chargé du "BAT" Bon à tirer). D'ailleurs je m'associais à ce service. Je ne rentrai chez moi qu'après le BAT. Sauf exception, en effet, je tenais à relire le Journal de A à Z, avant "le bon à tirer"(je ne suis pas myope pour rien!). C'est le travail que je faisais lorsque j'y étais simple rédacteur au début de ma carrière journalistique. J'avais attiré leur attention particulière sur la qualité du journal qui laissait beaucoup à désirer. J'attendais une amélioration rapide dans la mesure du possible. Bien souvent la parution du quotidien butait sur des difficultés d'ordre matériel (techniques). Une seule personne (Diallo Oumar) pouvait réparer l'offset en panne (matériel allemand) sans quoi, l'édition du Journal était hypothéquée, compromise. Le régime despotique d'alors n'admettait pas et ne cherchait même pas à comprendre que le Journal ne pût paraitre chaque jour. La lecture du quotidien Chaab était le petit déjeuner du chef de l’État. Fait plus strictement observé pendant la période douloureuse de la "guerre des ondes", entendez le conflit sénégalo-mauritanien dont nous évoquerons ici les méfaits, les causes et les conséquences dramatiques, synthétiquement. Le lancement de cette dynamique avait l'aval, le feu vert de mon supérieur hiérarchique qui n'était pas journaliste, mais un cadre modeste, moderne et moderniste.
L'absentéisme
J'abordai ensuite l’absentéisme qui caractérisait l'établissement, à l'instar de toutes les institutions nationales. Certains journalistes (la majorité d'ailleurs) ne se voyaient à la SMPI que pendant la période de paie, les fins du mois, notamment. Deux ou trois journalistes, parmi une vingtaine dont reporters et photographes présents, faisaient tout le travail. Relativement à cette délinquance économique, ou délinquance tout court, je dis à l'assemblée que désormais les absents au travail ne seront plus rémunérés, ils ne toucheront plus leurs salaires. J'ai enfoncé le clou en notifiant que non seulement l'absentéisme n'est plus toléré, mais aussi pareillement pour des retards au travail. Les retardataires n'auront plus accès à l'établissement. Ils seront considérés comme absents et donc, cela se répercutera sur leur paie. Afin de donner plus du crédit à mes propos, j'ai donné l'ordre, plutôt des consignes aux gardes qui étaient à la porte d'entrée de ne plus laisser personne entrer au-delà de 8 heures et quart, 8 h étant l’horaire fixé pour le travail.
Je veillais personnellement à l'application stricte de ces consignes. Ces mesures draconiennes avaient porté leurs fruits: ne s'absentaient que des gens qui y étaient forcés, des justifications obligatoires exigées en constituaient de preuves irréfutables. Au personnel du parc automobile, j'avais signalé les abus relatifs à son fonctionnement, son emploi qu'il fallait stopper. Au niveau du Journal, l’amélioration sur la forme et le fond étaient visibles. Le quotidien se vendait plus, et cela avait eu comme impact, l’assainissement des finances de la SMPI. Pour ce qui est de l'amélioration du Journal, l'appréciation, le témoignage et la confirmation sur son mieux progressif du public, des lecteurs, nous en servaient du baromètre. Vous pouvez d'ores et déjà imaginer les difficultés que j'ai dû rencontrer suite à cette rigueur que j'ai imposée au niveau du travail, connaissant la Mauritanie et les Mauritaniens. Chez nous, on déteste la loi, ceux qui l’élaborent, et surtout ceux ou celles qui l'appliquent. (A suivre!)



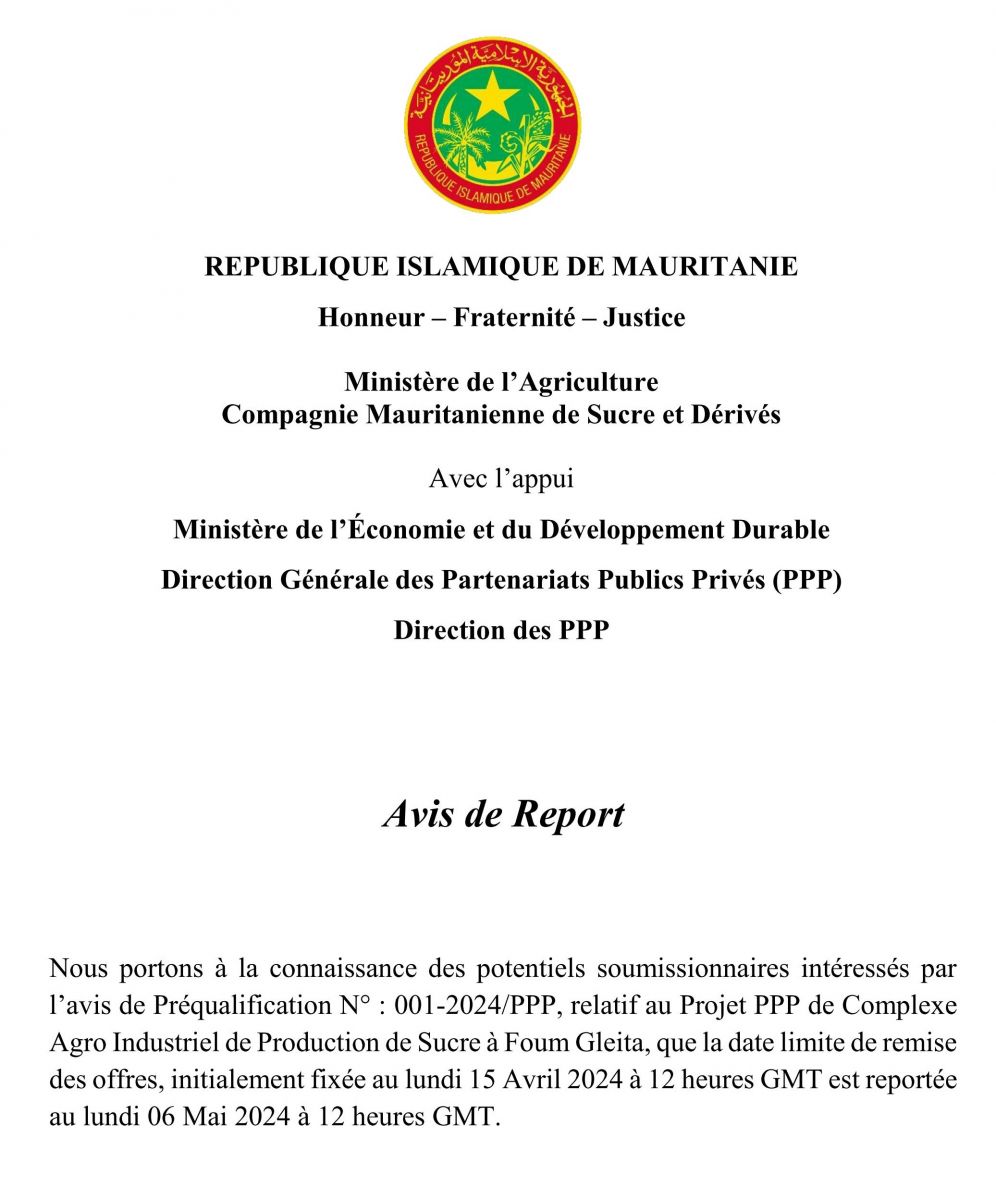









.gif)