
Dans le vacarme étourdissant de la modernité, une force insidieuse façonne nos comportements, nos désirs et nos valeurs : la société de consommation. Fondée sur l’exaltation de la possession et la quête effrénée de biens matériels, elle érige en norme le paraître et le luxe, reléguant l’éthique et la sobriété au rang de reliques désuètes. À travers ses mécanismes bien huilés — publicité, marketing, comparaison sociale permanente — elle impose une pression constante, souvent invisible, qui fragilise les plus vulnérables et pousse bien des citoyens vers des dérives inquiétantes.
Les populations modestes, particulièrement exposées à cette logique perverse, se retrouvent souvent piégées dans une spirale de frustration. Incapables d'accéder aux standards de vie imposés comme modèles de réussite, certains cèdent à la tentation de l’illégalité. Le vol, la petite délinquance, le recel ou la fraude deviennent alors des réponses tragiques à une exclusion sociale silencieuse. Le rêve consumériste, inaccessible par les voies légitimes, devient le moteur d’une trajectoire délinquante qui enferme les plus précaires dans un cercle vicieux de marginalisation.
Mais ces dérives ne se cantonnent pas aux bas-fonds de la société. Elles s’immiscent également dans les couloirs feutrés de l’administration publique. Des fonctionnaires, souvent accablés par la dissonance entre leur train de vie modeste et les injonctions sociales de réussite visible, finissent par céder à la tentation du détournement de fonds, de la corruption ou du trafic d’influence. Ces dérives, bien plus discrètes, n’en sont pas moins destructrices : elles sapent la confiance dans les institutions, érodent l’État de droit et alimentent le sentiment d’injustice généralisée.
Plus inquiétant encore, certains, mus par l’appât du gain rapide et facile, se tournent vers des activités illicites de grande ampleur, comme le trafic de stupéfiants. Ces réseaux souterrains, souvent liés à des logiques transnationales, prospèrent sur le terreau de la frustration collective et du vide moral laissé par une société obsédée par la consommation. Ce choix, périlleux tant pour l’individu que pour l’ordre social, illustre le point de rupture où la quête de richesse, exacerbée par le modèle consumériste, éclipse toute considération éthique ou humaine.
Ainsi, la société de consommation, en glorifiant sans réserve l’avoir au détriment de l’être, engendre des comportements déviants à tous les niveaux de l’échelle sociale. Du voleur de rue au cadre corrompu, du petit dealer au fonctionnaire dévoyé, tous sont, à des degrés divers, les produits d’un même système qui valorise l’apparence, attise l’envie et annihile les repères moraux. Il devient alors urgent, pour préserver la cohésion sociale, de repenser nos modèles culturels, de réhabiliter la valeur de l’intégrité, et de rompre avec cette frénésie consumériste qui transforme les citoyens en prédateurs ou en proies.
Car à force de tout mesurer à l’aune de la possession, c’est l’âme même de notre société que nous risquons de perdre.
Eleya Mohamed




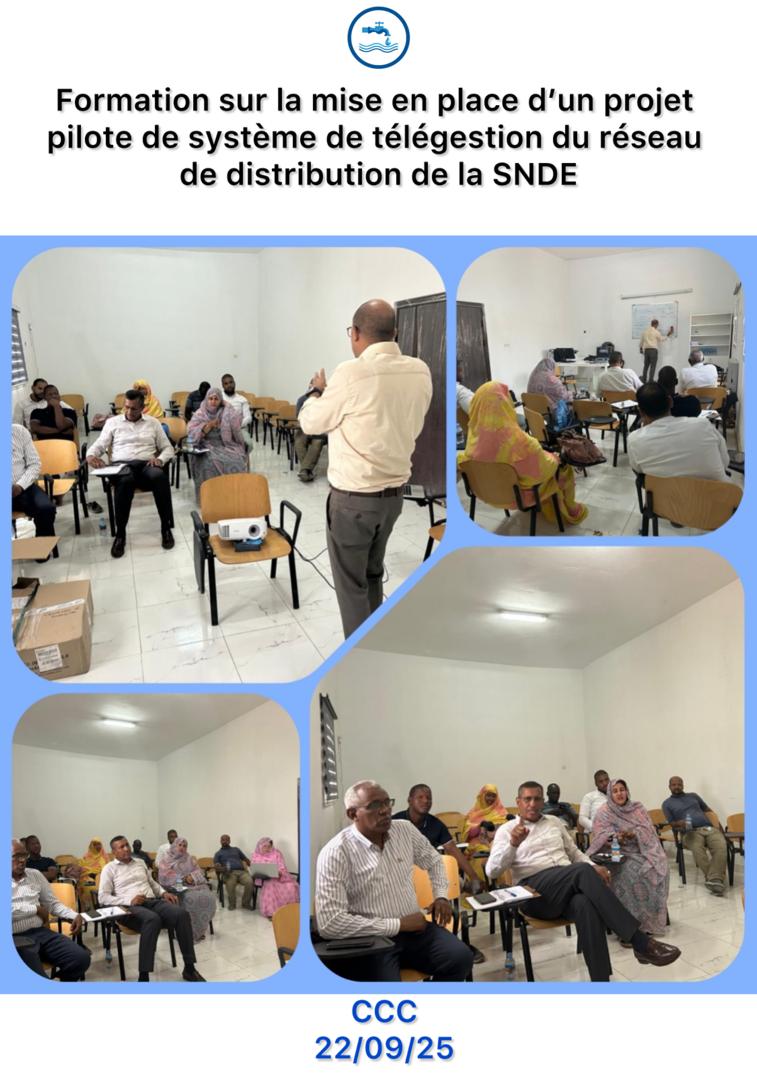
.gif)
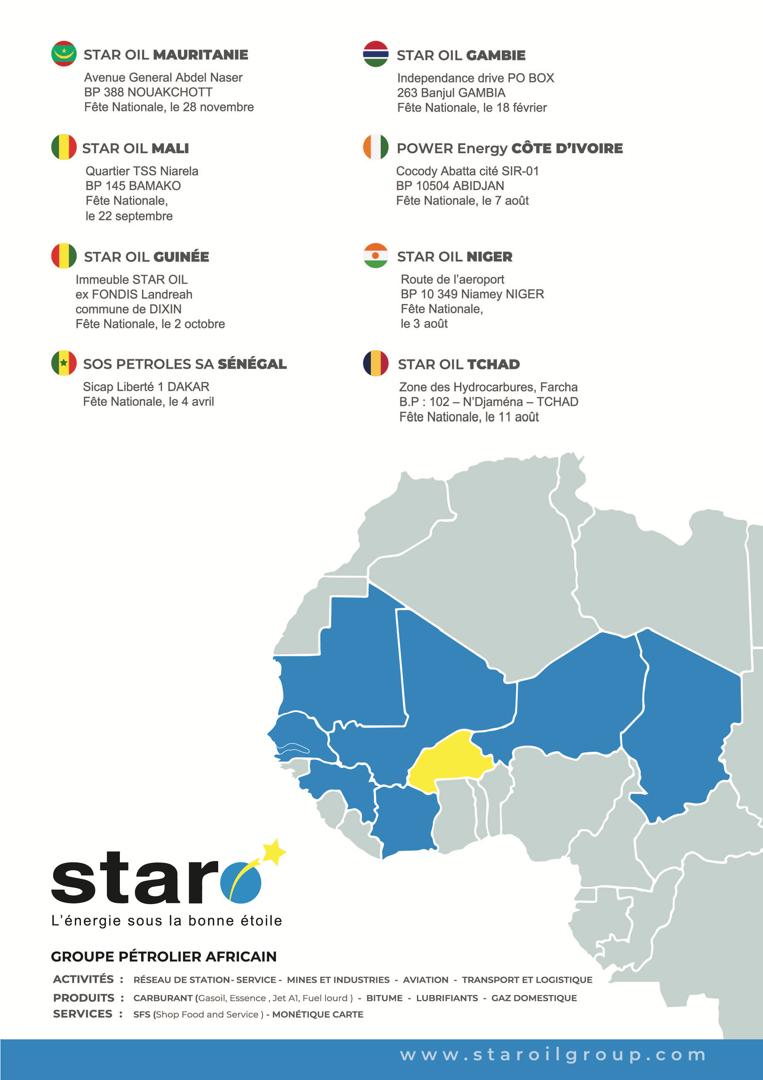

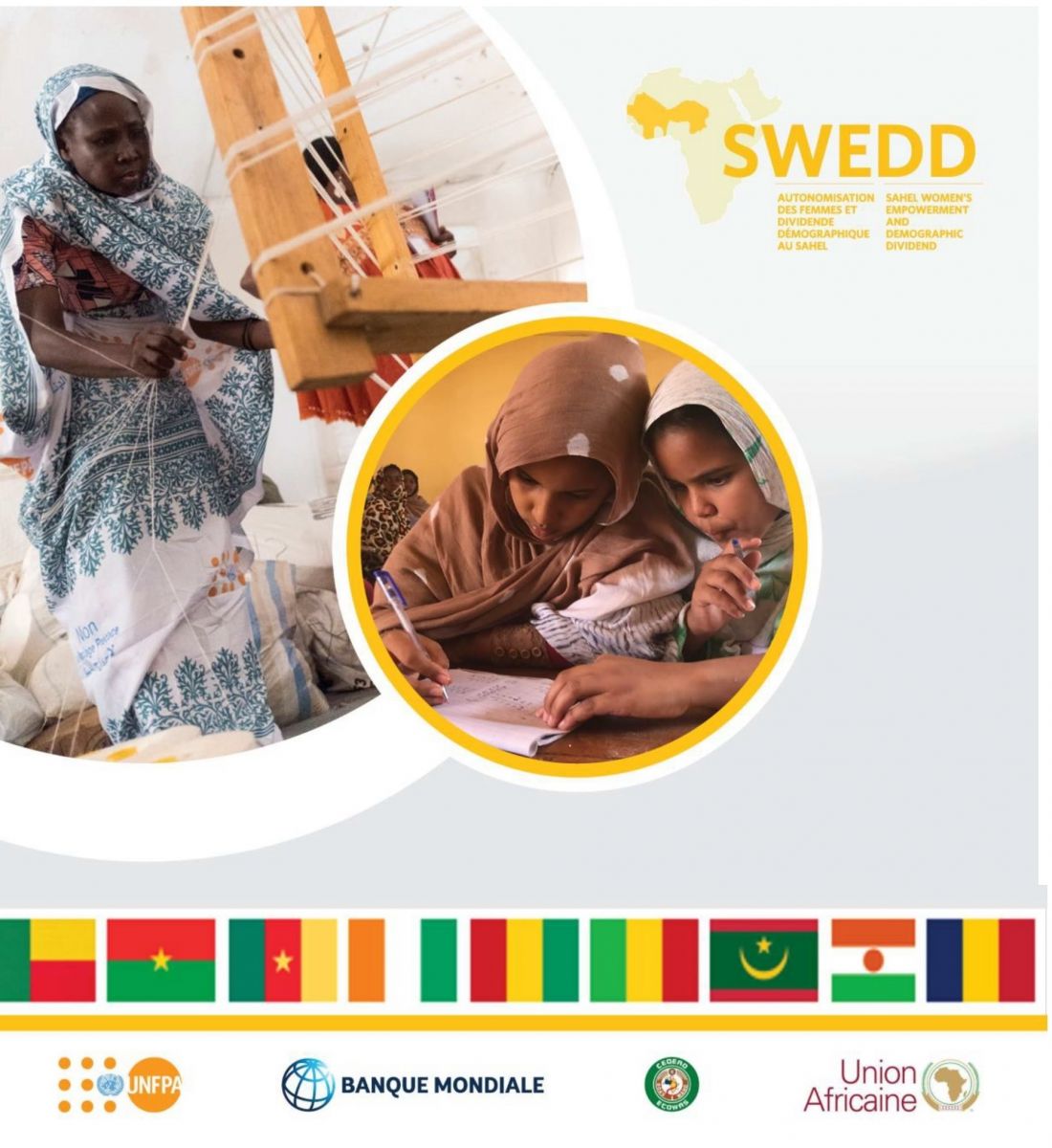
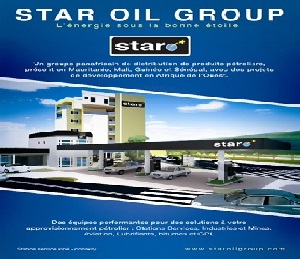




.gif)