
Nouakchott observe, Bamako s’enlise et la poudrière sahélienne menace d’exploser.
Depuis la montée en puissance des groupes jihadistes dans le nord et le centre du Mali, la transition militaire à Bamako, et la rupture avec les partenaires traditionnels comme la France et l’ONU, la Mauritanie — voisine directe — multiplie les signes d’inquiétude. Et pour cause : la guerre qui ravage le Mali semble plus proche que jamais de franchir la frontière.
D’ailleurs, ce pays liant le Maghreb à l’Afrique noire équipe son armée en armements modernes adaptés aux interventions dans la zone.
Un voisin malien à feu et à sang
Depuis 2012, le Mali vit une spirale de violences où se mêlent rébellions touarègues, insurrections jihadistes et dérives militaires. Le retrait des troupes françaises de Barkhane, suivi de celui de la MINUSMA (mission de l’ONU), a laissé un vide que les autorités maliennes ont tenté de combler en se tournant vers la Russie, notamment à travers le groupe Wagner qui, aujourd’hui, abandonne le champ de bataille.
Mais loin de ramener l’ordre, cette stratégie a conduit à un durcissement militaire et à l’isolement diplomatique. Aujourd’hui, le nord du pays est à nouveau le théâtre d’affrontements violents, notamment entre l’armée malienne et les groupes armés signataires de l’accord d’Alger, tandis que le centre reste ravagé par les attaques jihadistes.
La Mauritanie : une stabilité menacée
Jusqu’ici, la Mauritanie a été saluée pour sa capacité à éviter l’embrasement sahélien, grâce à une stratégie sécuritaire préventive, un contrôle frontalier renforcé, et un dialogue limité mais intelligent avec certaines communautés locales. Mais la donne est en train de changer.
Ces derniers mois, plusieurs incidents ont eu lieu près de la frontière. Des échanges de tirs, des incursions non revendiquées, et des rumeurs persistantes sur des infiltrations jihadistes dans les zones frontalières du Hodh chargent l’atmosphère. À cela s’ajoute un facteur humain : la pression migratoire de réfugiés maliens fuyant les combats, notamment issus des régions de Tombouctou, Gao et Ménaka.
Une guerre régionale qui ne dit pas son nom
Ce que redoute Nouakchott, ce n’est pas seulement une vague de réfugiés ou des accrochages ponctuels, mais un effondrement total du Mali qui entraînerait l’ensemble du voisinage sahélien dans une nouvelle phase de guerre hybride — mêlant conflits communautaires, terrorisme transfrontalier et économie criminelle.
Avec la dégradation du dialogue entre Bamako et les Touaregs, et la faiblesse manifeste de la coordination entre les pays du G5 Sahel (désormais moribond), la Mauritanie se retrouve pratiquement seule face à une menace diffuse mais croissante. D’autant que les autorités maliennes, en misant sur la force plutôt que sur la négociation, laissent entrevoir un conflit long, incontrôlé et difficilement cantonné.
La diplomatie mauritanienne sur un fil
Face à cette situation, la Mauritanie tente de garder une position d’équilibre : éviter de froisser le pouvoir malien tout en renforçant sa sécurité. Elle mène en coulisses un discret travail diplomatique avec les Touaregs, avec Alger, et surveille de très près l’évolution de la présence russe dans la zone.
Mais le dilemme est stratégique : jusqu’où peut-on rester neutre quand la guerre est à la porte ? Et que faire si l’État malien s’effondre totalement dans certaines régions frontalières ? Pour Nouakchott, l’équation est de plus en plus complexe.
Un risque de contagion à ne pas sous-estimer
Le Mali n’est plus seulement un voisin instable pour la Mauritanie. Il est devenu une menace potentielle, dont les répercussions sécuritaires, humanitaires et politiques peuvent bouleverser l’équilibre d’un pays qui, jusqu’ici, avait su rester à l’écart du tumulte.
Mais l’orage approche. Et cette fois, personne ne pourra dire qu’il n’a pas vu les nuages venir.
Scheine




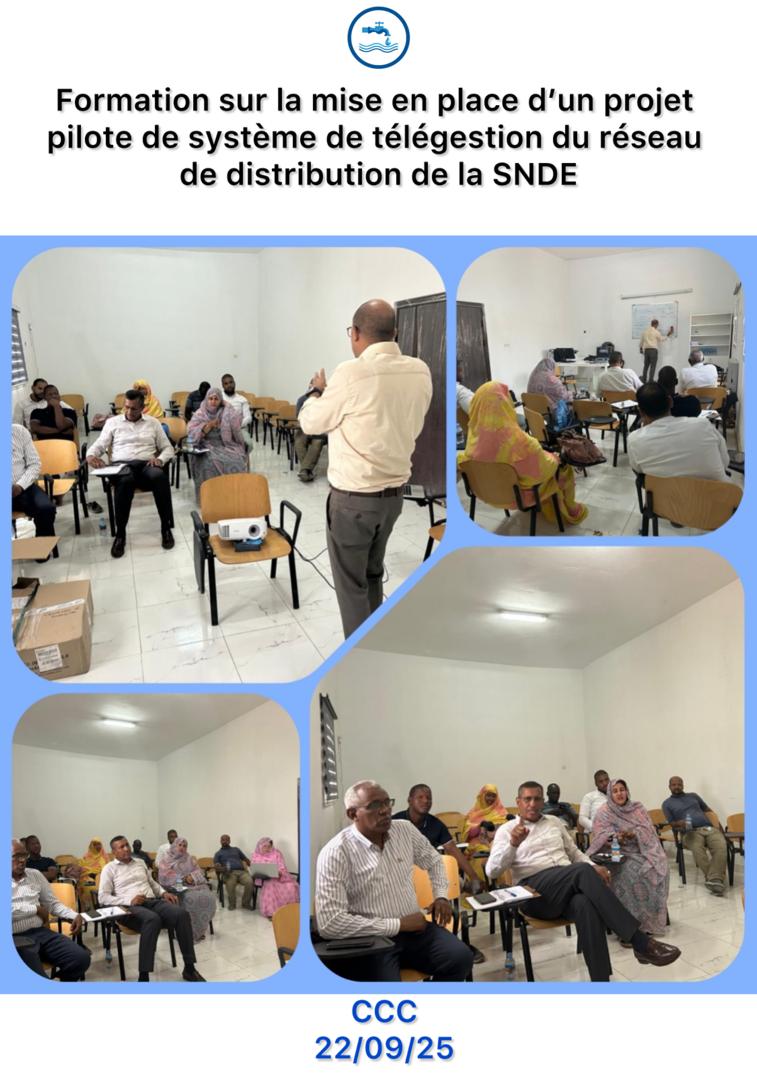
.gif)
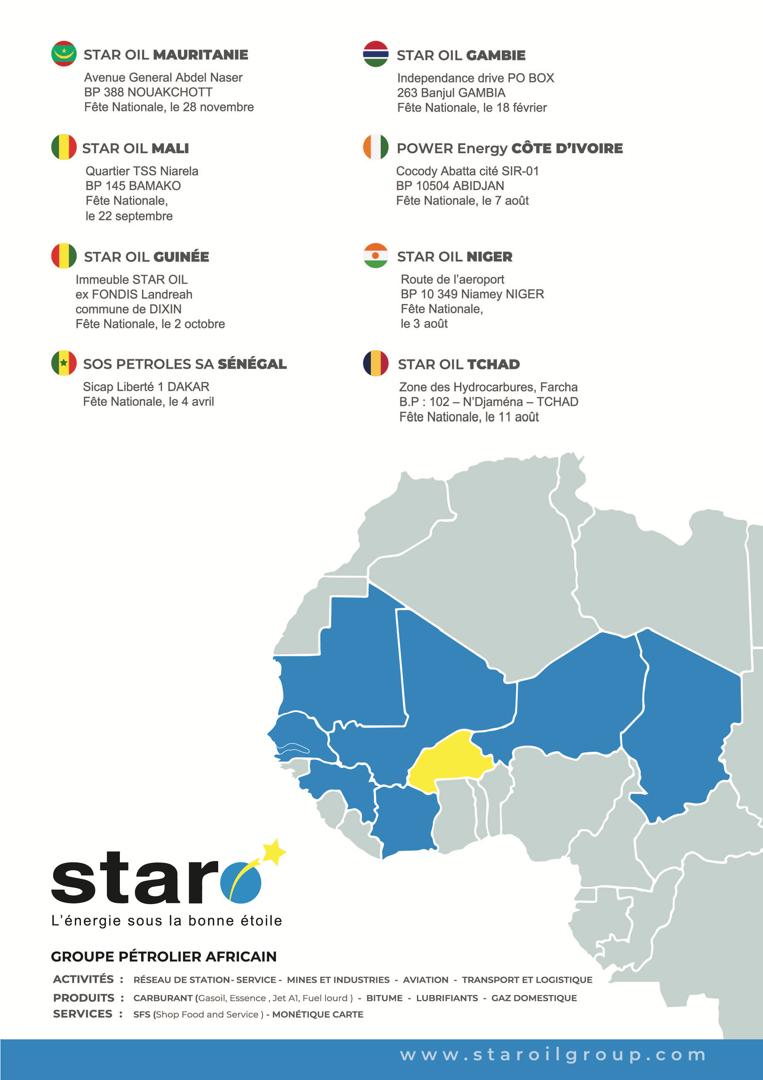

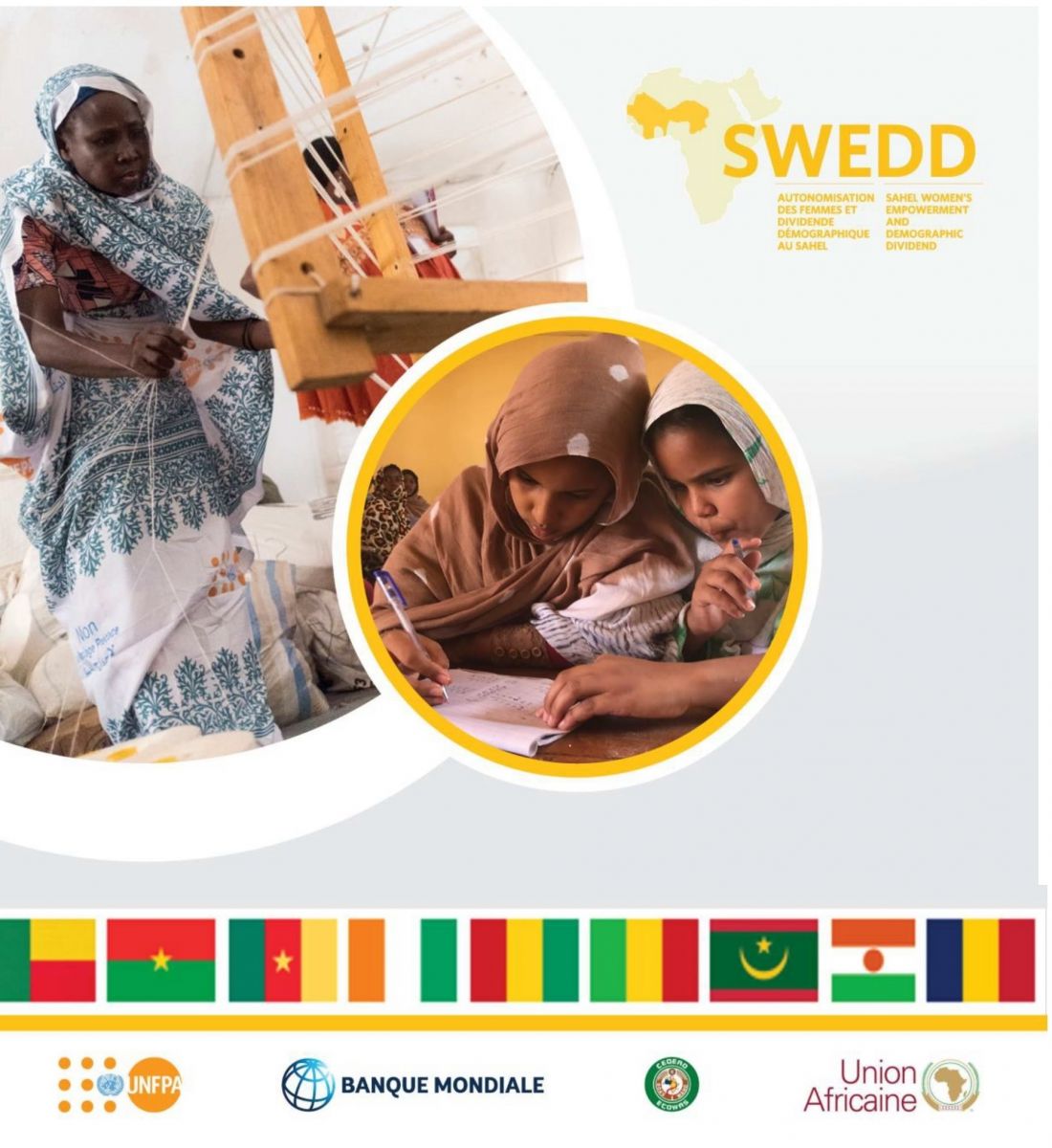
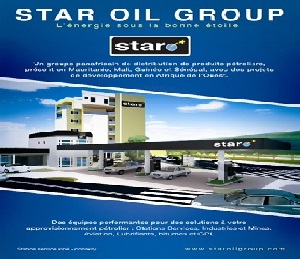




.gif)