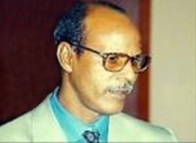
Cette modeste contribution a pour ambition de prendre le train en marche de ce qu’on appelle le dialogue national qui n’en est pas un, de mon humble point de vue. Ce n’est pas que je m’oppose à l’idée, mais je me réfère à l’étymologie, le dialogue étant une discussion entre deux interlocuteurs et non l’ensemble d’acteurs que le miroir national politique, économique et social a des difficultés à refléter. Il s’agit en effet d’un débat national dont nous avons un besoin pressant pour formuler une vision partagée du présent et de l’avenir de notre pays. Notre Etat a été bien fondé au départ, bien géré par une génération qui mérite un grand hommage, mais il a été implanté sans décapage préalable des dunes mouvantes au sens propre comme au sens figuré. Dans la précipitation, nous avons mis le débat politique avant celui lié aux autres aspects, notamment culturels et sociaux. Aujourd’hui, l’histoire nous rattrape et risque de prendre sur nous une cruelle revanche. Il faut donc discuter à tête froide et sans tabou, car à défaut de cela, notre naufrage est certains et nous sombrerons tous avec nos jolis boubous et nos casquettes bien dorées.
Le présent document essaie de soulever, sans les approfondir, les questions essentielles que pose la conjoncture de notre pays, pour répondre à l’appel de l’Histoire et aux attentes de nos populations. Pour aller sans tarder au but, notre pays souffre principalement d’une absence de vision à moyen et long termes, d’une paralysie chronique des institutions de l’Etat et d’un immense gaspillage des ressources publiques de tous genres due principalement à une mauvaise approche de développement.
La paralysie des institutions civiles
Les manifestations de la paralysie de l’Etat sont de plus en plus visibles dans leurs formes et prévisibles du point de vue de leurs dimensions politiques, économiques et sociales. L’ignorance et le mépris inconscient de ses causes pourraient, qu’à Dieu ne plaise, engendrer des situations irréversibles dont notre pays n’est pas plus exempt que bien d’autres sur le continent africain. En attendant une réflexion plus approfondie, on pourrait limiter à six les principales causes structurelles de la paralysie des institutions de notre jeune Etat :
1° Une perte par l’Etat de sa dimension providentielle
Né dans l’improvisation et prenant en charge le destin d’un peuple démuni, longtemps malmené par la colonisation, l’Etat national post colonial ne pouvait que revêtir une forte dimension providentielle, voire paternaliste que l’Ajustement structurel a annihilée au nom d’une libéralisation sauvage et irresponsable de l’économie du néant. Il en est résulté qu’au fur et à mesure de son évolution postérieure, l’Etat a détruit les instruments de cette paternité en réduisant à néant les grandes entreprises nationales et en libéralisant maladroitement tous les secteurs, y compris l’Education et la Santé. La question qui se pose désormais est de savoir comment corriger cette erreur, principale cause des inégalités qui constituent actuellement la plus dangereuse menace sur notre cohésion sociale.
2° Une Fonction Publique qui se nécrose
La Fonction Publique, pilier de l’Etat aux agents bien formés pour des missions nécessitant dévouement, détachement, neutralité et obéissance aux exigences cardinales du service public, s’est nécrosée en entrainant une dépréciation professionnelle et éthique sans précédent de son élément humain. La prolifération inimaginable de faux diplômes, l’absence de référentiels pour l’utilisation des compétences, quand elles existent, et d’autres comportements nuisibles dont on ne se cache plus, empêchent l’Etat de rendre un quelconque service aux citoyens.
Les locaux des services publics, y compris les Départements ministériels, ultimes recours des citoyens, sont protégés par des grilles et des chaines et défendus d’accès, ce qui explique l’absence devant eux des usagers qui en payent les agents et qui viennent en quête de réponse à leurs innombrables sollicitations.
3° Un gouvernement englué dans le quotidien
En tant que locomotive centrale de l’Etat, le Gouvernement est assis sur deux principes cardinaux, à savoir la spécialisation ministérielle et la coordination. La conciliation de ces principes nécessite une clarté de la répartition des charges publiques entre ministères d’une part, et des règles régissant les différents domaines d’intervention de l’Etat, d’autre part. Or, dans notre cas, l’activité de l’Etat est paralysée par une confusion des textes aussi bien en matière de fixation des attributions des Ministres qu’en ce qui concerne ceux régissant les différents domaines. Par exemple, la gestion du secteur rural, centre de convergence des enjeux publics, se heurte à cette confusion entre les codes régissant les ressources naturelles et empêche l’Etat de répondre aux attentes des populations du rif. Une telle situation a de nombreuses causes dont la plus importante est l’absence, depuis trois décennies, de la fonction de coordination gouvernementale. Paradoxalement, cette absence n’a été palliée que depuis la création, par la Constitution, d’un poste de premier Ministre. L’actuel s’en est vite rendu compte, car c’est un praticien du développement à la base, mais il n’est pas certain qu’il puisse y remédier à cause de la force de l’habitude. On a l’impression d’être face à un gouvernement à deux étages dirigés, chacun, par un Premier Ministre, ce qui est caractéristique des situations qui précèdent les grandes scissions au sein du pouvoir.
4° Une prolifération de structures hybrides
L’Ajustement structurel et l’avènement d’une nouvelle conception selon laquelle l’administration n’est qu’un instrument de répression, incapable de conduire des actions de développement, ont fait le lit d’une multitude de structures hybrides appelées « Projets » qui s’avèrent improductives dans de très nombreux cas. Ces structures ont affaibli les services publics classiques et perverti leurs fonctionnaires, conséquence logique d’une conception outre atlantique diabolisant l’Etat, alors que la genèse du nôtre n’est même pas encore achevée. Déjà, la création après l’indépendance, des établissements publics ou administrations de mission, avait affaibli les Départements ministériels, mais ce fut un mal nécessaire selon une vision keynésienne.
Aussi, en dépit de cette constitution, au flanc de l’administration traditionnelle de ces structures saprophytes ou « projets » échappant à toute règle de procédure et de contrôle des autorités de l’Etat, assiste-t-on à une multiplication injustifiée des services publics. La croissance considérable du nombre de conseillers, de chargés de mission, d’inspecteurs et la création de directions générales constituent une source de confusion, de lenteur, de frustration et de découragement pour les hauts cadres. Paradoxalement, plus l’Administration grandit, s’étoffe, absorbe des ressources de tous genres, plus l’Etat est incapable de répondre aux préoccupations de ses citoyens.
5° Une décentralisation mort-née
Pour parler sans complaisance électoraliste, on peut considérer que l’option a été prématurée de créer des collectivités locales d’un tel nombre et à deux échelons territoriaux et ne répond à aucune logique. L’Etat a transféré aux Communes certains services de proximité, alors qu’il a été lui-même capable de s’en acquitter. Il demeure responsable aux yeux des populations qui lui en veulent pour avoir fui ses responsabilités. L’échec des communes et celui encore plus probable des Régions, ne font aucun doute, si bien qu’en ne mettant pas en doute ce modèle de décentralisation, l’Etat paraitra irresponsable et incompétent aux yeux des populations
6° Une démocratisation au service de l’anarchie
L’option de démocratisation s’avère elle aussi prématurée, car elle n’a jamais été une revendication populaire, mais celle d‘une élite presque insignifiante du point de vue du nombre et de l’efficacité. La nécessité pour les gouvernants de se montrer légitimes au vu des règles pourtant inappliquées d’un système pour le moins exogène, a redonné de l‘importance aux cadres identitaires pré-étatiques et affaibli considérablement l’Etat. La démocratie au vrai sens du mot est restée loin derrière, en mettant en avant ses aspérités les plus négatives, y compris le culte de l’anarchie et de l’impunité.
Une mauvaise approche de développement à la base
En réalité, mieux vaut dire que nous n’avons pas d’approche de développement à la base, pour ainsi dire au niveau de nos communautés locales. La conséquence la plus évidente de cette absence est que nos populations rurales sont devenues plus pauvres qu’elles ne l’étaient il y a des décennies. Nous serons déçus, voire irrités, si nous procédons à une évaluation de l’impact de tous les financements obtenus depuis une trentaine d’années seulement. Des centaines de milliards dont il ne reste parfois que des fils de barbelés autour de terrains incultes ou des épaves de véhicules rouillés. Ce n’est pas de la poésie, mais une réalité amère dont il faut chercher les racines et les traiter adéquatement, au cas où nous devrions envisager réellement une réforme de l’Etat. Sans aller dans les détails de l’analyse, on pourrait attribuer cette situation à trois causes essentielles, à savoir (i) une intervention directe de l‘Etat qui l’affaiblit (ii) une approche de lutte contre la pauvreté qui engendre la pauvreté et (iii) un apport extérieur mal utilisé.
- Un Etat affaibli par une intervention directe populiste
L’Etat créé, au flanc de ses structures déjà expérimentées, d’autres qui doivent, avant d’entamer une quelconque action, prendre le temps d’acquérir l’expérience nécessaire, disposer de plans et se familiariser avec le contexte sociologique et administratif. Ce fut le cas du Commissariat aux Droits de l’Homme et à la Lutte contre la pauvreté, et de l’Agence Tadamoun et de l’actuelle TAAZOUR. Ces structures affaiblissent l’Etat en rendant inutiles les services techniques traditionnels, en dépensant inutilement des masses budgétaires considérables. Paradoxalement, ces structures sont des viviers idéaux pour la mauvaise gestion et une source de perte de crédibilité de l’Etat.
Aussi louable qu’elle soit, la distribution de masses d’argent aux pauvres produit un effet négatif similaire à celui de l‘aide alimentaire d’urgence qui a provoqué, depuis le Plan d’urgence de 1968, un exode rural massif, enraciné la mentalité d’assisté et entrainé la déstructuration du secteur rural. Certains projets, dont l’expérience devrait être repensée, ont tiré la conclusion, après avoir distribué des fonds aux ménages des zones pauvres du pays, que les bénéficiaires utilisent ces subsides pour la satisfaction de besoins secondaires. La politique de micro-crédit pour la promotion des métiers et des petites entreprises, a eu, par contre, des effets positifs et durables avec bien moins de ressources.
- Une intervention des partenaires mal utilisée
Les interventions de nos partenaires n’ont, comme souligné plus haut, aucun impact à la hauteur des moyens mobilisés et des espoirs des communautés de base. Bien des raisons expliquent cet échec et cette déception : (i) les bailleurs de fonds choisissent souvent les secteurs d’intervention sans égard aux priorités du pays telles que prévues par nos plans et stratégies nationales ou sectorielles (ii) les conventions de financement sont, dans la plupart des cas mal négociées, l’essentiel pour les représentants du Gouvernement étant toujours les Ministères auxquels les Projets doivent être rattachés (iii) les régions et les communautés bénéficiaires sont choisies par les bailleurs de fonds, ce qui a provoqué une concentration des investissements dans un petit nombre de régions, alors que d’autres sont presque exclues des interventions sans aucune raison apparente (iv) le détournement des projets de leurs objectifs en leur imposant des méthodes, des choix humains et des zones d’intervention moins nécessiteuses.
Ce constat partiel semble réellement préoccupant et nous met devant un choix historique à opérer tarder :
Ou bien continuer à assurer une gestion quotidienne du pays en faisant comme la plupart de ceux qui nous ont précédés. Dans ce cas, notre pays ne pourra en aucun cas éviter de tomber dans les soubresauts bouleversants qui attendent les Etats post-coloniaux inconscients du fait qu’ils sont arrivés, du point de vue du contenu et de la forme, à leur date de péremption. Ou bien envisager de gérer le pays autrement qu’il ne l’a été jusqu’à présent et mesurer à sa juste valeur le poids des défis et le prix à payer pour les relever.
C’est ce dernier choix que nous souhaitons d’envisager en nous fondant d’abord sur la nécessité évidente et, ensuite, sur la confiance que les populations placent encore dans les principaux hommes qui tiennent les commandes du pays.
Suite dans la prochaine édition
(Esquisse d’une stratégie de changement d’orbite)




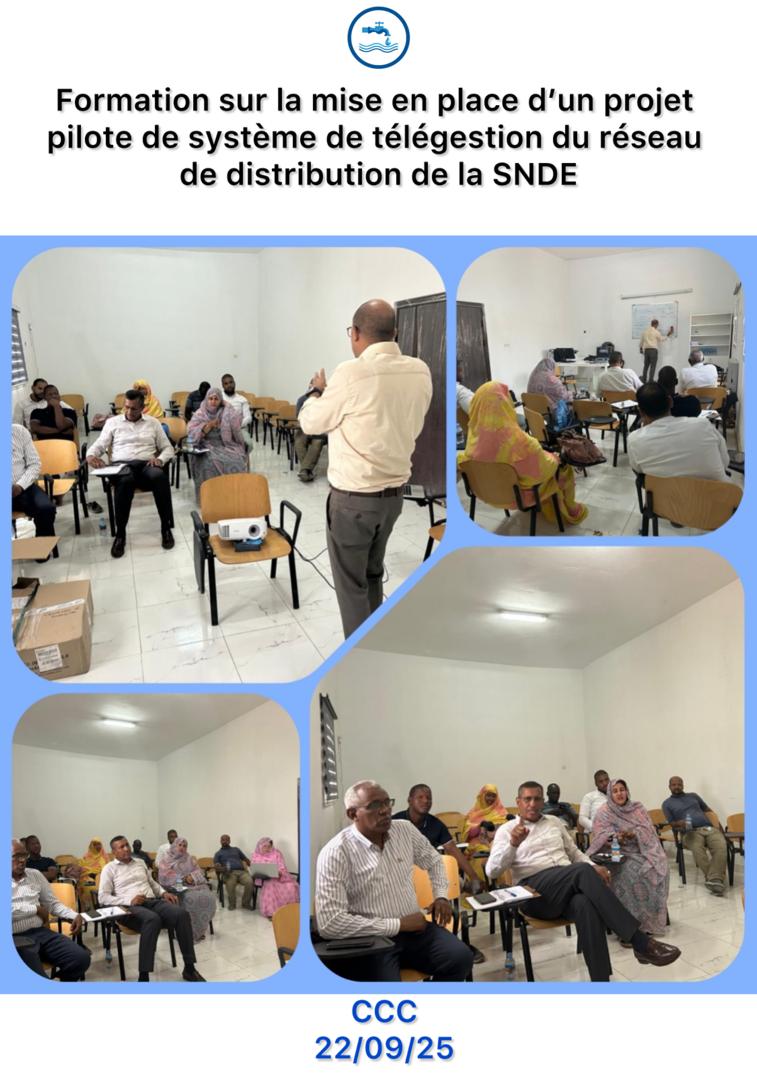
.gif)
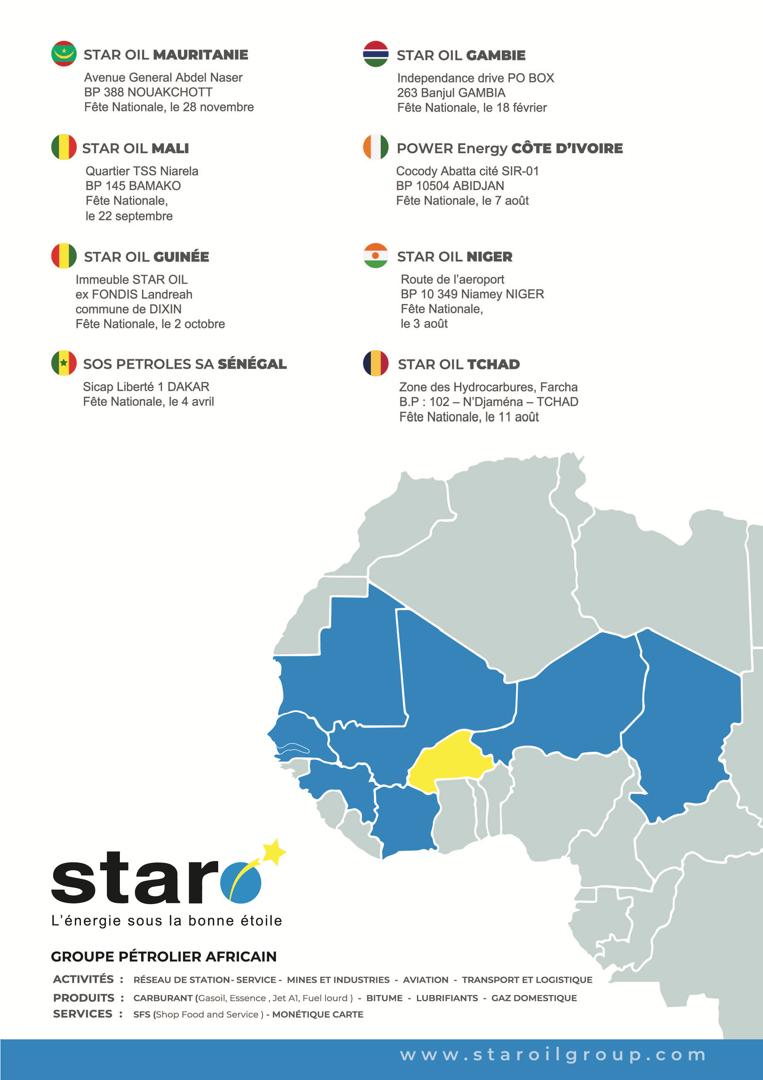

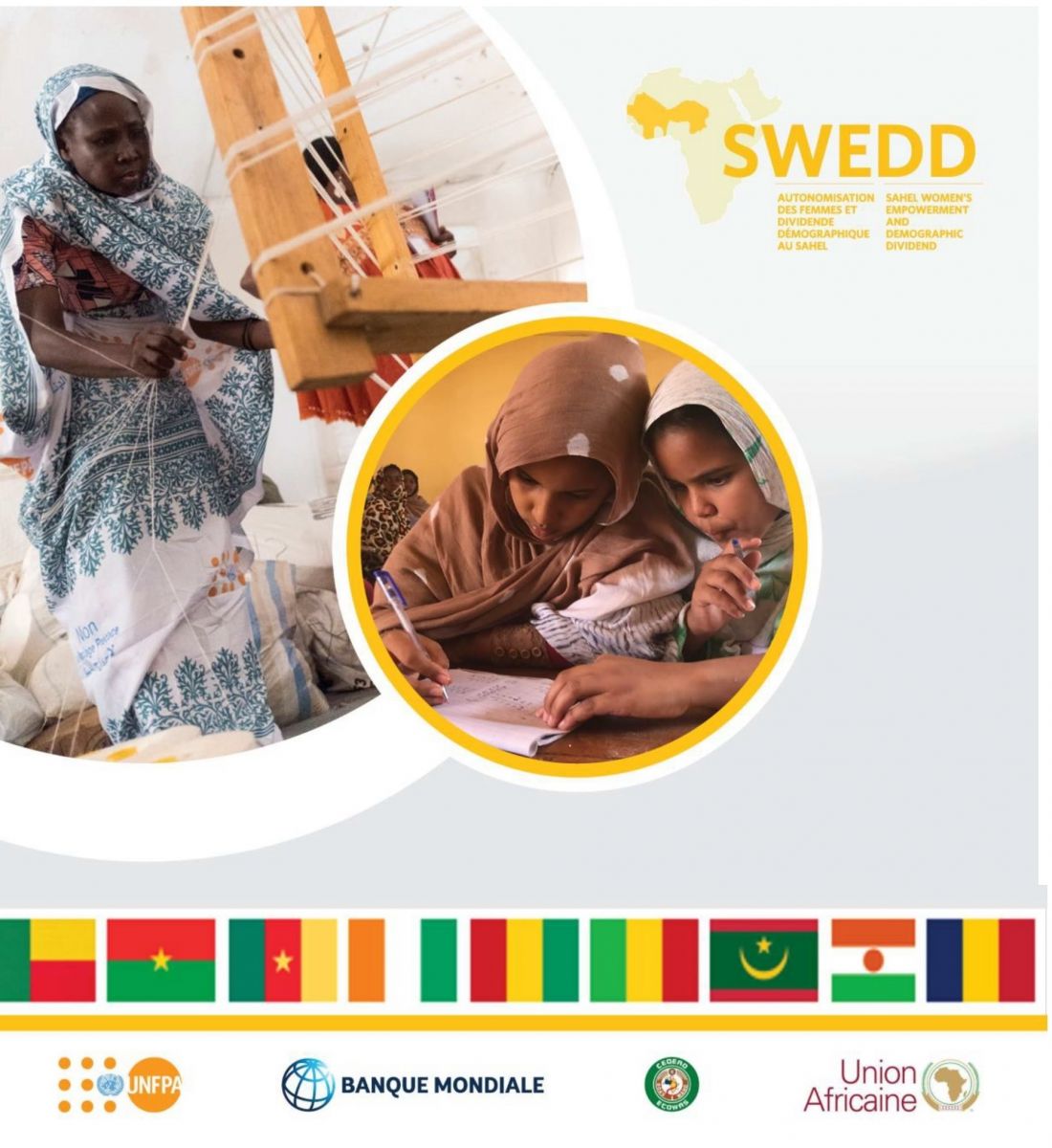
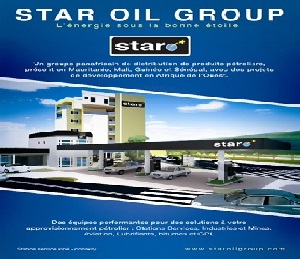




.gif)