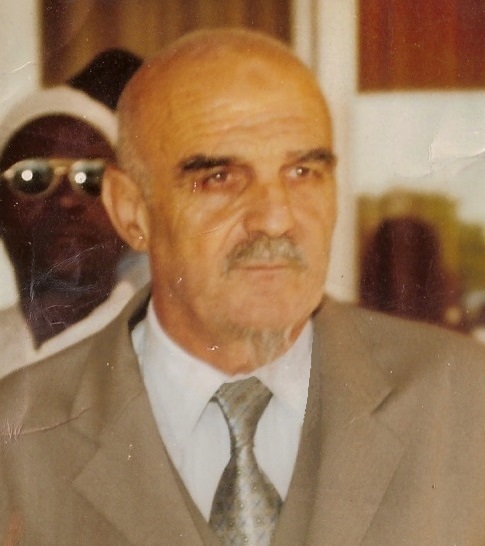
Le premier de ces constats apparaît avec les ouvrages de divers chercheurs, en particulier ceux d’Adam Smith (1723-1790), auteur de deux études particulièrement remarquées : « Théorie des sentiments moraux » et « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », respectivement publiés en 1759 et 1776 ; puis de Thomas Clarkson (1), ouvertement abolitionniste, quant à lui, mais non moins féru de science. « Faible productivité physique de l’esclave dépourvu de toute motivation ; coûts de reproduction et pertes humaines élevés ; monopolisation du fret des navires... », leurs arguments s’augmentent d’hypothèses sur le gain potentiel d’une éducation des Africains à « La » civilisation, accroissant leurs besoins et, donc, les exportations de produits manufacturés. La perte des colonies en Amérique du Nord est un constat plus rude. Elle oblige les Britanniques à rediriger leur présence en Afrique vers une colonisation des sols, tout en s’appliquant à y contrer la traite des pays concurrents, notamment la France, via l’imposition d’une interdiction de l’exportation d’esclaves du continent noir.
Imposée aux Français vaincus et à leurs alliés espagnols et portugais, lors du congrès susdit de Vienne, au nom des droits de l’Homme que prétendait déjà défendre la révolution française en 1789, cette mesure donne à la marine anglaise – désormais maîtresse, rappelons-le, de l’océan Atlantique – un droit d’arraisonnement de tout navire contrevenant à cet embargo, tandis que s’accélère, sur son territoire, la production de charbon et d’acier, ainsi que la construction d’infrastructures (canaux, routes, ponts, quais, docks, usines, etc.). En 1815, le secteur des industries et des mines occupe désormais plus de population active que celui de l’agriculture et l’exode rural ne cesse de s’amplifier, suite aux annexions des terres pâturables et cultivables par les grands propriétaires du foncier rural. L’urbanisation galopante et la prolétarisation des masses populaires sont alors les signes de l’avancée d’un capitalisme assis sur la conviction de ce que le secteur secondaire – la transformation de matières premières en produits manufacturés – est le seul et vrai moteur de la richesse.
C’est sur ce leitmotiv on ne peut plus matérialiste que vont se construire, durant deux siècles – c’est-à-dire : jusqu’à aujourd’hui – les politiques nationales et internationales, partageant l’Humanité en deux blocs ; le premier dit « développé », maître dudit secteur secondaire, et le second perpétuellement déclaré « sous-développé » – sinon, « en voie de développement » – mais, en tous les cas, contraint de fournir à son devancier les trivialités nécessaires à l’inégalable industrie de celui-ci. Deux blocs au demeurant assez ouverts l’un à l’autre – relations d’échange obligent : commerce, publicités, communications au sens le plus large du terme… autrement dit : secteur tertiaire – pour laisser envisager l’entrée, au sein du très exigeant club « civilisé », de nouveaux pays qu’on qualifiera cependant toujours – le terme n’est pas neutre – « d’émergents ». Cette ligne générale apparaît longtemps imperturbable, en dépit d’apparents contre-temps ordinairement dramatiques : guerres de plus en plus meurtrières, crises financières de plus en plus mondialisées et révoltes ou carrément révolutions populaires variablement manipulées, elles aussi.
Faut-il ici souligner qu’une telle attitude impliquait le renoncement à tout autre sacralisation de nos aspirations intimes ? Aucune contestation de l’ordre en cours ne pouvait s’appuyer sur la moindre dimension « irrationnelle » ; notamment la foi en un Dieu Seul Savant et Ordonnateur des mondes ; ainsi que s’y employèrent les diverses idéologies d’inspiration marxiste. Au mieux relégué dans un strict rôle de gardien de valeurs morales socialisantes, à l’instar de ce qu’avait convenu le système « libéral » anglo-saxon, le religieux s’est vu depuis partout exclu de toute dimension politique d’envergure et immédiatement taxé d’arriération mentale, sitôt qu’il a cru pouvoir s’y enhardir. Serait-ce qu’a contrario, il y aurait son mot à dire ? Cette question a commencé à prendre une nouvelle ampleur au milieu du 20ème siècle avec l’apparition des mouvements intellectuels envisageant le dépassement des limites naturelles de l’humain confronté à des conditions vitales de plus en plus artificielles. (À suivre).
Ian Mansour de Grange
NOTES
(1) : Dans son « Essai sur les désavantages politiques de la traite des nègres », Neuchâtel, 1789.




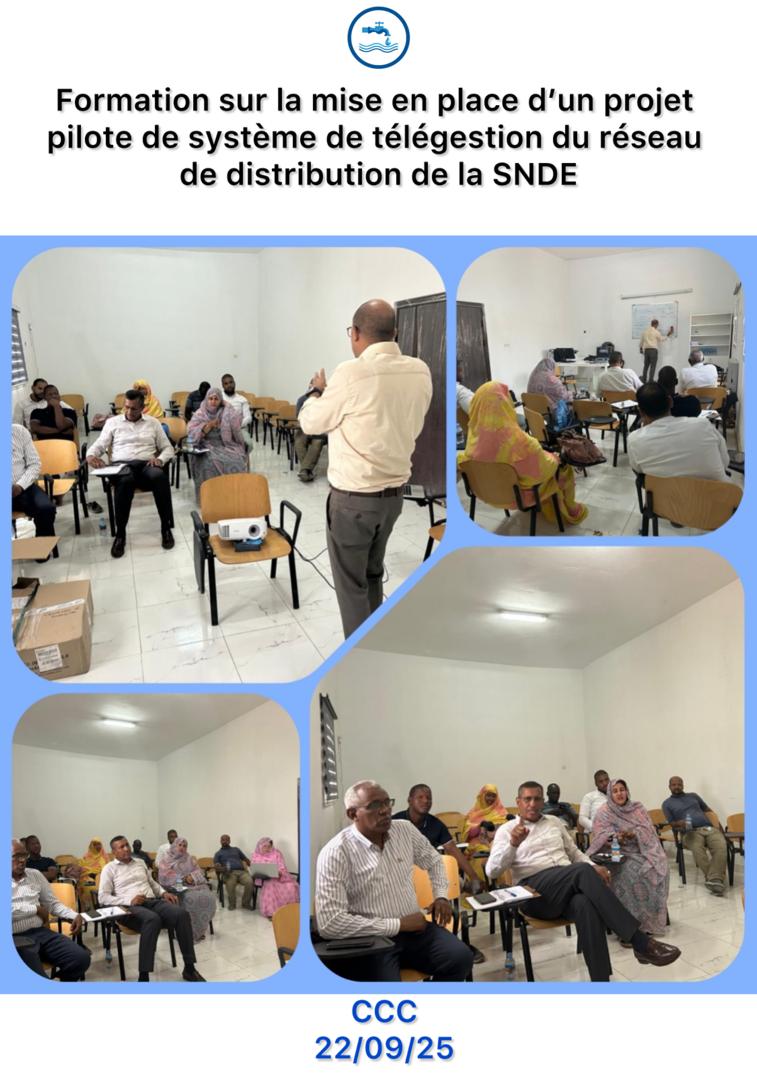
.gif)
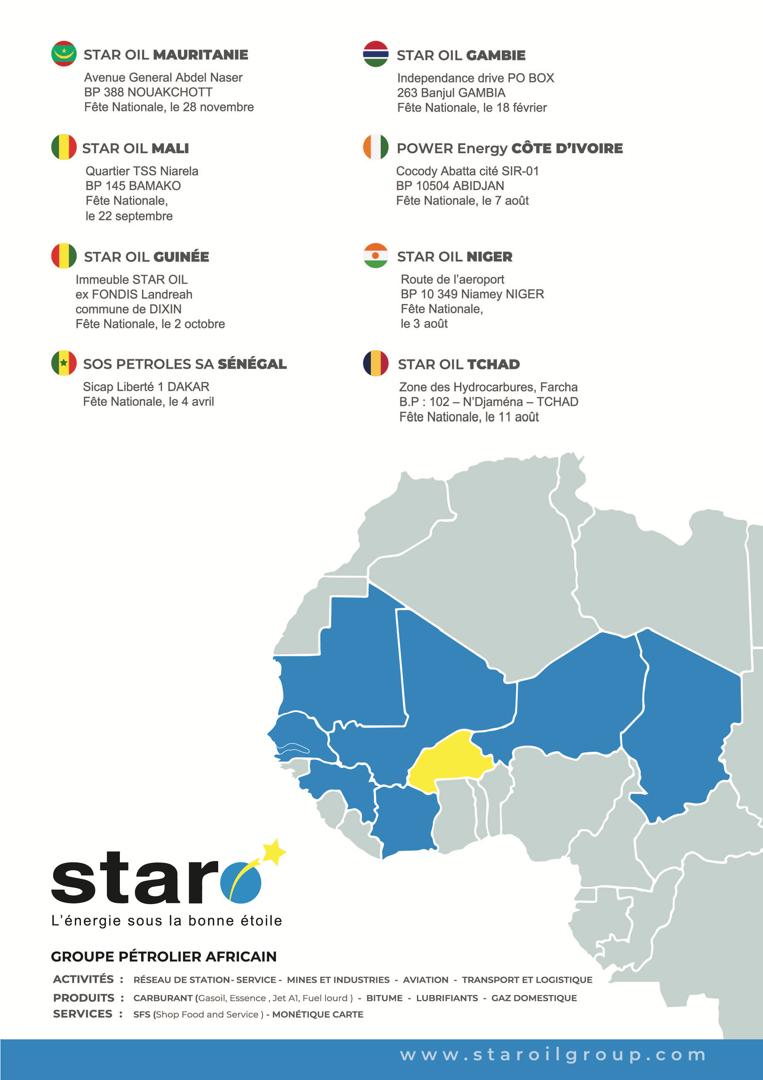

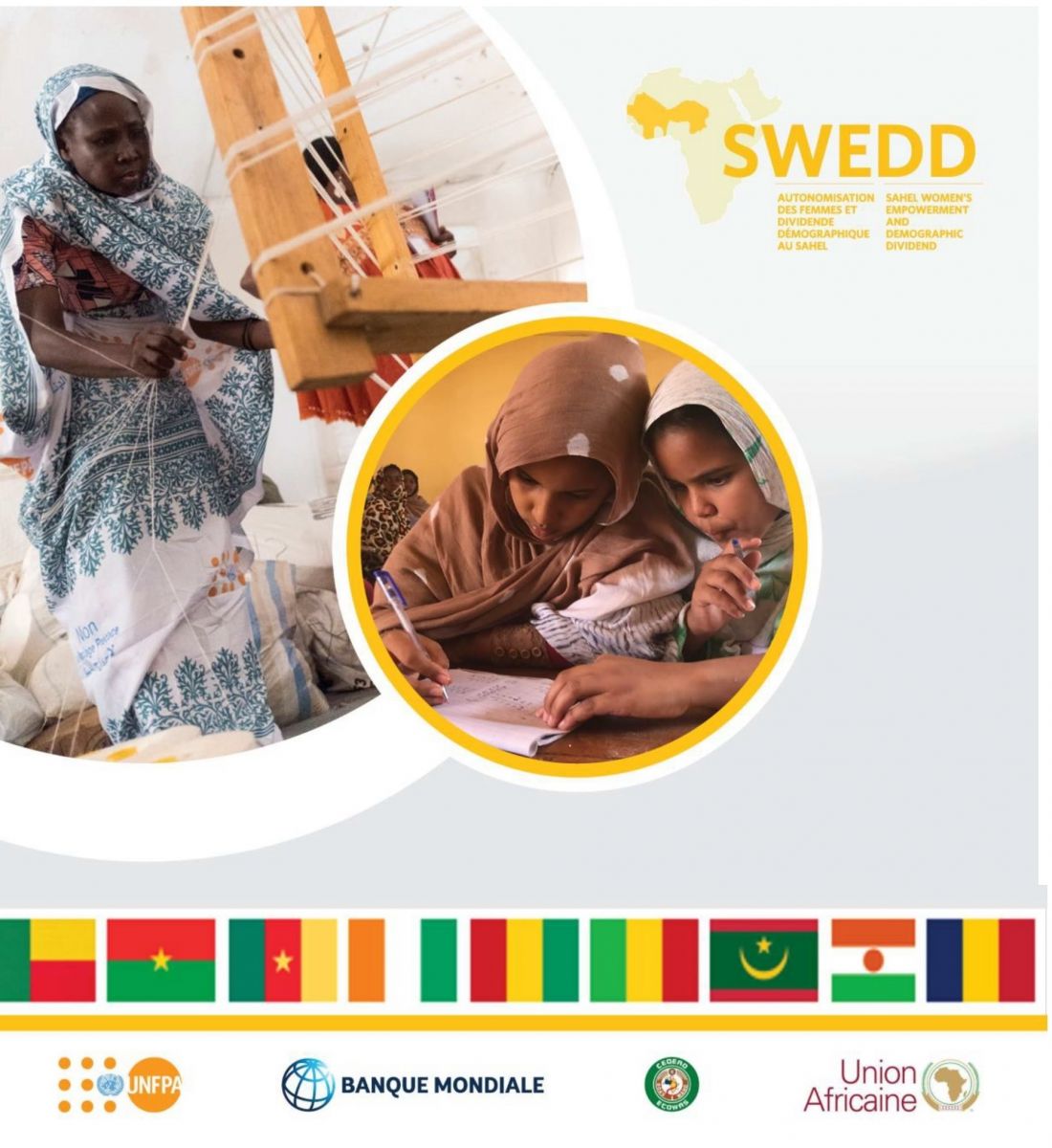
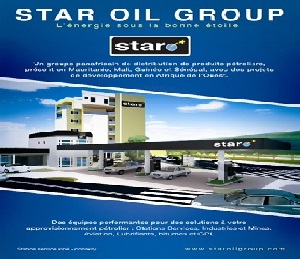




.gif)