
Les racines du mécontentement
Depuis plusieurs mois, un courant d’insatisfaction sourde se propage à travers le pays. Les jeunes Marocains, en particulier, semblent être à bout, non pas uniquement des promesses non tenues, mais du contraste de plus en plus frappant entre ambitions affichées et réalités quotidiennes. Chômage élevé, infrastructures publiques insuffisantes, coût de la vie qui pèse lourdement, disparités régionales accentuées.
voici quelques-uns des motifs de frustration.
En toile de fond, des tensions sociales exacerbées par ce que beaucoup perçoivent comme un déséquilibre dans les priorités de l’État : des investissements spectaculaires (stades, grands événements internationaux, infrastructures pour la Coupe du monde 2030) pendant que les hôpitaux et les écoles manquent de moyens élémentaires.
Le décès de plusieurs femmes à l’hôpital régional d’Agadir, imputé à des dysfonctionnements du système de santé, a agi comme une étincelle déclencheuse. La colère, longtemps contenue, a trouvé un exutoire.
L’irruption du mouvement “GenZ 212”
C’est dans ce contexte que le collectif “GenZ 212” a pris corps — un nom symbolique, une génération née après 2000, connectée, porteuse d’exigences différentes. Sans structure politique formalisée, ce mouvement s’est appuyé sur les réseaux sociaux (TikTok, Discord, etc.) pour mobiliser. Les rassemblements ont commencé dans les grandes villes telles Rabat, Casablanca, Tanger, etc. Aujourd’hui étendus, traversant les barrières urbaines/rurales, sociales et régionales.
Les revendications ?
Amélioration des services publics (santé, éducation), réduction des inégalités sociales, transparence et responsabilité dans la gestion du bien public. Beaucoup aussi dénoncent ce qu’ils perçoivent comme des choix gouvernementaux mal orientés, au profit de grands projets davantage visibles (et médiatisables) que réellement utiles pour la vie quotidienne.
L’escalade et la réponse de l’État
La contestation a pris une tournure plus grave ces derniers jours : des affrontements avec les forces de l’ordre, des blessés, des arrestations massives, et, malheureusement, des morts dans certaines localités (par exemple à Lqliaa) pendant des incidents violents.
L’État, de son côté, oscille entre apaisement et fermeté. Officiellement, le gouvernement déclare entendre les “exigences légitimes”, prêt au dialogue institutionnel, tout en justifiant le maintien de l’ordre. Le Premier ministre Aziz Akhannouch a lui-même appelé à la retenue, mais aussi salué le travail des forces de sécurité dans certaines circonstances.
Les signes d’une économie qui se renforce malgré les fissures
Alors que le tumulte social monte, l’économie marocaine montre des signes de vigueur préoccupante, mais porteurs d’espoir.
* Au deuxième trimestre 2025, le taux de croissance du pays atteint 5,5 %, bien au-dessus des résultats de la même période en 2024.
* La hausse est tirée par la demande intérieure, encouragée par une inflation maîtrisée et par des mesures fiscales ou sociales en faveur des ménages, ainsi que par un redressement du secteur agricole, même si certains sous-secteurs comme la pêche subissent des revers.
* Parallèlement, les secteurs non agricoles comme l’industrie et les services contribuent fortement à la dynamique, témoignant d’un tissu productif qui tente de se diversifier.
Mais il y a un revers : l’emploi ne suit pas, ou du moins pas de façon satisfaisante. Le chômage des jeunes reste élevé, l’informalité tient bon, les écarts territoriaux se creusent. La pauvreté extrême est officiellement très basse, mais la vulnérabilité économique, c’est-à-dire la fragilité face aux chocs, concerne un nombre beaucoup plus élevé de personnes. Le pouvoir d’achat, quant à lui, est soumis à de fortes pressions, notamment autour du logement, des produits alimentaires et des services de base.
Le défi du modèle politique : crédibilité, légitimité, réforme
Ce que révèle la crise actuelle montre peut-être plus que ce qu’elle manifeste. C’est la fatigue accumulée, le sentiment que le compromis social traditionnel (promesses d’élévation économique, stabilité politique, progression sociale) vacille.
Les partis politiques, les institutions représentatives, sont perçus par beaucoup comme déconnectés, trop lents à réagir, ou incapables de proposer une direction claire. Certains leaders de l’opposition évoquent une “fracture politique grave”, voire un risque de dégénérescence de la légitimité des gouvernants si les attentes ne sont pas satisfaites par des actes tangibles et pas seulement par des discours.
Le calendrier électoral à venir (notamment les échéances municipales/régionales ou nationales), associé aux grands chantiers dont particulièrement les préparatifs de la Coupe du monde de football 2030 met sous les projecteurs les choix budgétaires et les priorités de l’État. Les investissements fastueux sont de plus en plus scrutés à l’aune de leur impact réel sur les conditions de vie. Si le prestige international reste un jeu politique important, les citoyens exigent qu’il ne se fasse pas au détriment des urgences sociales.
Scénarios à venir : quelles issues possibles ?
Plusieurs trajectoires s’ouvrent, selon la capacité du gouvernement mais aussi de la société civile à gérer la crise.
Vers une redéfinition du contrat social
Le Maroc se trouve à un carrefour. La croissance est là, les projets ambitieux sont nombreux, la visibilité internationale s’améliore. Pourtant, l’explosion des attentes données à la jeunesse, la demande de justice sociale, l’impatience face aux lenteurs structurelles alors tout cela crée une tension qui pourrait devenir critique.
Ce qui est en jeu dépasse la simple gouvernance ou la gestion économique. C’est le contrat social implicite entre les citoyens et l’État : “Tu me permets de croire en un avenir meilleur, je te donne ma confiance.” Si ce contrat s’use, s’il devient synonyme pour beaucoup d’amertume et d’injustice, alors le risque n’est plus l’instabilité superficielle, mais une crise de confiance plus profonde.
L’avenir dépendra des choix politiques dans les mois qui viennent. Des choix réellement audacieux, cohérents, honnêtes. Si le Maroc parvient à transformer ses urgences en orientations durables, il peut non seulement répondre à cette vague de contestation, mais poser les bases d’un modèle plus solidaire, plus équilibré — et peut-être plus résilient face aux défis du XXIᵉ siècle.
S.Cheine




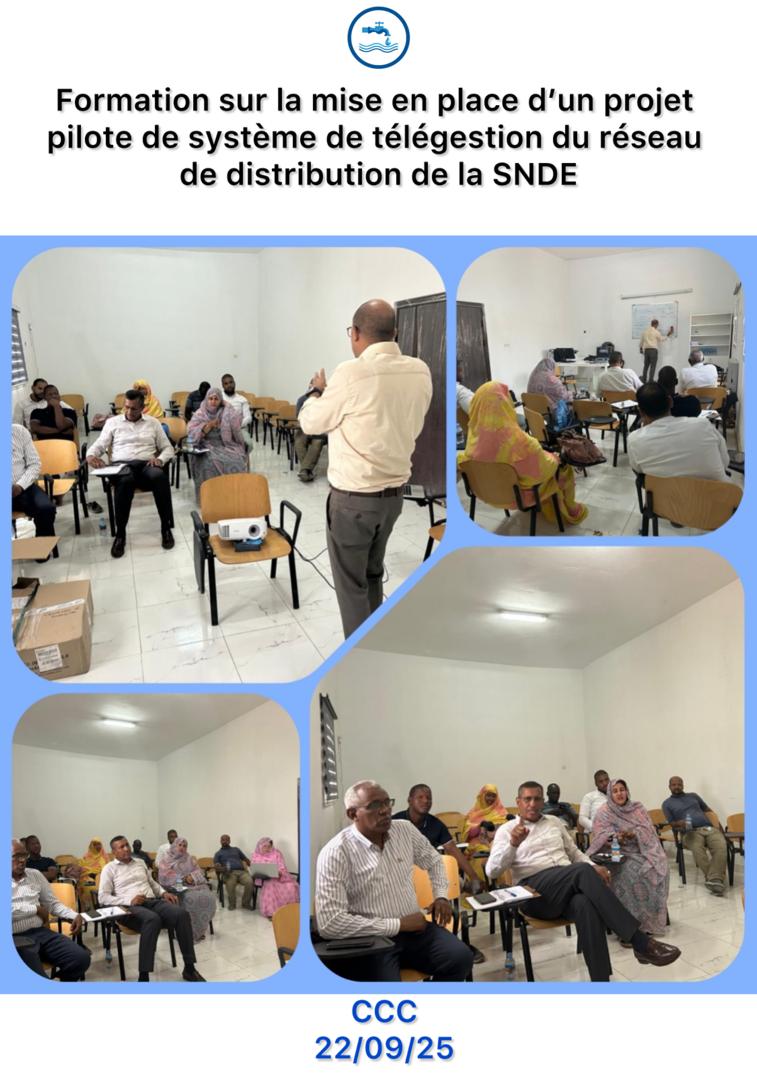
.gif)
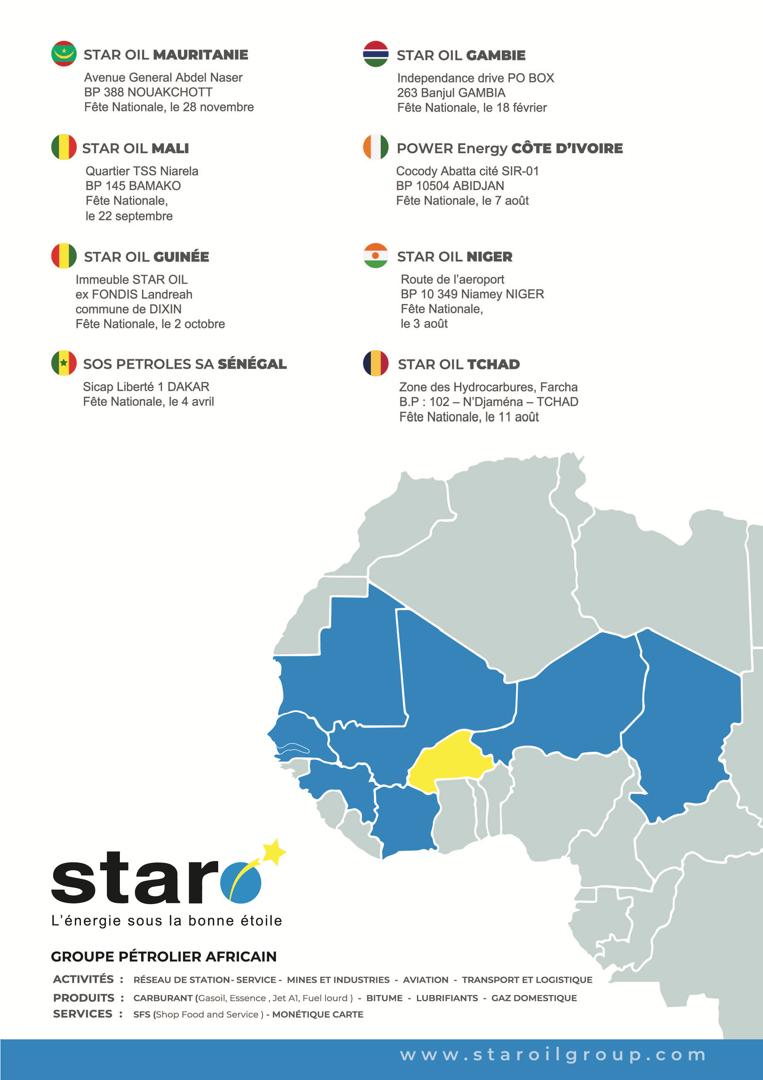

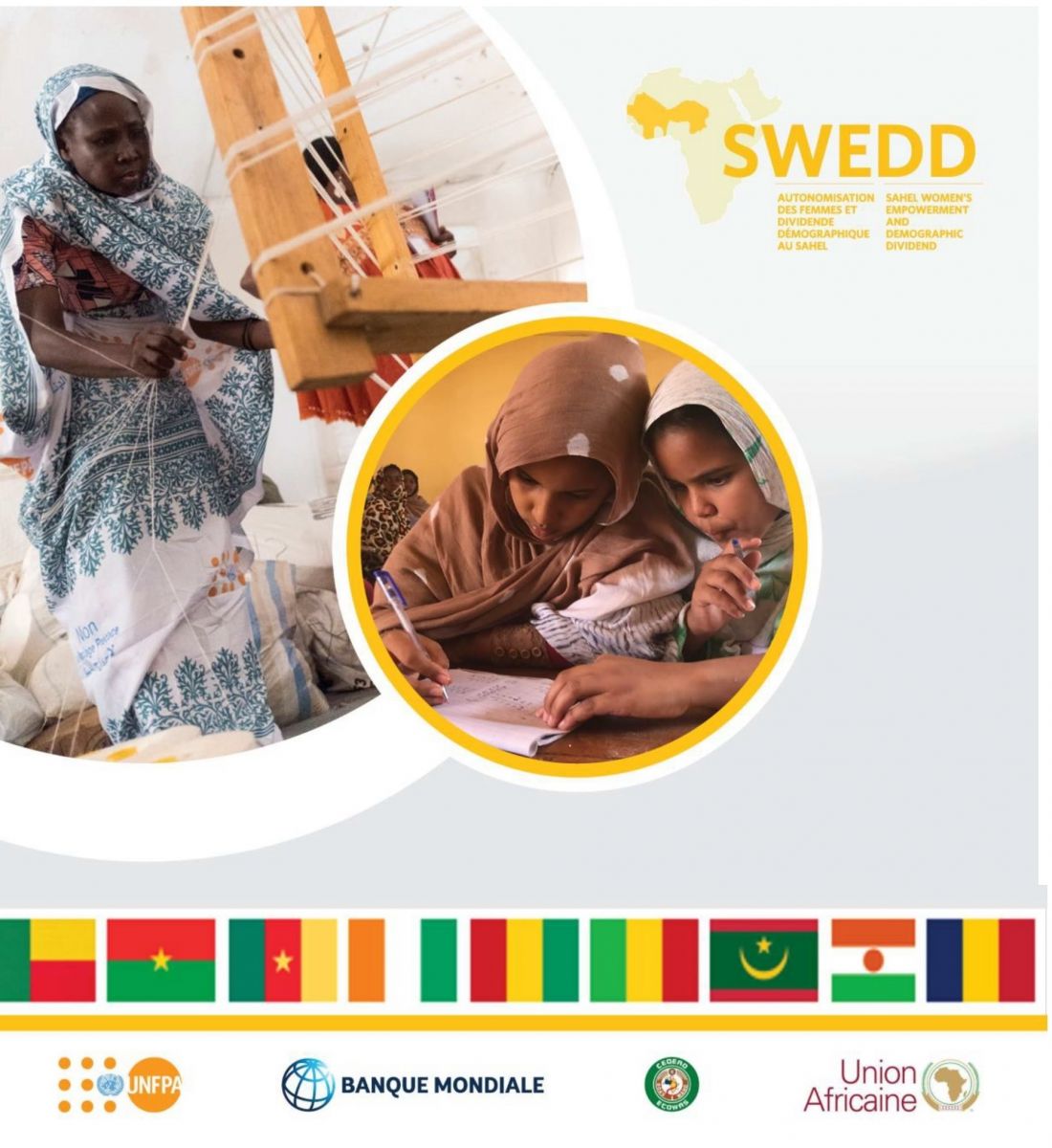
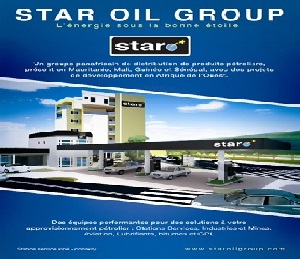




.gif)