
Sous ce titre, je compte aborder des sujets nationaux, locaux et personnels. Je commence aujourd’hui par une question nationale qui m’a toujours profondément préoccupé : les frontières orientales et méridionales de notre pays, là où se trouve ma région, le Hodh El Gharbi, et où j’ai passé mes vacances, tout en suivant avec inquiétude ce que les médias rapportent sur la quasi-désintégration de l’État frère du Mali.
En réfléchissant à l’avenir de ces zones et aux politiques successives de l’État, il m’est apparu que la politique sécuritaire frontalière du président Moktar Ould Daddah mérite aujourd’hui d’être rappelée et réhabilitée, tant elle offre des leçons précieuses pour un avenir plus sûr.
Dans l’histoire de la Mauritanie, cette expérience demeure un modèle unique dans la construction d’un système de sécurité cohérent, notamment dans les régions frontalières qui constituent la veine vitale de la stabilité et de la sécurité nationales.
Le président fondateur avait compris dès le départ que la sécurité ne s’impose pas d’en haut, mais se construit à partir de la base, et que les habitants des zones frontalières ne sont pas un fardeau pour l’État, mais son bouclier vivant et son soutien naturel.
Moktar Ould Daddah avait mis en place une approche intégrée fondée sur l’exploitation des réalités du terrain et sur le renforcement du rôle des autorités traditionnelles, qui jouissaient d’un prestige et d’une influence sociale considérables.
L’État associait ces notables à tout ce qui concernait la sécurité et le développement de leurs régions, dans un cadre de partenariat véritable entre l’administration, les forces de sécurité et la communauté locale.
Dans sa vision, la sécurité n’était pas un objectif isolé, mais une composante essentielle d’un projet national global liant développement et stabilité.
Les zones frontalières bénéficiaient alors d’écoles, de dispensaires, de programmes d’accès à l’eau et d’infrastructures de base, ce qui permettait aux citoyens de percevoir l’État non pas comme une autorité répressive, mais comme un partenaire et un protecteur.
Sous cette approche, les tribus et communautés vivant le long des frontières jouèrent un rôle central dans la sécurisation de leurs territoires, animées par le sens du devoir et de l’appartenance, et non par la crainte ou l’intérêt personnel.
Cette politique porta ses fruits pendant de longues années : la sécurité régna, la coopération s’installa et les populations restèrent attachées à leurs terres.
Mais qu’est-ce qui a changé aujourd’hui ?
La perte d’influence des autorités traditionnelles, l’excès de centralisation du pouvoir et la marginalisation des zones frontalières sur le plan du développement ont affaibli l’efficacité du système sécuritaire.
S’y ajoute un manque de coordination régulière entre les autorités civiles et militaires, ce qui fait que l’État agit souvent après les événements, plutôt qu’en prévention.
Il est grand temps de raviver cette approche participative et éclairée, fondée sur l’intégration de la sécurité et du développement, et sur l’implication des populations locales dans la stabilité de leurs régions.
La connaissance du terrain, le sentiment d’appartenance et les liens tribaux peuvent devenir — s’ils sont bien utilisés — des instruments de force et de prévention face à toute menace.
Revenir à l’esprit de la politique de Moktar Ould Daddah n’est pas un simple regret du passé, mais un investissement dans une expérience nationale éprouvée, et le moyen le plus sûr de retrouver une sécurité durable, fondée sur des frontières stables, développées et pleinement intégrées à l’État.
Brahim Ould Saleh
Ancien conseiller au CSA
Nouakchott,
Le 14 octobre 2025




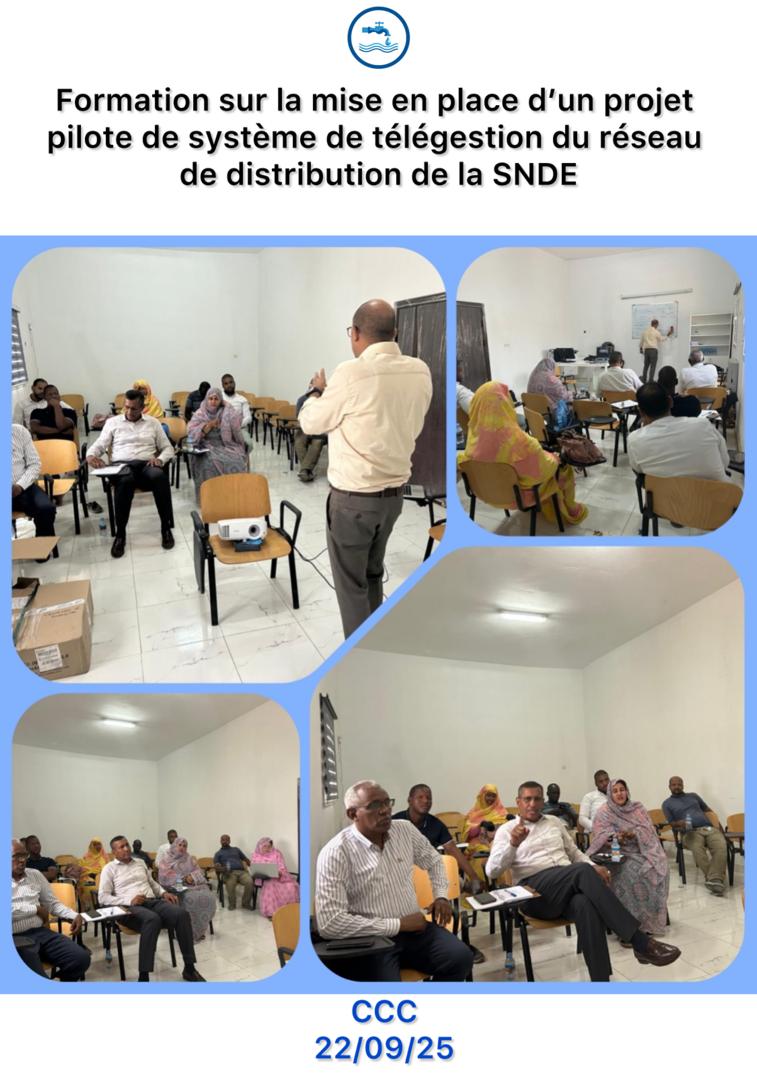
.gif)
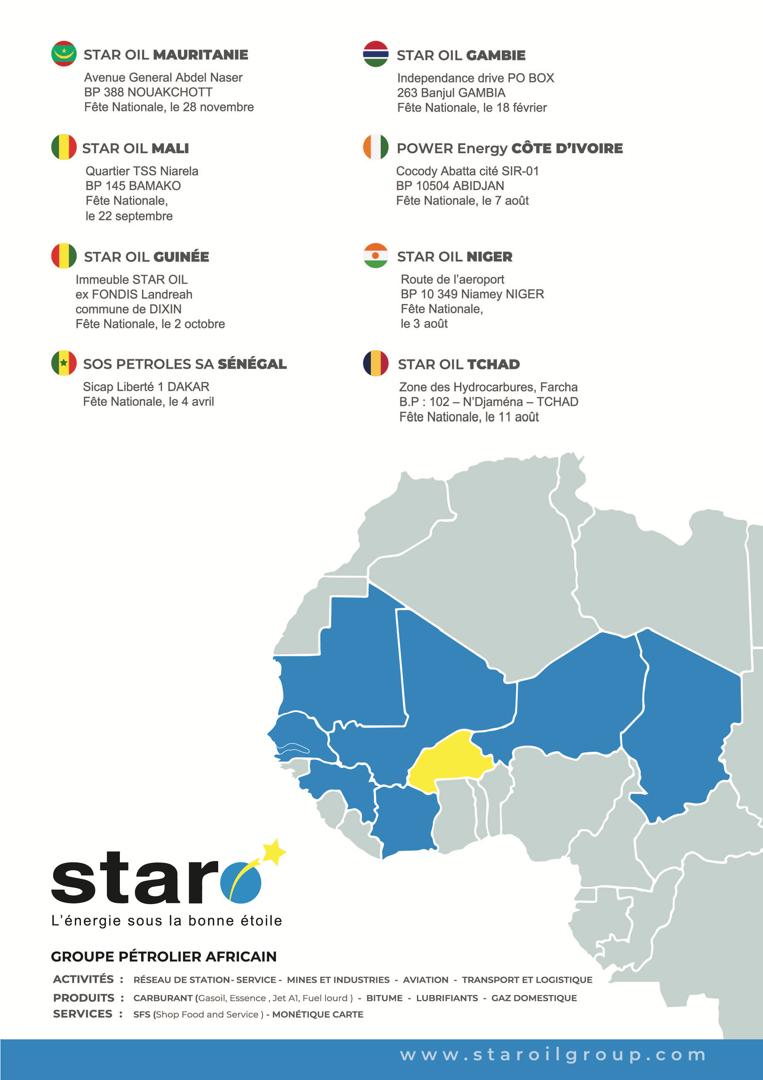

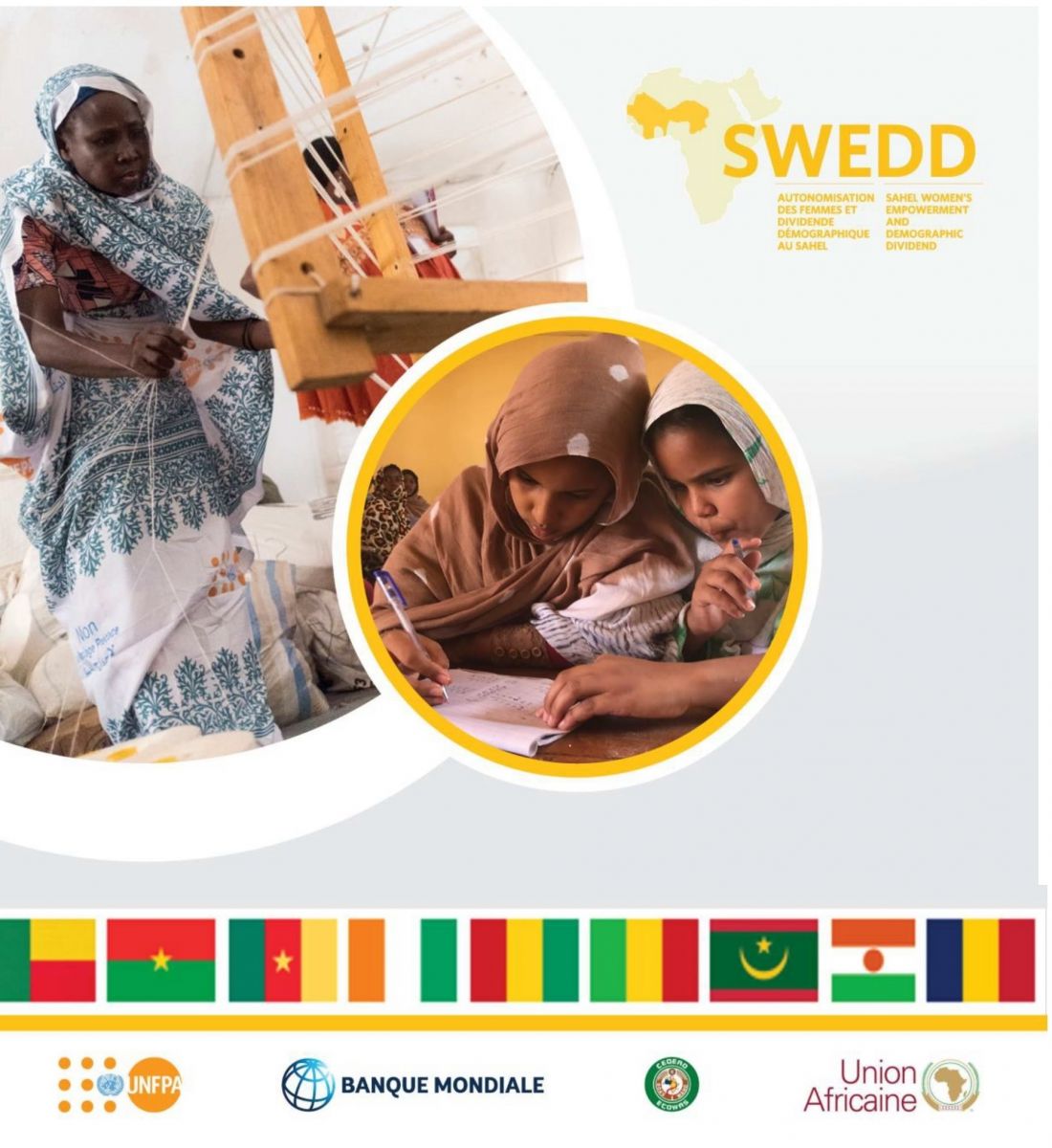
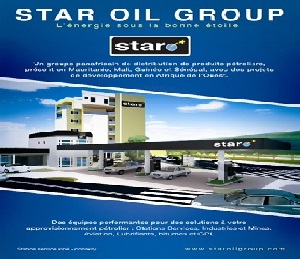




.gif)