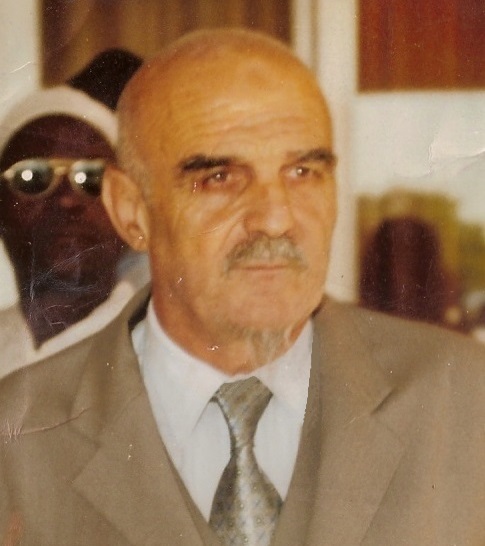
Le waqf, dont toutes les communautés non-musulmanes ont profité au sein de l’Islam, a des sources plus universelles et peut être aisément intégré dans la législation internationale. Dans mes précédents travaux à ce sujet (1), j’ai avancé, pour désigner celui-là dans un tel cadre, l’expression « Immobilisation Pérenne de la Propriété » (IPP), et, en ce qui concerne la détermination de la personne morale à qui seraient attribués les bénéfices de l’IPP, notamment celle de « Solidarité de Proximité » (SP). De type ONG mais avec une dimension territoriale tout aussi clairement affirmée que limitée, basée sur la notion de voisinage – une réalité commune à tout un chacun en ce monde… – cet également nouveau concept juridique à définir le plus exactement possible a une histoire particulière en Islam dont les fondements se sont attachés à définir et encadrer les droits du voisin, en valorisant particulièrement le devoir du Musulman envers celui-ci, sans distinction de religion (2). Cette dernière précision va loin.
Coopération interculturelle impérative
Aussi pénible et critiquable soit le processus qui a conduit à la mondialisation, celle-ci est désormais établie. Moins par ses réalisations positives – c’est une évidence chaque jour plus flagrante, hélas… – que par ses conséquences négatives, particulièrement environnementales. C’est dans ce contexte que l’Islam doit agir, en apportant au Monde entier des outils susceptibles d’atténuer ces tares, avant de les supprimer, s’il est possible ; et en commençant par mettre en œuvre ceux-ci au sein de ses propres populations. Au vu de la disparité criante de développement entre celles-ci, une telle ambition nécessite une politique collectivement pensée dans le cadre global de l’Oumma, soutenue financièrement par ses magnats et institutions spécifiques, puis appliquée au jour le jour, jusque dans les moindres recoins de ses territoires, dans une démarche participative, via tout un réseau patiemment tissé de communications diverses, instaurant concrètement l’impératif rétablissement d’une coopération entre le global et le local. Mais, même à admettre qu’un tel mouvement soit possible – et cette éventualité est déjà lourde de multiples interrogations… – suffira-t-il à régler tous les problèmes environnementaux qui menacent la vie sur Terre ? Certainement pas et cette certitude nous oblige : faute de nombre, d’union et de moyens, nous avons à réinventer nos rapports avec tous les non-musulmans.
Car nous sommes bel et bien tous embarqués sur le même navire et, si les implications de cette évidence ne sont pas, partout ni par tout le monde, perçues dans leur globalité, elle nous impose, à nous musulmans, un effort particulier ; à chacun d’entre nous, à l’endroit même où il se trouve. Effort, en arabe ijtihad, qui signifie également assiduité, étude, interprétation des signes… Nous voilà donc amenés à nous rappeler le sens fondamental de la racine verbale « jahada » : faire effort ; dont est notamment tiré le mot « jihad » : lutte, combat, guerre sainte… En l’occurrence de notre nouvelle tâche : revoir en profondeur nos relations avec notre milieu de vie ; le travail à fournir est tout aussi multiple que complexe. S’il se pose très différemment, selon qu’on discute entre grands de ce monde ou entre voisins d’une quelconque banlieue, il n’est pas moins compliqué, partout, par une très grande diversité d’intérêts et de contextes. À ne s’en tenir, par exemple, qu’aux relations de voisinage à Gabu, une ville forestière bissau-guinéenne de quinze mille habitants, aussi pauvres, sinon plus, que ceux de la banlieue de Nouakchott, en quoi l’effort des premiers est-il audible à l’entendement des seconds ? Tous musulmans, ceux-ci ont-ils plus de chances de réussir à s’organiser collectivement dans la gestion de leur environnement que ceux-là, divisés en musulmans, chrétiens et animistes ?
Ian Mansour de Grange
NOTES
(1) : D’ICI À LÀ », Éditions Joussour Abdel Aziz, Nouakchott, 2025, pp. 332-338.
(2) : Voir notamment, à partir du verset de base 4 : 36 du Saint Coran : « […] Agissez avec bonté envers (vos) père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain […] » ; les hadiths suivants : « N’est pas de ma communauté celui qui s’endort repu, sachant son voisin affamé » ; « N’est pas croyant celui qui ferme sa porte à son voisin, pour préserver sa femme et ses biens » ; ou bien : « Il n’est pas croyant celui dont le voisin redoute les méfaits » ; ou encore : « Le Musulman endure avec patience la nuisance de son voisin ».
(3) : (1868-1963), sociologue, historien, éditorialiste, directeur de publication et romancier américain.
(4) : (1850-1911), homme politique, anthropologiste, économiste et intellectuel haïtien.
(5) : (1844-1913), Négus du Choa, puis « roi des rois » d'Éthiopie.




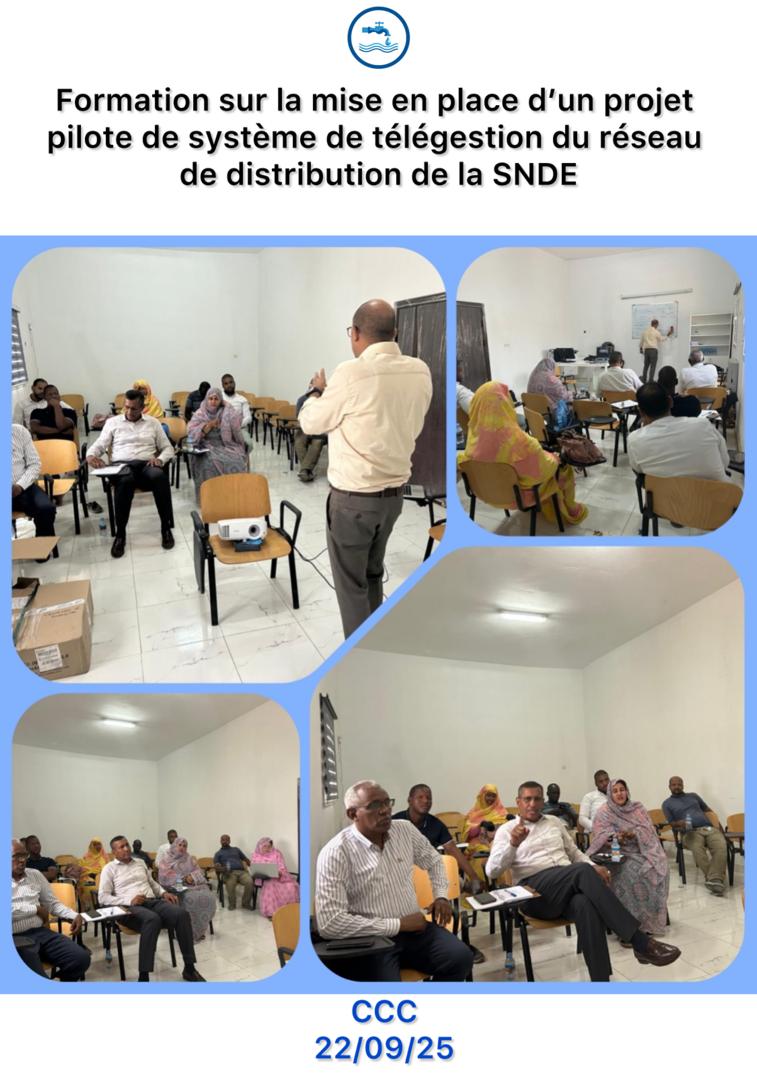
.gif)
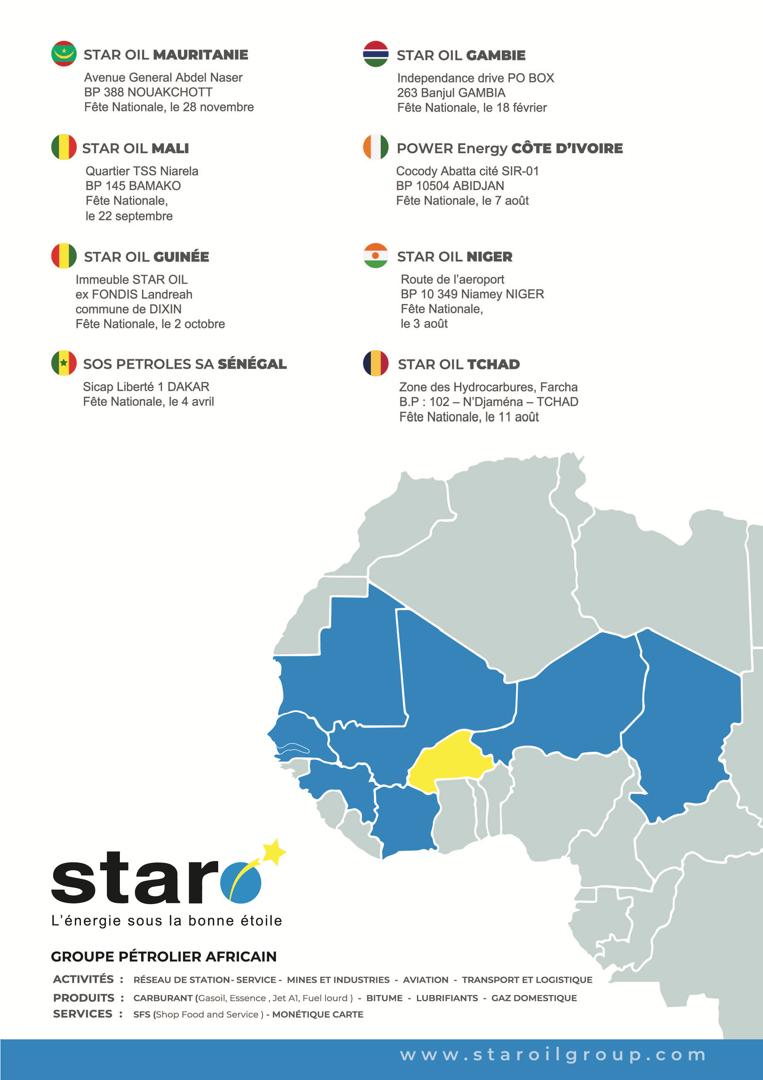

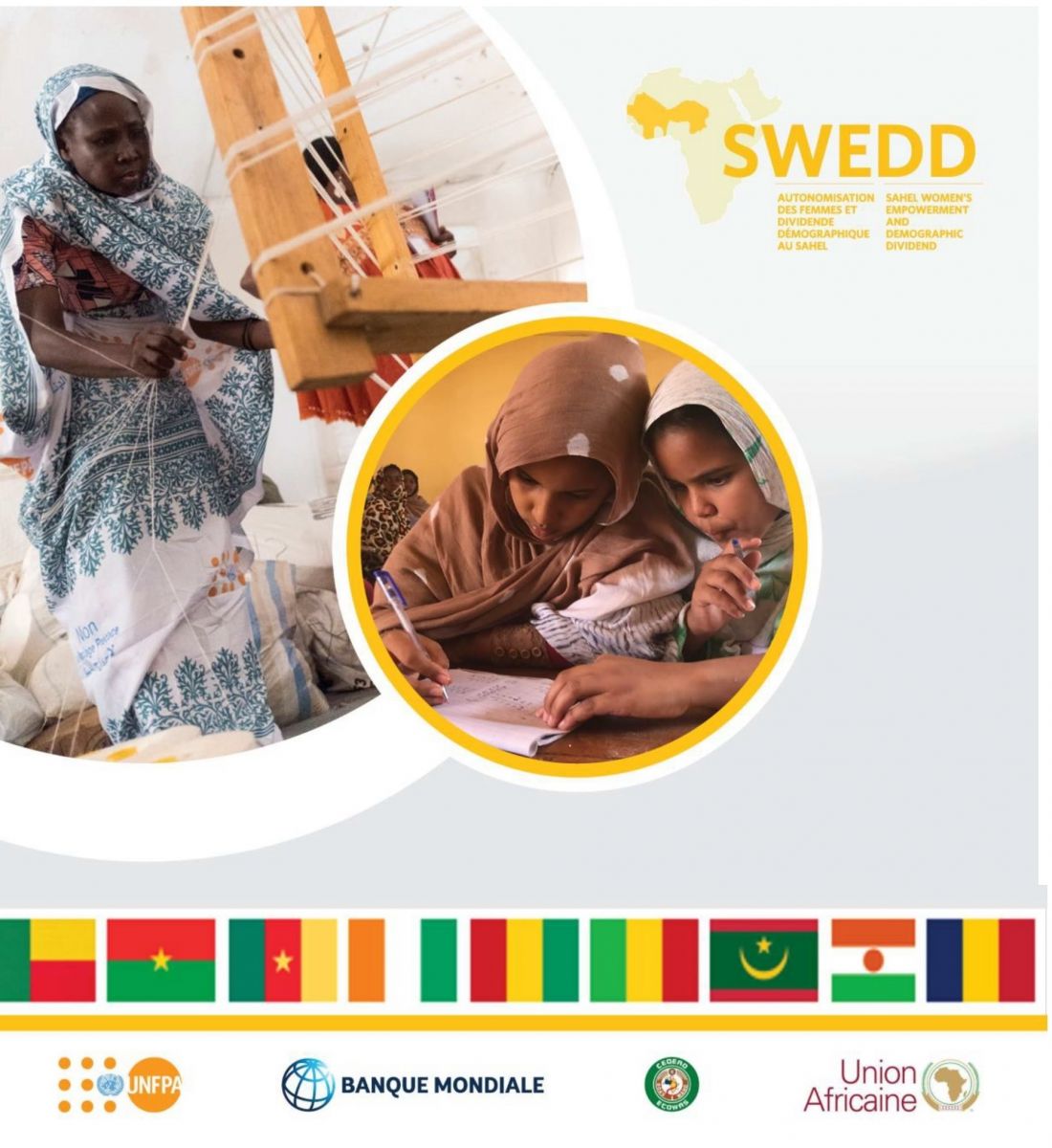
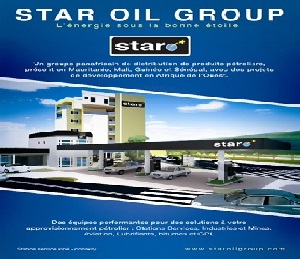




.gif)