Pour la seconde fois en plus de trois décennies, la Cour des comptes de Mauritanie a rendu public son rapport général — couvrant les exercices 2022 et 2023 — après celui publié en 2023 pour les années 2019 à 2021. Ces publications ont provoqué un large débat national, signe d’une société plus attentive à la gestion des deniers publics. Les réactions indignées de l’opinion publique, relayées par la presse et la société civile, ont mis en lumière la soif de transparence et de justice financière. L’intervention du président de la Cour pour apaiser les tensions n’a fait que renforcer la pression populaire et pousser le gouvernement à réagir, confirmant la portée politique et démocratique du rapport. Sa publication, rendue obligatoire par l’article 67 de la loi organique n°2018-032 du 20 juillet 2018, marque une avancée majeure vers la redevabilité et la transparence de la gestion publique.
Sur la forme, le rapport, d’environ 400 pages, est bien structuré et complet, mais il gagnerait à inclure un résumé exécutif clair présentant les principaux constats, risques budgétaires et recommandations. L’ajout de tableaux comparatifs, de graphes de performance et de synthèses sectorielles renforcerait sa lisibilité pour les parlementaires, journalistes et citoyens. Sur le fond, la Cour réaffirme son rôle constitutionnel d’institution indépendante et son alignement sur les normes de l’INTOSAI. Elle documente avec rigueur de nombreuses irrégularités dans des secteurs stratégiques — mines, santé, éducation, infrastructures — et formule des recommandations concrètes : renforcement du contrôle interne, respect du code des marchés publics, meilleure planification budgétaire et rationalisation de la dépense.
Inefficience budgétaire
Cependant, le rapport n’émet pas d’opinion qualifiée sur la sincérité et la fiabilité des comptes publics, ce qui constitue sa principale limite. La certification des comptes est pourtant l’un des piliers du mandat de la Cour, car elle conditionne la crédibilité du contrôle parlementaire. En l’absence de certification indépendante du Compte général de l’État (CGE), les données sur lesquelles le Parlement se fonde pour adopter la loi de règlement — instrument clé du contrôle démocratique du budget — ne sont pas validées par une autorité technique autonome. Le Parlement vote alors une loi basée sur des chiffres produits par le ministère des Finances, sans assurance raisonnable quant à leur exactitude, ce qui vide de substance le principe même de contrôle budgétaire. Dans la pratique internationale, la certification des comptes constitue le chaînon entre la redevabilité administrative et la responsabilité politique : elle permet aux députés de juger le gouvernement sur des données fiables, et au public de mesurer l’usage réel des ressources collectives.
Le Titre I du rapport, consacré à l’exécution des lois de finances, reproduit fidèlement les données du ministère des Finances, mais sans signaler explicitement les limites d’audit ni formuler d’opinion. La Cour évoque une faible efficacité de la planification budgétaire, une exécution lente des crédits d’investissement et de multiples virements de crédits, autant d’indices d’inefficience budgétaire. Mais faute de certification, ces constats n’ont pas la même valeur probante que dans un audit complet. C’est sur ce point que la Cour devrait concentrer ses efforts : la mise en place d’un dispositif de certification des comptes publics à partir d’un bilan d’ouverture fiable, accompagné d’un contrôle interne robuste et d’une comptabilité patrimoniale normalisée.
Le rapport met aussi en lumière les limites du contrôle juridictionnel, pourtant compétence originelle et domaine réservé de la Cour. Celle-ci reconnaît n’avoir commencé à juger les comptes de certains comptables publics qu’en 2023, sans publier ni le nombre d’arrêts de débet ni les montants recouvrés. Ce silence entretient la perception d’impunité et alimente la défiance du public. Or, la loi organique (article 30) est explicite : lorsque la Cour découvre, au cours d’un contrôle, des faits susceptibles de constituer une faute de gestion, elle doit en informer le Procureur général pour qu’il saisisse la chambre compétente. L’absence de suites judiciaires après des contrôles documentant des irrégularités graves interroge donc sur la portée réelle du mandat juridictionnel.
Un contrôle interne plus efficace
Le rapport aborde enfin la question du contrôle interne, qu’il juge « globalement faible et peu structuré ». La Cour observe que la majorité des ministères et établissements publics ne disposent pas de dispositifs formalisés ni de supervision efficace, et que la coordination entre les inspections internes, l’Inspection générale de l’État et l’Inspection générale des Finances reste insuffisante. Bien qu’elle évalue ces insuffisances, la Cour ne formule pas d’opinion qualifiée sur l’efficacité du système national de contrôle interne, faute de mandat explicite de certification et d’un cadre méthodologique standardisé. Elle recommande néanmoins d’en faire une priorité, condition préalable à la fiabilité des comptes et à la future certification. Pour avoir été l’un des rédacteurs de l’Instruction Générale du gouvernement qui a créé les inspections internes en 1993, je suis de l’avis que le contrôle interne est beaucoup plus efficace que le contrôle externe (type Cour des comptes) dans la préservation du patrimoine de l’Etat car il agit en amont et au cours des processus de gestion publique.
Enfin, la loi organique de 2018, en élargissant considérablement les compétences de la Cour — évaluation des politiques publiques, contrôle des entreprises et collectivités —, a créé un écart entre son mandat et ses capacités effectives. Si la Cour dispose d’un noyau solide de magistrats financiers, elle manque de profils techniques spécialisés (auditeurs IT, experts comptables, économistes sectoriels) et de moyens logistiques modernes. La perspective d’une certification des comptes publics d’ici 2026, bien qu’ambitieuse et symboliquement importante, paraît difficile à atteindre sans renforcement significatif des effectifs, de la formation et des outils numériques.
Pour consolider son rôle dans la gouvernance publique, la Cour des comptes gagnerait à se recentrer sur ses missions fondamentales — le contrôle juridictionnel et la certification des comptes — et à s’appuyer davantage sur le réseau national de contrôle interne. La complémentarité entre ces deux niveaux — interne et externe — est la clé d’un système de redevabilité performant. La certification donnerait au Parlement et à la nation une garantie indépendante sur la sincérité des finances publiques, transformant ainsi le rapport de la Cour des comptes en véritable outil de gouvernance démocratique, et non plus seulement en instrument d’alerte.
Mohamed Ould Ahmed Tolba



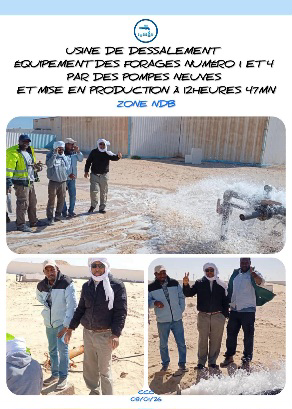

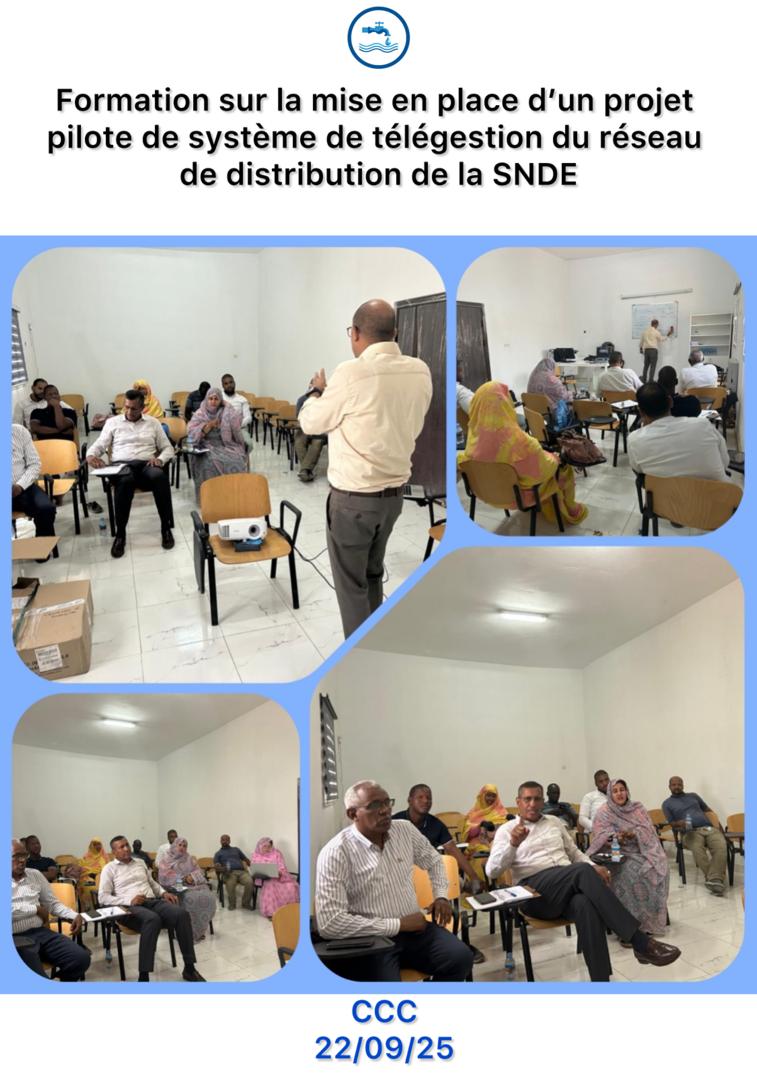
.gif)
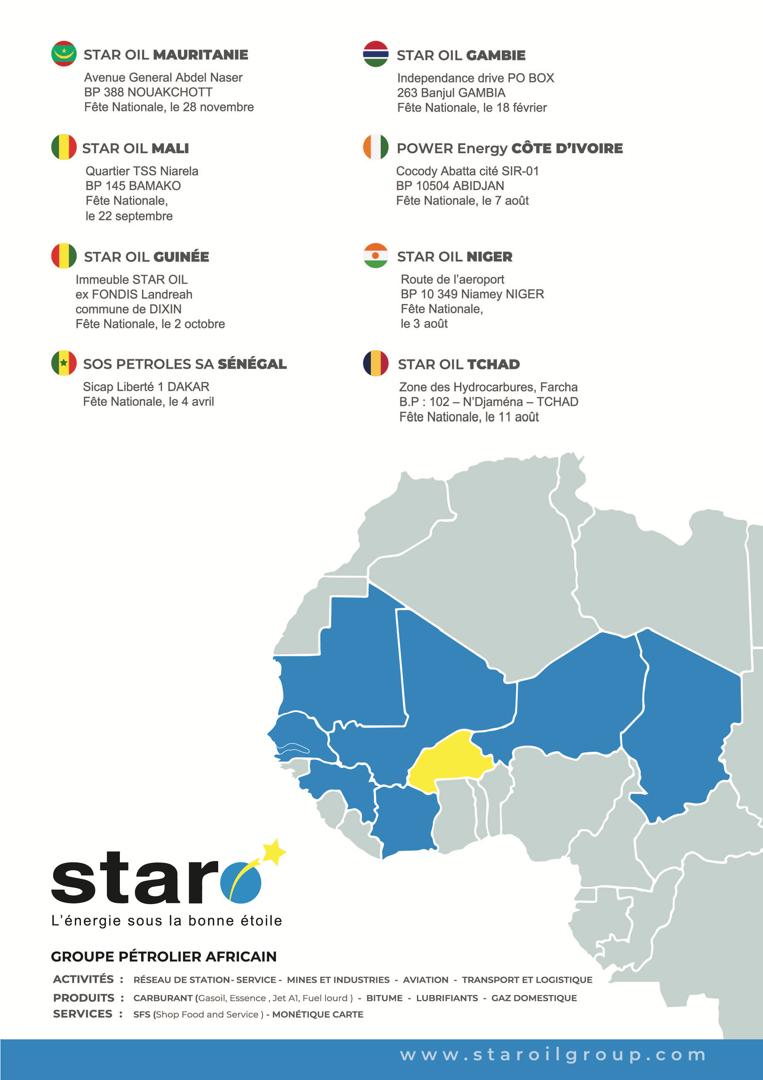

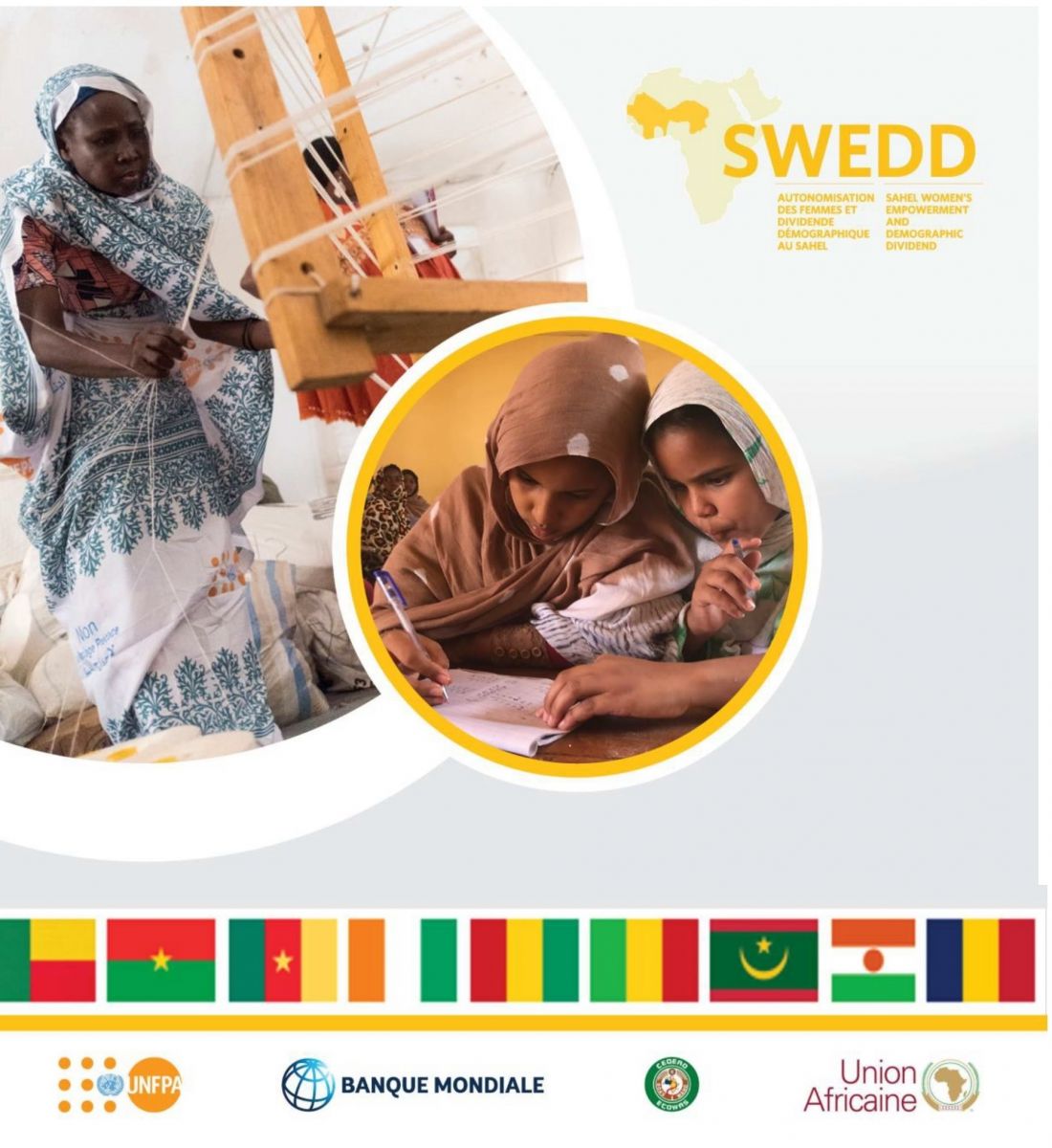
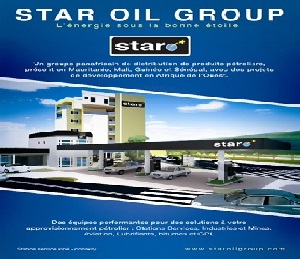




.gif)