
Introduction
Cependant, l’analyse de ce rapport constitue un exercice délicat, dans la mesure où il émane de l’institution supérieure de contrôle des finances publiques, censée incarner une rigueur méthodologique exemplaire, eu égard au processus d’élaboration auquel il est soumis, notamment à travers le Comité du Rapport et des Programmes et la Chambre du Conseil.
La complexité de l’exercice tient également à la nature même du rapport, qui aborde des thématiques interdépendantes nécessitant une lecture approfondie et une analyse équilibrée.
L’examen de ce rapport conduit ainsi à situer le contexte juridique et institutionnel dans lequel il s’inscrit (I), avant d’analyser son approche méthodologique et son contenu analytique (II).
1.Contexte juridique et analytique du RGA
2. Réformes structurelles des finances publiques
Le RGA 2022-2023 s’inscrit dans le cadre de la réforme du système de gestion des finances publiques engagée à la suite de la première évaluation PEFA (2008), qui a permis d’établir un diagnostic global du dispositif financier public et conduit à l’adoption du premier Schéma Directeur de Réforme des Finances Publiques (SD-RFP 2012-2016).
Ce cadre a posé les fondations institutionnelles et techniques de la modernisation de la gestion budgétaire, consolidées par les SD-RFP 2021-2025 et 2025-2030, inscrits dans une logique de continuité, de performance et de transparence, et appuyés par des évaluations spécialisées telles que PIMA, TADAT et DeMPA.
1. Cadre budgétaire et comptable rénové
Au cœur du processus de modernisation des finances publiques, la loi organique n° 2018-039 relative aux lois de finances (LOLF) constitue la pierre angulaire du nouveau cadre budgétaire, comptable et de performance de l’État.
Elle a instauré la budgétisation par programmes, fondée sur la performance et les résultats, ainsi que la programmation pluriannuelle à travers les documents de cadrage budgétaire (DPBMT, CDMT-m). Elle a également introduit une réforme comptable majeure, alignant la comptabilité de l’État sur le principe des droits constatés (art. 66).
Cette évolution s’est traduite par la révision du Plan Comptable de l’État (2022) et de la Nomenclature Budgétaire et Comptable de l’État (NBCE 2024), renforçant la cohérence entre comptabilité budgétaire et comptabilité générale, et ouvrant la voie à l’établissement du bilan d’ouverture de l’État.
Dans le prolongement de la LOLF, la réforme des entités publiques opérée par la loi n° 2025-002 a modernisé les modes de gestion des établissements et sociétés publics à travers :
* L’adoption de la comptabilité commerciale.
* La certification des comptes par des experts-comptables membres de l’Ordre national
* Une autonomie renforcée des organes de gestion et la sélection d’administrateurs indépendants.
* L’harmonisation avec les normes IFRS et le renforcement du contrôle interne.
Sur le plan fiscal, la loi n° 2019-018 portant Code général des impôts a refondu en profondeur le régime d’imposition directe : introduction de l’IS et de l’IBAPP, généralisation de la comptabilité commerciale, adoption de nouvelles liasses fiscales normalisées (2025) et révision du Code des douanes (loi n°2017‐035). Ces mesures ont été accompagnées d’une nouvelle doctrine administrative (circulaire DGI 2019) favorisant la clarté et la conformité.
3. Redéfinition du rôle institutionnel de la Cour des comptes
Dans ce cadre global, la Cour des comptes a été réorganisée par la loi organique n° 2018-032, fusionnant les anciens textes de 1993 et élargissant ses attributions :
* Établissement, chaque année, d’un rapport sur la loi de règlement, accompagné d’un avis sur la sincérité et la conformité des comptes (art. 32 et 68).
* Évaluation des politiques publiques (art. 5).
* Indépendance accrue dans la fixation du programme annuel d’activités (art. 21).
* Cré* tion d’une troisième chambre dédiée aux commissariats, agences, autorités et projets d’investissement public (art. 7 du décret 2022-107).
* Droit de communication élargi aux systèmes d’information.
* Garanties procédurales renforcées (récusation, décharge, suivi disciplinaire).
Ainsi, le RGA 2022-2023 intervient dans une phase où la Cour des comptes, dotée de compétences élargies et d’un cadre rénové, constitue un maillon essentiel du dispositif national de redevabilité et de pilotage de la performance publique, en appui à la mise en œuvre effective de la LOLF et des réformes connexes.
À la veille de l’entrée en vigueur, en 2026, du premier budget-programmes, le rôle de la Cour prend une portée particulière : elle est appelée à garantir la sincérité, la transparence et la redevabilité de cette nouvelle approche de gestion axée sur les résultats.
Dans ce cadre, la Cour assure un double examen des comptabilités publiques : elle vérifie la conformité de la comptabilité budgétaire à la loi de finances votée et apprécie la sincérité de la comptabilité générale de l’État, garantissant ainsi la cohérence entre les deux systèmes et la fiabilité de l’information financière publique.
Ainsi replacé dans le contexte des réformes structurelles des finances publiques et de la redéfinition du rôle de la Cour des comptes, le RGA 2022-2023 apparaît comme un document charnière, censé traduire la mise en œuvre effective des nouveaux principes de performance, de transparence et de redevabilité publique.
Cependant, l’examen de ce rapport révèle plusieurs insuffisances méthodologiques et analytiques, qui méritent d’être relevées, tant sur la forme que sur le fond, au regard des exigences accrues de rigueur et de clarté imposées par le nouveau cadre budgétaire et comptable.
4. Observations sur le RGA 2022-2023
À la lumière du cadre juridique et institutionnel des finances publiques, et des référentiels internationaux d’évaluation tels que le PEFA, l’analyse du Rapport Général Annuel 2022-2023 fait ressortir plusieurs observations d’ordre formel et analytique.
Ces constats peuvent être regroupés autour de deux volets : les observations sur la forme et celles relatives au fond.
5. Observations sur la forme
6. Non-conformité structurelle
Le RGA de la Cour des comptes, prévu à l’article 65 de la loi organique n°2018-032 et dont la structure est définie par l’article 63 du décret n°2022-107 fixant les modalités d’application de ladite loi organique, doit comprendre quatre parties :
1. Condition d’exécution des lois de finances et évolution de la trésorerie
2. Constatation et propositions relatives aux opérations financières de l’État, des collectivités et des établissements publics administratifs.
3. Gestion des entreprises publiques
4. Compte rendu des suites réservées aux communications de la Cour
Or, le RGA 2022-2023 est structuré comme suit :
* Titre I : Exécution des lois de finances 2022 et 2023.
* Titre II : Contrôle de la gestion.
* Titre IV : Réponses des ministres aux communications de la Cour.
Le Titre III, consacré à la gestion des entreprises publiques, n’apparaît pas formellement. Son contenu semble avoir été intégré dans le Titre II, ce qui traduit une non-conformité formelle au schéma prévu par ledit décret et réduit la lisibilité thématique du rapport.
2. Retard de publication
Le RGA 2022-2023, qui devait être publié avant la clôture de l’exercice budgétaire suivant, conformément à l’article 67 de la loi organique n° 2018-032, n’a été rendu public que le 8 octobre 2025. Ce retard de près de trois ans traduit un non-respect du calendrier légalement prescrit, compromettant ainsi le principe de périodicité et, par ricochet, la pertinence temporelle du rapport.
3. Absence d’audits de suivi
L’article 67 de la loi organique n° 2018-032 dispose que la Cour « s’assure, par des audits de suivi, de la mise en œuvre des recommandations établies dans ses rapports précédents. Les résultats de ces audits sont insérés dans le rapport annuel ».
Or, le RGA 2022-2023 ne comporte aucune mention des audits de suivi ni des résultats afférents, en violation de cette exigence. Cette omission constitue une irrégularité formelle, affectant la traçabilité prévue par la loi organique.
4. Absence de critères de sélection des entités contrôlées
Le RGA 2022-2023 ne précise pas les critères de sélection des entités auditées. On observe une concentration des contrôles sur certaines structures, au détriment d’autres non couvertes, traduisant un déséquilibre dans la programmation et un écart au principe d’équité du contrôle.
5. Absence d’informations sur les moyens de la Cour
Le RGA 2022-2023 ne présente aucune donnée relative aux moyens humains et financiers de la Cour, alors que ces informations sont essentielles pour apprécier sa capacité institutionnelle.
La loi organique n’en impose pas la publication, mais les lois de finances permettent d’en assurer le suivi, et les évaluations PEFA (2014, 2020, 2025) ont souligné à plusieurs reprises les insuffisances en ressources.
Cette omission est d’autant plus notable que le budget de la Cour est passé de 45 millions MRU en 2020 à 116 millions MRU en 2025 (+158 %), et que ses effectifs d’auditeurs ont été renforcés (20 recrutements entre 2015 et 2022).
L’absence de ces données empêche d’évaluer la corrélation entre les moyens alloués et les performances réalisées, ainsi que l’évolution de la capacité opérationnelle de l’institution.
2 Observations sur le fond
3 Contenu davantage descriptif qu’analytique
Le RGA 2022-2023 adopte une approche essentiellement descriptive, dont la portée analytique demeure limitée.
Les constats, souvent généraux, n’expliquent ni les causes des dysfonctionnements ni leurs effets sur la performance publique, tandis que les recommandations, peu articulées, traduisent une intégration insuffisante de la logique d’évaluation prévue à l’article 5 de la loi organique n° 2018-032.
L’absence d’une synthèse interprétative réduit la valeur ajoutée analytique du rapport et limite son apport à la décision publique.
4 Imprécision dans l’imputation des responsabilités
Les observations issues des missions de contrôle indiquent que la Cour tend à imputer de manière générale la responsabilité aux acteurs qualifiés de “gestionnaires”, sans distinguer les niveaux de compétence ni les fonctions respectives des intervenants dans la chaîne de la dépense publique.
Une telle approche méconnaît la pluralité des acteurs et la complexité institutionnelle qui caractérisent la gestion des finances publiques, particulièrement depuis la déconcentration progressive des fonctions d’ordonnancement et de paiement. Celle-ci a été amorcée par l’ordonnance n° 2006-049 mettant fin au principe d’unicité de l’ordonnateur et de celui de comptable public, poursuivie par le décret n° 2019-186 (art. 102) instaurant la déconcentration du paiement au niveau ministériel, puis consolidée par l’arrêté n° 244/MF/2020 modifiant l’arrêté n° 2294/MF/2015 pour étendre cette déconcentration aux postes diplomatiques et aux services régionaux.
Or, le principe de séparation des fonctions entre ordonnateurs et comptables publics, consacré à l’article 63 de la loi organique n° 2018-039 (LOLF), impose une distinction claire entre la phase administrative et la phase comptable, chacune relevant d’une responsabilité propre et exclusive.
En application de ce principe, les ministres demeurent les ordonnateurs principaux des crédits inscrits à leur budget (art. 61 de la LOLF), tandis que les secrétaires généraux, en leur qualité de délégataires, ne bénéficient que d’une délégation de signature dépourvue d’effet translatif de compétence (décret n° 2010-066). Il importe dès lors de mieux cerner les niveaux de responsabilité, la délégation n’emportant pas dessaisissement du ministre délégant de sa compétence légale.
Par ailleurs, le rapport ne situe pas le rôle des instances clés de la commande publique, dont les compétences sont pourtant déterminantes pour l’appréciation des responsabilités :
- La Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP), chargée de conduire les procédures de passation des marchés supérieurs aux seuils réglementaires (art. 8 de la loi n° 2021-024) ;
- Et les commissaires aux comptes, chargés de la certification des états financiers et de la fiabilisation de l’information comptable des entités publiques et des services publics à gestion spécifique tel que TAAZOUR, CSA, et CNDH (Arrêté n°819/2000/MF/DTEP)
- L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), investie de missions de régulation, de règlement des différends et de discipline (art. 12) ;
- La Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics (CNCMP), compétente pour le contrôle a priori des procédures dérogatoires (art. 10) ;
L’absence d’imputation des responsabilités aux acteurs concernés, dans les limites de leurs compétences légales, fragilise la chaîne de redevabilité et affaiblit la rigueur de l’analyse portée sur la gestion publique. Une telle omission conduit à une dilution des responsabilités, susceptible d’entraîner des imputations injustifiées ou des exonérations indues, ce qui affaiblit la crédibilité institutionnelle de la Cour et réduit la portée de ses travaux de contrôle.
CONCLUSION
En définitive, malgré la pertinence de plusieurs constats, notamment ceux relatifs à l’exécution des lois de finances, le Rapport Général Annuel 2022-2023 présente des insuffisances tant sur la forme, marquée par un traitement descriptif et peu structuré, que sur le fond, où l’analyse demeure partielle.
L’absence d’imputation claire des responsabilités aux acteurs concernés, chacun dans les limites de ses compétences légales, fragilise la chaîne de redevabilité et atténue la crédibilité institutionnelle de la Cour. Conformément à l’article 66, celle-ci contribue à l’information des citoyens sur la gestion des finances publiques, tandis que l’article 67 prévoit que son rapport puisse nourrir le débat au sein des commissions des finances du Parlement.
Un rapport plus analytique, structuré et rigoureux, mieux articulé aux principes de la LOLF, renforcerait la crédibilité de la Cour et consoliderait son rôle dans la diffusion de l’information financière et l’éclairage du débat démocratique sur la gestion publique.



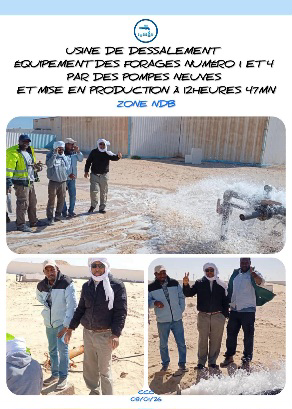

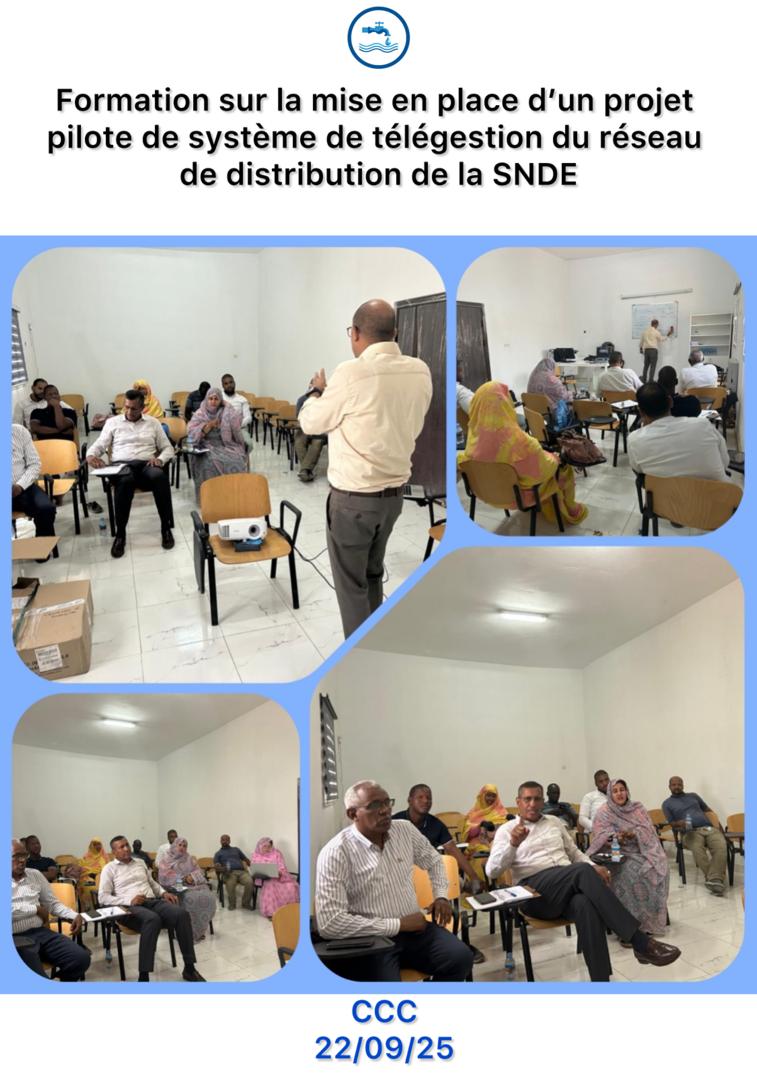
.gif)
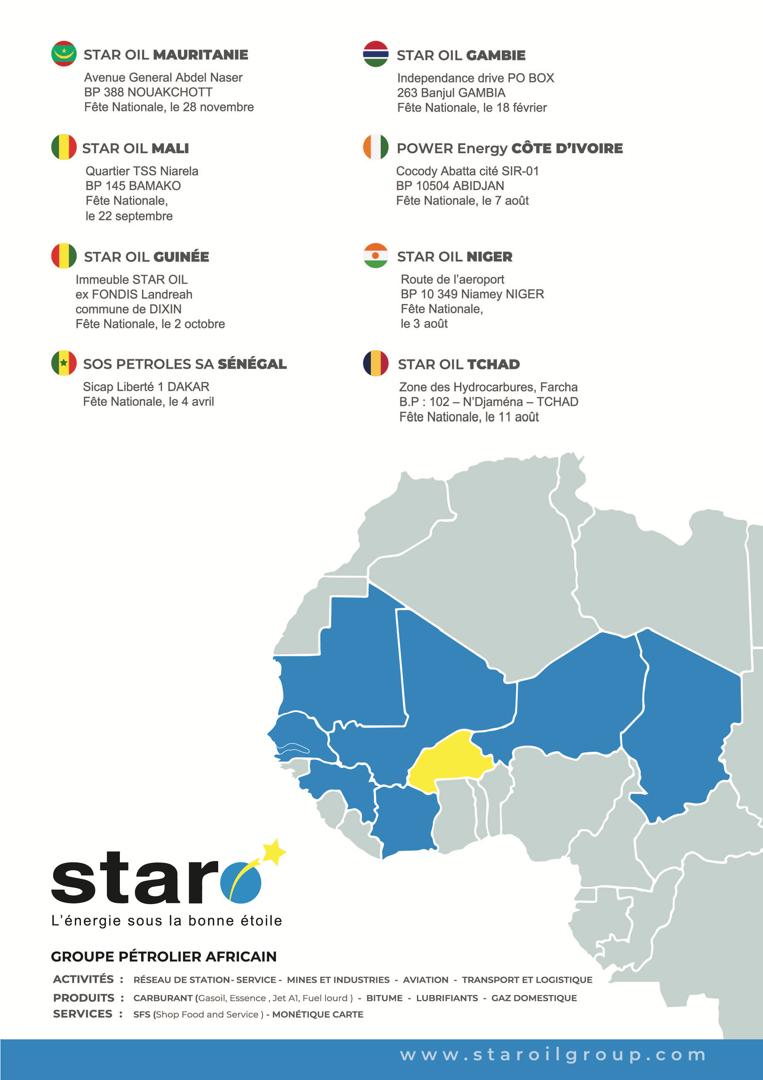

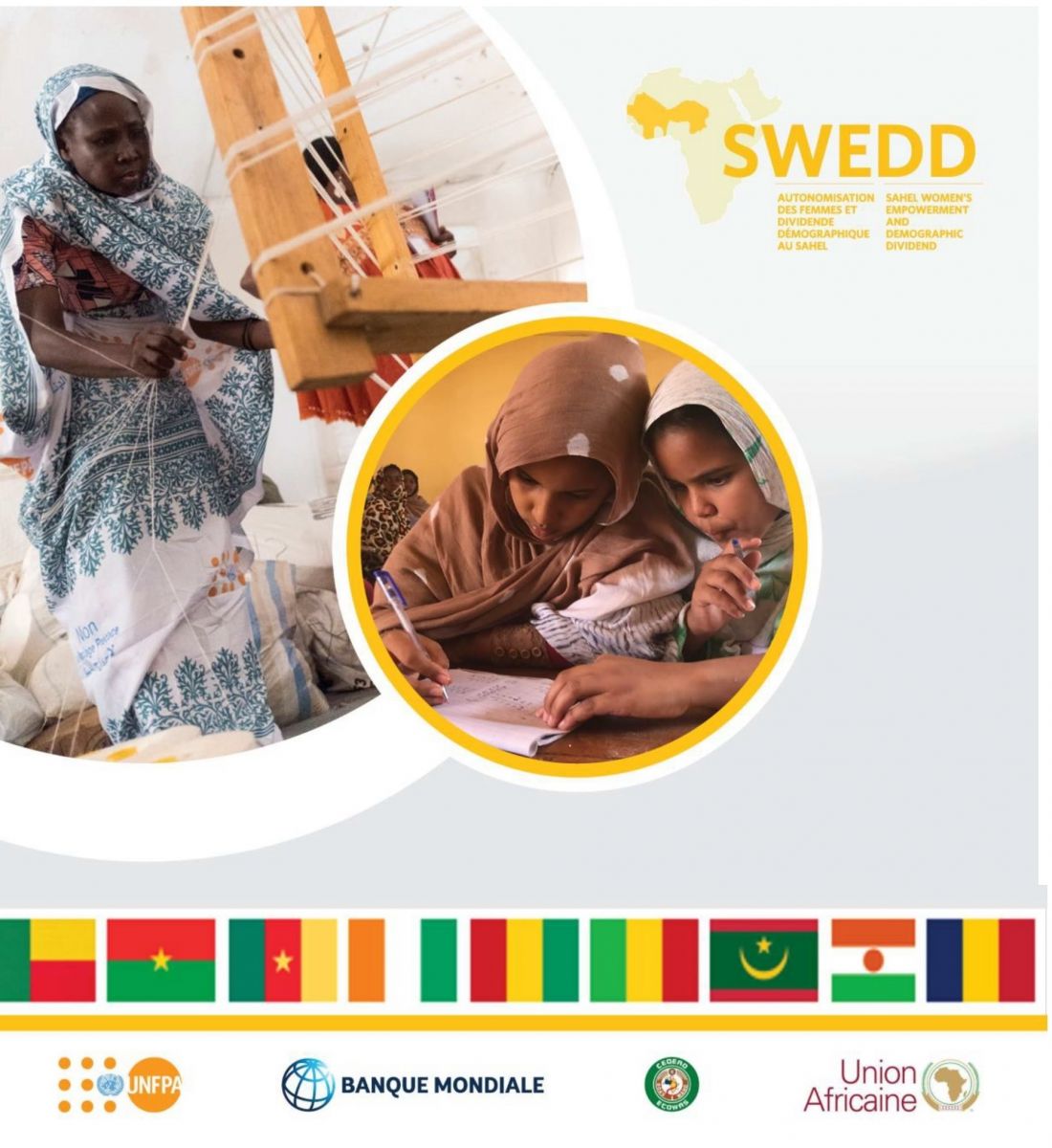
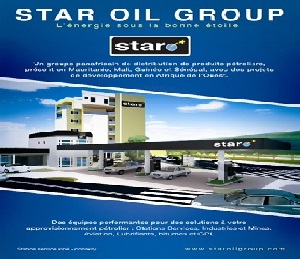




.gif)