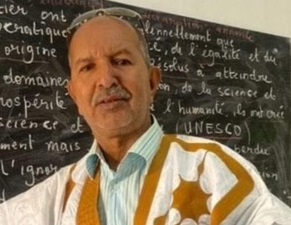
Par l’art musical, l’humanité a toujours cherché à transcender la matière, à donner à l’émotion une forme sensible. Mais aujourd’hui, dans l’ère des images numériques et des sons synthétiques, cette quête semble avoir franchi une frontière inquiétante : celle de l’illusion totale. On nous fait croire que l’image de danseurs parfaitement synchronisés est authentique, alors qu’elle n’est souvent que le fruit d’un montage savant, d’un algorithme ou d’une intelligence artificielle.
Prenons un exemple : sur les plateformes modernes, notamment TikTok, d’aucuns s’affirment ou cherchent à attirer l’attention en imitant des chorégraphies, en se montrant sous un jour artificiellement harmonieux. À travers un simple extrait musical, des milliers de visages et de corps s’animent, s’alignent sur un même rythme, comme guidés par une main invisible. L’individu se fond dans une chorégraphie mondiale où chacun prétend exprimer sa singularité… en reproduisant exactement les mêmes gestes. La musique, jadis élan du cœur et souffle de l’âme, devient souvent un décor sonore au service de l’image. Un ballet d’imitation remplace la créativité spontanée.
Sur nos écrans, des danses issues de cultures multiples se fondent dans une symphonie impeccable : le tambour africain s’accorde au violon oriental, la kora épouse la guitare électrique, le pas tribal se mêle à la danse urbaine. Tout concorde, tout séduit. Le spectateur, émerveillé, croit assister à un miracle d’harmonie universelle — alors qu’il contemple une construction numérique, un rêve codé. Pour le professionnel de musique, ce spectacle est fascinant mais troublant. La sonorité n’est plus la vibration d’une corde ni le souffle d’un instrument, mais une onde artificielle calculée par des logiciels. L’artiste cède la place à la machine ; la main humaine s’efface derrière l’algorithme.
Le vertige de l'hyperfalsification : quand la fiction corrode le réel
Cette logique de la simulation, née dans le domaine de l'art et du divertissement, étend désormais son empire à la sphère du fait et de la vérité. Le fossé entre la fiction et le réel se rétrécit à une vitesse vertigineuse. On fait désormais parler un président, un grand responsable ; tout porte à croire que c'est la même voix, la même photo. Le deepfake, hier encore curiosité technique, est devenu une arme de désinformation massive, capable de faire prononcer n'importe quel discours à n'importe qui, avec un réalisme déconcertant.
Les conséquences de cette confusion délibérée sont autrement plus graves que l'uniformisation esthétique. Elles ouvrent la voie à des abysses d’incertitude judiciaire et sociale. Ce qui peut engendrer aussi les faux témoignages, les fausses reconnaissances des crimes que la personne n'a pas commis. Imaginez une vidéo, parfaitement réaliste, présentée comme preuve à un procès : elle montre un individu avouant un forfait qu'il n'a jamais commis, sa voix et ses expressions faciales scrupuleusement recréées par une intelligence artificielle. L’illusion, jadis réservée aux scènes de théâtre ou aux rêves d’artiste, s’immisce dans le tribunal, dans la salle de nouvelle, dans le débat public. La parole elle-même, ce pilier de la justice et de la confiance, devient malléable, suspecte.
La promesse messianique d'une harmonie factice
Ce vertige technologique, aussi éblouissant soit-il, suscite une inquiétude profonde. Car après de telles prouesses, comment ne pas craindre les découvertes à venir ? Chaque avancée semble repousser un peu plus les limites du réel et de l’humain. Bientôt, peut-être, la distinction entre l’homme et sa création s’effacera totalement.
Et lorsque tout devient illusion, lorsque le vrai et le faux se confondent dans une harmonie factice, on peut y lire les symptômes d’une ère trompeuse, celle que les traditions annoncent comme le temps du Messie trompeur. Car n’est-ce pas là son essence même : séduire par la beauté, convaincre par la perfection, et faire du mensonge une œuvre d’art ? La même technologie qui nous enchante avec des chorégraphies parfaites et des symphonies globalisées est celle qui peut fabriquer une vérité alternative, un monde sur mesure où tous les éléments s'accordent pour nous tromper. Elle promet l'unité, mais ne livre que l'uniformité ; elle simule la concorde, mais engendre la méfiance.
Ainsi, l’art musical et ses dérives technologiques ne façonnent plus seulement notre perception du beau ou de l’harmonie ; ils refaçonnent les fondements mêmes de la vérité. Dans ce brouillard numérique, où le faux se pare des atours du vrai, le risque n’est plus seulement esthétique, il est éthique, judiciaire, civilisationnel. La même séduction qui nous enchaîne à l’écran pour un spectacle de danses impeccables peut, demain, ligoter la justice et travestir le droit. Et dans cette confusion généralisée, où le réel se dérobe, ne sommes-nous pas en train de construire, inconsciemment, la scène parfaite pour les pires des impostures ?
Eléya Mohamed
Notes d'un vieux professeur




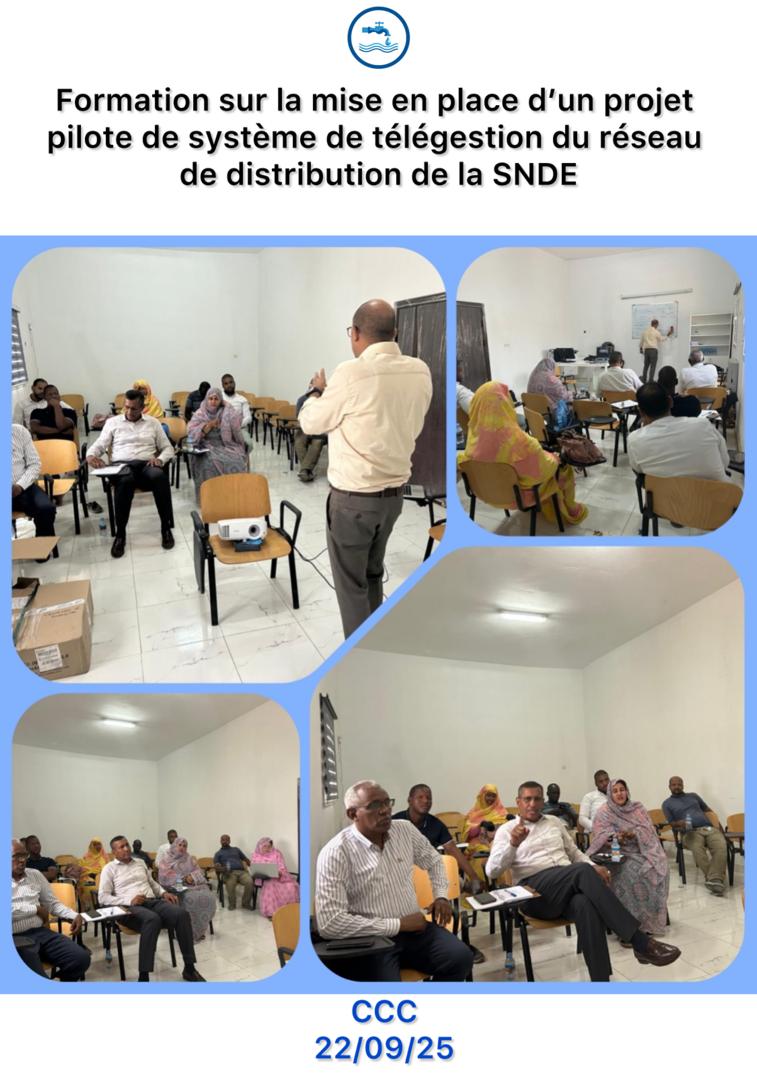
.gif)
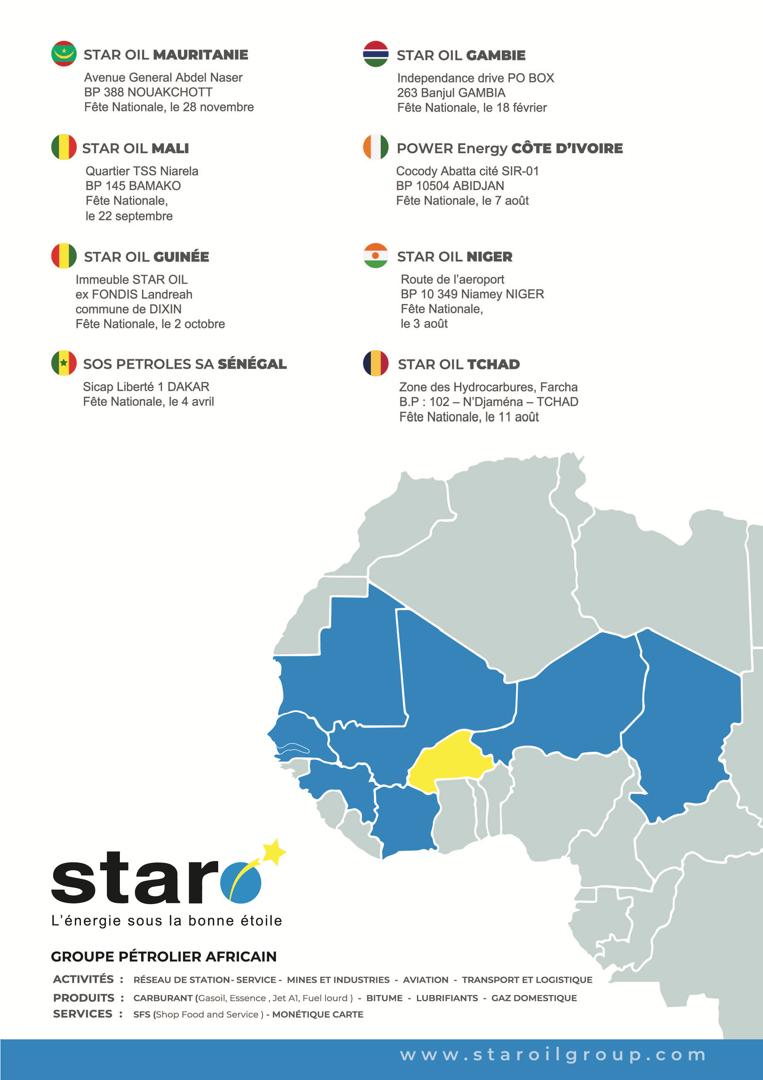

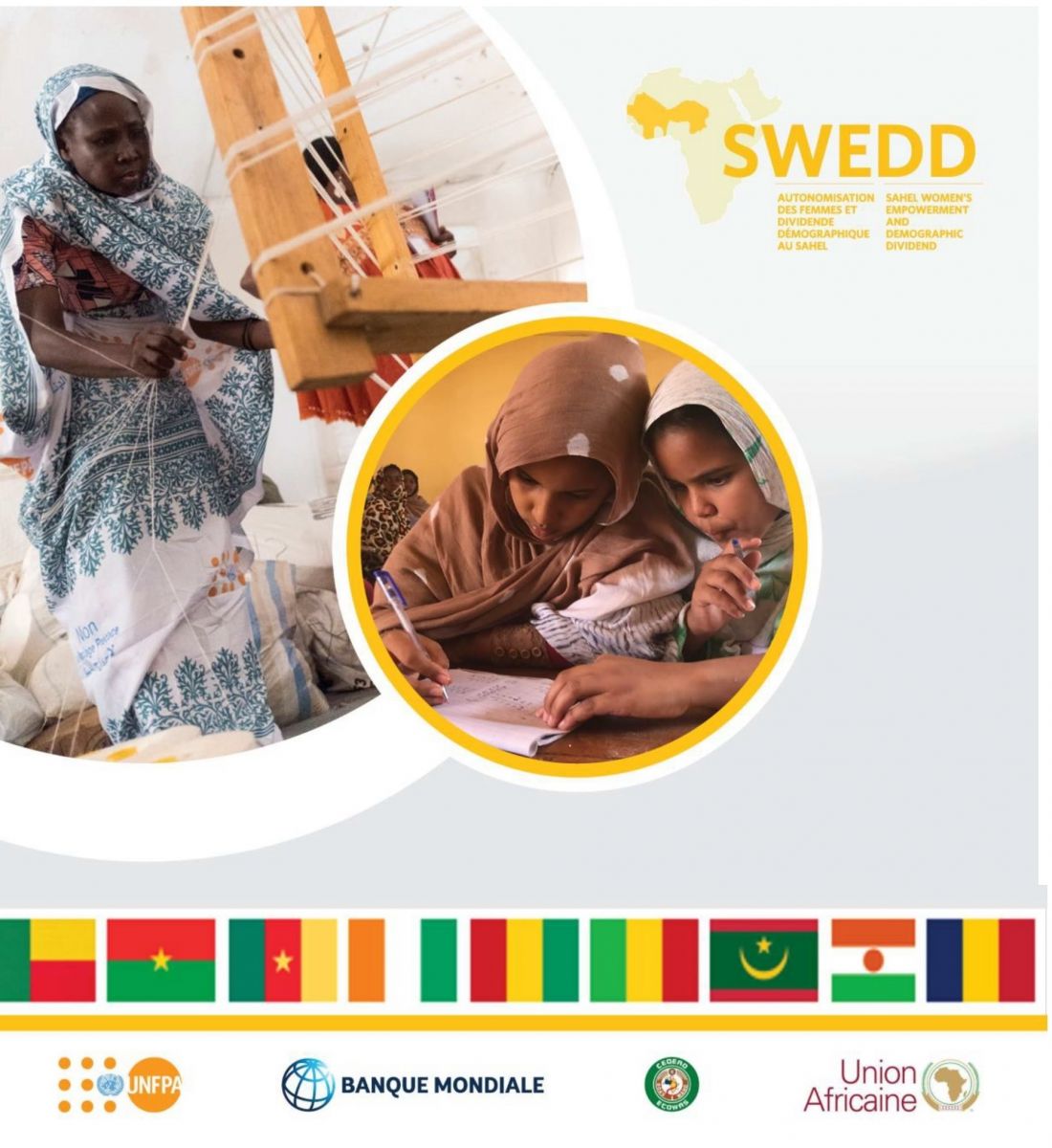
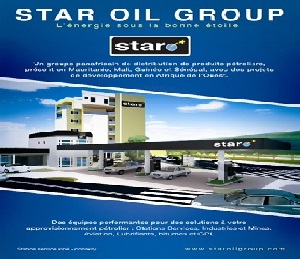




.gif)