
Je reviens sur ce sujet, avec l’intention d’en parler encore et encore, car il touche à l’essence même de notre avenir collectif. La publication du rapport de la Cour des comptes sur l’exécution budgétaire 2022-2023 et le limogeage d’une trentaine de hauts responsables n’est pas un simple fait divers administratif : c’est un signal fort, un test de sincérité, un moment de vérité pour la gouvernance en Mauritanie.
Depuis trop longtemps, notre pays vit sous l’ombre d’une culture de la gabegie érigée en système, où la prédation des ressources publiques s’est banalisée, et où certains se vantaient même d’avoir dilapidé les biens de l’État comme s’il s’agissait d’un trophée. Aujourd’hui, pour la première fois, une volonté politique claire semble vouloir rompre avec cette logique de déchéance morale et institutionnelle.
Il ne s’agit pas seulement de « nettoyer » en surface, ni de désigner des coupables de circonstance, mais de restaurer la confiance entre l’État et les citoyens, de rebâtir une administration intègre et responsable. Le combat contre la corruption est un combat contre une mentalité, contre un système, contre l’idée que tout peut s’acheter ou se contourner.
Cette lueur d’espoir, aussi fragile soit-elle, ne doit pas être étouffée. Elle doit au contraire être nourrie, protégée, institutionnalisée. Car la transparence, la reddition des comptes et la sanction des abus ne sont pas des gestes politiques : ce sont des impératifs de survie pour un État qui veut durer.
Un tournant historique dans la lutte contre la corruption
La publication du rapport 2022-2023 de la Cour des comptes représente un jalon majeur dans la lutte sereine et durable contre la corruption et les pratiques de gabegie. Elle est la preuve d’une volonté politique réelle, tangible, car nous savons tous que pendant trop longtemps la gabegie et le clientélisme ont été érigés en système, presque célébrés comme une norme, et que certains s’en sont vantés sans complexe.
Il ne s’agit donc pas seulement de dénoncer des irrégularités financières, mais de rompre avec une culture profondément enracinée, de combattre la mentalité qui a permis que la fraude et l’impunité deviennent des habitudes, et de montrer que l’État peut et doit imposer l’intégrité et la responsabilité comme principes fondamentaux de l’administration publique.
Cette démarche, si elle est menée jusqu’au bout, permettra d’ouvrir une ère nouvelle : celle de la transparence opérationnelle, du contrôle régulier et de la reddition des comptes comme instrument de gouvernance.
Exigence morale
La décision du gouvernement de rendre publique la liste des trente hauts responsables concernés par les irrégularités révélées par la Cour des comptes a suscité de vifs débats. Certains y voient une violation du principe de la présomption d’innocence ; d’autres, au contraire, saluent un tournant historique dans la lutte contre la corruption. En vérité, cette démarche doit être appréciée non pas à la lumière d’une lecture formaliste du droit (un clin d’œil à mon frère le professeur émérite Mustapha Ely), mais dans le contexte d’une pathologie systémique qui a gangrené l’appareil administratif mauritanien depuis des décennies.
La corruption et la gabegie ont été érigées en culture, presque en institution parallèle, où le détournement des ressources publiques et le clientélisme étaient non seulement tolérés, mais parfois glorifiés. Des responsables publics, censés être les gardiens du bien commun, s’en vantaient même, convaincus de leur immunité. C’est cette mentalité qu’il faut aujourd’hui déraciner.
Dans un tel contexte, la transparence nominative devient un instrument de moralisation et non une stigmatisation. Elle participe d’une pédagogie publique essentielle : rappeler à chaque fonctionnaire que la gestion des deniers de l’État est un acte de confiance et non un privilège, et que l’abus de cette confiance entraîne la honte, la perte d’honneur et, in fine, la sanction.
Certes, le respect de la présomption d’innocence et du secret procédural demeure un principe cardinal du droit. Mais il ne saurait être invoqué pour protéger ceux qui ont trahi la confiance publique ou pour perpétuer l’opacité qui a permis à la corruption de prospérer. L’État de droit n’est pas une forteresse derrière laquelle se retranchent les fauteurs de détournement ; il est un cadre de transparence, d’équité et de responsabilité.
Rendre publics les noms des responsables impliqués dans des actes de mauvaise gestion avérés, documentés et établis par la Cour des comptes n’équivaut pas à une condamnation pénale, mais à une sanction morale et institutionnelle légitime, nécessaire pour restaurer la confiance du citoyen dans l’État.
Aussi, il importe désormais d’encadrer ce mouvement dans un cadre institutionnel clair : publication régulière et systématique des rapports de la Cour des comptes et de l’Inspection générale d’État, activation de la nouvelle Autorité nationale de lutte contre la corruption, et mise en place d’un mécanisme de “nomination responsable” ; c’est-à-dire la suspension immédiate de tout fonctionnaire soupçonné d’actes de prévarication, le temps que la justice fasse son travail.
En définitive, balancer les responsables n’est pas une dérive populiste, mais une exigence morale et républicaine, un acte de salut public. Car la Mauritanie ne pourra se réformer qu’en affrontant le mal à sa racine : la mentalité de l’impunité. La transparence, lorsqu’elle est sincère, équilibrée et juridiquement encadrée, est la plus noble forme de justice.
L’enjeu aujourd’hui ne se limite pas à l’identification des fautes ou à la sanction individuelle. Il s’agit d’un travail de refondation systémique, visant à transformer la gouvernance publique en profondeur, en substituant à la culture de la prédation celle de la performance, de la probité et de la redevabilité.
La lutte contre la corruption ne saurait se réduire à une succession d’opérations médiatiques ou de limogeages symboliques. Elle exige la mise en place d’un écosystème institutionnel cohérent, articulé autour de trois piliers indissociables : l’audit permanent, la sanction effective et la réforme structurelle.
L’audit permanent : le contrôle comme fonction vitale de l’État
Le contrôle interne et externe de l’administration doit cesser d’être une formalité bureaucratique pour devenir un instrument de gouvernance stratégique.
La Cour des comptes, l’Inspection générale d’État, les inspections sectorielles et les cellules de conformité doivent être interconnectées, dotées d’un pouvoir d’investigation réel et d’une obligation de publication systématique de leurs rapports.
Chaque département ministériel devrait être soumis à un audit de performance et de conformité annuel, assorti d’un plan correctif. Les conclusions de ces audits doivent être rendues publiques, non pour humilier, mais pour responsabiliser et prévenir la récidive.
- La sanction effective : fin de l’impunité administrative
L’efficacité d’une politique anticorruption repose sur la certitude de la sanction plus que sur sa sévérité. La chaîne de responsabilité administrative et pénale doit être rétablie dans toute sa rigueur.
Tout agent public reconnu coupable d’actes de détournement, de concussion ou de favoritisme doit être déféré devant les juridictions compétentes, conformément aux dispositions du Code pénal, du Code de la transparence financière et de la loi organique sur la Cour des comptes.
La mise en place d’un registre national des sanctions administratives et disciplinaires, accessible aux organes de contrôle et de nomination, permettrait d’éviter la réaffectation de fonctionnaires compromis à d’autres postes sensibles ; une pratique trop longtemps tolérée.
- La réforme structurelle : prévenir avant de punir
La prévention demeure la clé d’une lutte durable. Elle passe par une refonte des procédures de passation des marchés publics, une dématérialisation complète des circuits financiers, et l’instauration d’une traçabilité numérique des dépenses publiques.
Les systèmes d’information budgétaires doivent être intégrés pour réduire les zones d’opacité où prospère la corruption.
Parallèlement, il faut réhabiliter la notion d’éthique de la fonction publique à travers la formation continue, la publication d’un code de conduite obligatoire, et la déclaration de patrimoine pour les agents occupant des postes de responsabilité.
Enfin, la participation citoyenne est un levier essentiel. La société civile, les médias d’investigation et les institutions universitaires doivent être associés à l’évaluation des politiques publiques. L’accès à l’information, garanti par la loi, doit devenir une réalité quotidienne et non un principe abstrait.
Pour que la transparence devienne une culture et non une parenthèse
Le rapport de la Cour des comptes et les mesures courageuses qui l’ont suivi ouvrent, sans conteste, une ère nouvelle dans la gouvernance publique mauritanienne. Pour la première fois depuis longtemps, la lutte contre la corruption ne se réduit pas à un discours de circonstance : elle se traduit par des actes concrets, assumés, qui touchent les plus hauts niveaux de responsabilité.
Mais pour que cette dynamique ne soit pas un épisode isolé, il faut qu’elle s’inscrive dans une stratégie d’État, avec des institutions solides, des procédures irréversibles et une vigilance citoyenne constante. Le nettoyage administratif, aussi nécessaire soit-il, ne suffira pas sans la reconstruction morale de la fonction publique, sans une éducation civique et institutionnelle qui replace la notion de service de l’État au-dessus de tout calcul personnel ou clanique.
L’heure n’est plus à l’indignation sélective, mais à la refondation éthique. Car la corruption n’est pas seulement une infraction : elle est une trahison du contrat social, une négation de la République. Lutter contre elle, c’est protéger le vivre ensemble, la justice, la stabilité et la dignité du pays.
Il faut donc accompagner la transparence d’une rigueur juridique et d’une pédagogie publique. Dénoncer, oui, mais aussi prévenir ; sanctionner, mais surtout éduquer. Ce n’est qu’à ce prix que la Mauritanie pourra tourner la page d’un passé d’impunité et écrire celle d’un État moderne, équitable, respecté et résolument tourné vers l’émergence.
Le président de la République, en assumant cette épreuve de vérité, ouvre un champ d’espérance. Mais cette espérance reste fragile : elle doit être consolidée par la continuité de l’action, la protection des institutions de contrôle, et le refus de toute instrumentalisation politique.
En définitive, la transparence ne doit pas être un moment, mais une culture ; pas une réaction, mais une doctrine ; pas une exception, mais une règle. C’est à cette condition que la Mauritanie retrouvera pleinement la confiance de ses citoyens et la considération de ses partenaires.
Haroun Rabani




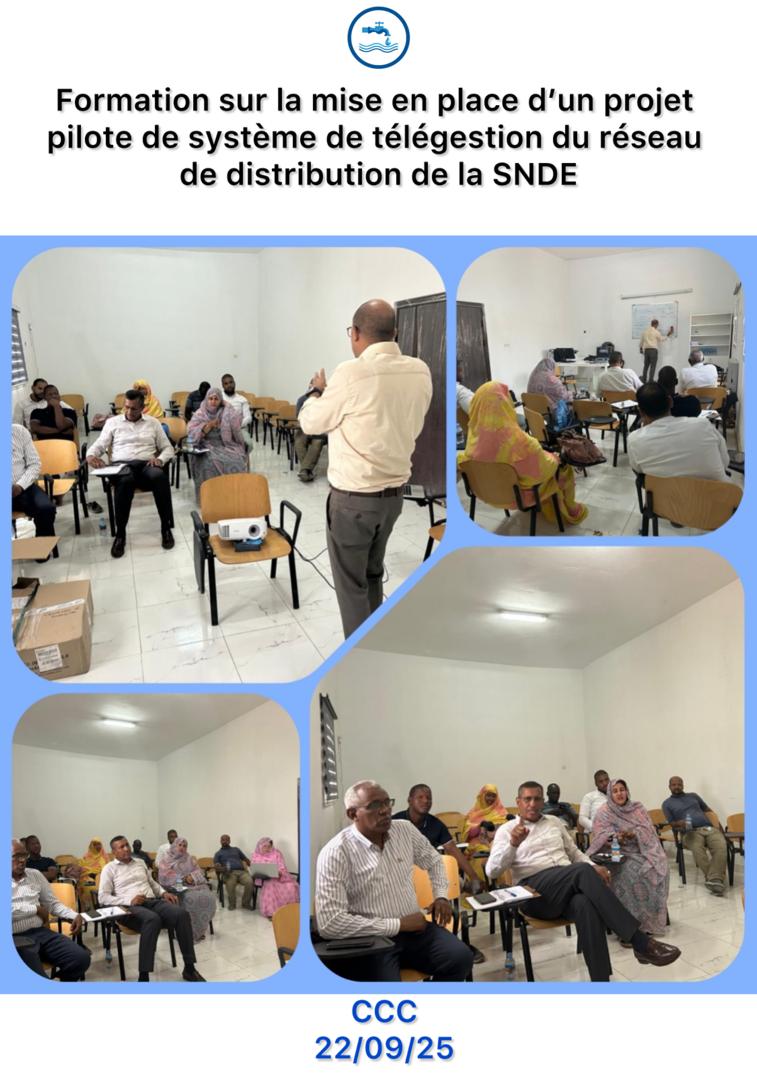
.gif)
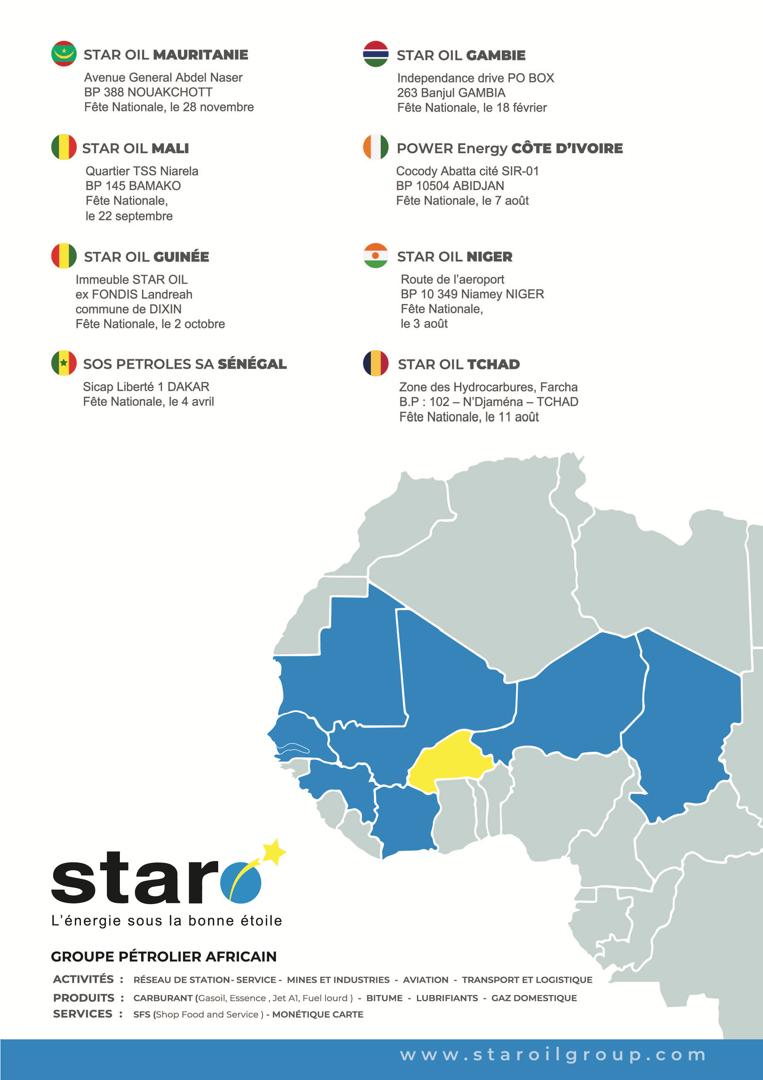

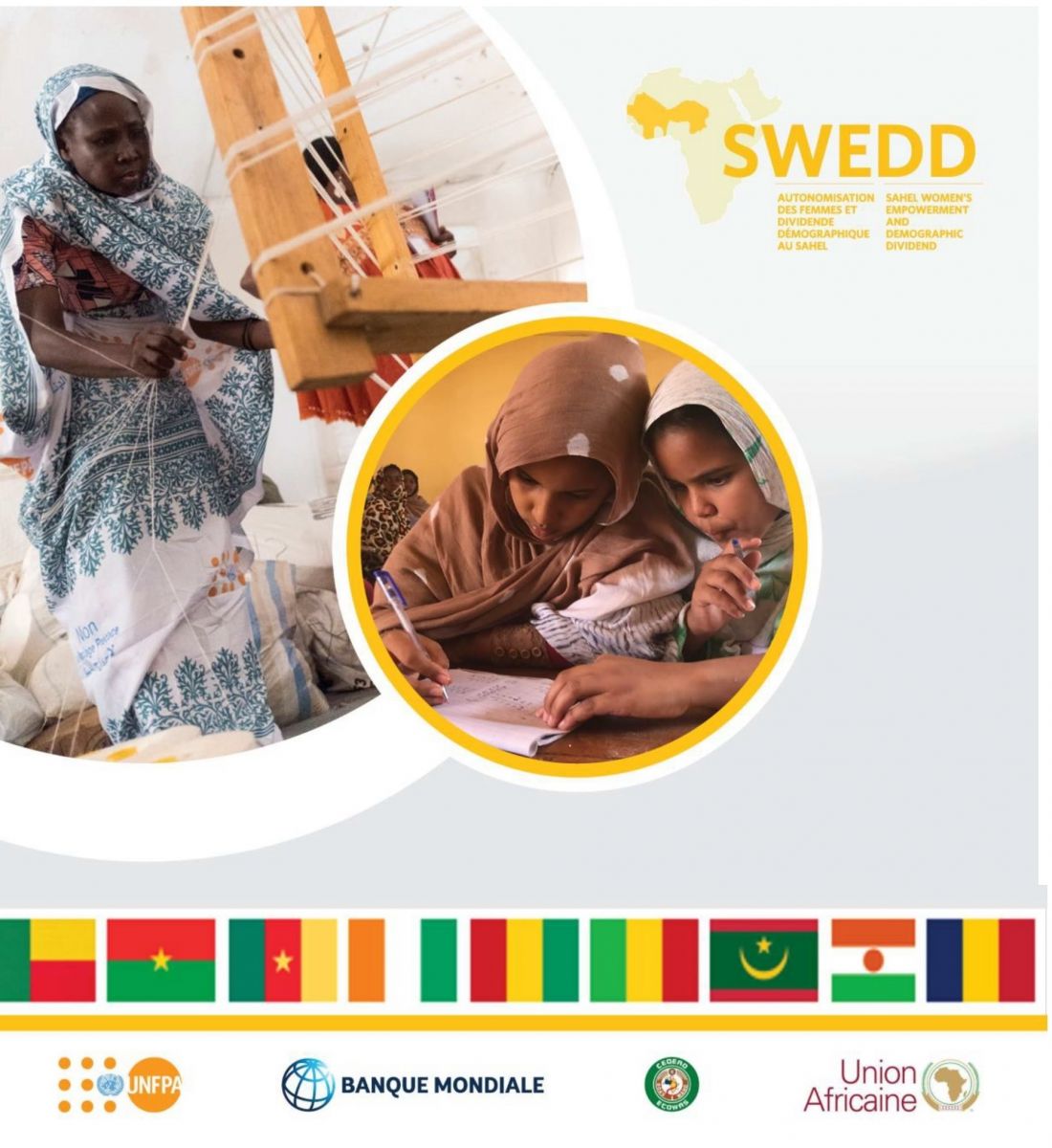
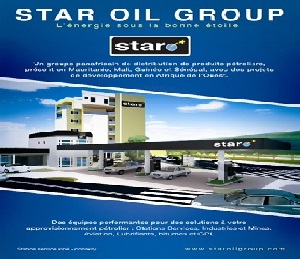




.gif)