
Il est des pays où le sentiment de déjà-vu relève de l’expérience intime. En Mauritanie, il frôle l’institutionnel. À chaque décision gouvernementale, il ressurgit, familier, presque rassurant. Le pays semble condamné à revivre ce qu’il n’a jamais vraiment quitté. Le passé, ici, n’éclaire pas l’avenir, il l’occupe entièrement.
Car la matrice de nos choix publics demeure immuable et routinière entre nomination tribale, réflexe régional à défaut du réseau parental. Une mécanique ancienne, robuste, patiemment conservée. On peut moderniser les façades, digitaliser les procédures, multiplier les discours réformateurs mais l’essentiel, lui, ne bouge pas. Le mérite reste un invité de passage et l’appartenance une résidence permanente.
Cette permanence aurait pu relever du folklore si elle ne pesait pas, parfois lourdement, sur la trajectoire du pays. L’amateurisme qui s’y greffe lui donne un relief particulier. Des décisions prises avec une désinvolture presque déconcertante, comme si l’économie nationale pouvait absorber chaque improvisation, comme si l’équilibre sécuritaire n’était qu’un décor, comme si l’histoire elle-même était un terrain de jeu sans conséquence. Il suffit parfois d’un décret mal inspiré pour créer une onde de choc. Un secteur fragilisé, une tension politique inutilement ravivée, un projet stratégique compromis avant même d’exister. Les choix qui engagent l’avenir semblent parfois traités comme de simples routines administratives, sans anticipation, sans stratégie, sans conscience réelle de leur portée.
Dans ce paysage, un écosystème d’interprètes officiels s’est imposé avec constance. Les pseudo-journalistes, d’abord, ces chroniqueurs de l’après-coup, capables de décrire avec une précision prodigieuse ce qu’ils n’avaient pas su voir venir. Puis les penseurs aux idées nomades, experts d’un jour, oracles du lendemain, toujours en transit intellectuel, jamais installés dans la rigueur. Enfin, ces intellectuels suspendus entre deux temporalités, travaillant avec des outils du passé tout en se proclamant visionnaires de l’avenir. Tous élaborent, ensemble, une argumentation de substitution. Alors la faute devient fatalité, l’improvisation devient audace, et la négligence, une forme de pragmatisme national. On ne corrige pas le pouvoir, on lui fournit donc un récit réchauffé.
Pendant ce temps, le citoyen, lui, enregistre. Avec lucidité, parfois avec lassitude, rarement sans humour. Il voit bien que la Mauritanie n’avance pas faute de ressources ou d’intelligence collective, mais faute d’un appareil politique capable de se dégager des fidélités anciennes, d’assumer la compétence comme principe, et de concevoir la décision publique comme un acte grave, pensé, pesé. Ce qu’il attend, ce n’est pas un miracle mais un changement de méthode : que l’État cesse d’être un terrain d’essais et redevienne un espace de responsabilité. Que les nominations cessent d’être des redistributions claniques et redeviennent des choix fondés. Que le futur cesse enfin de ressembler au passé par simple inertie.
En attendant, le déjà-vu continue son chemin, imperturbable. Non pas parce que le pays manque d’avenir, mais parce que ceux qui décident persistent à ne pas le regarder.
Scheine



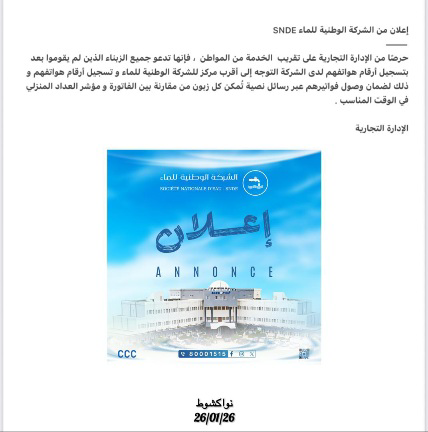

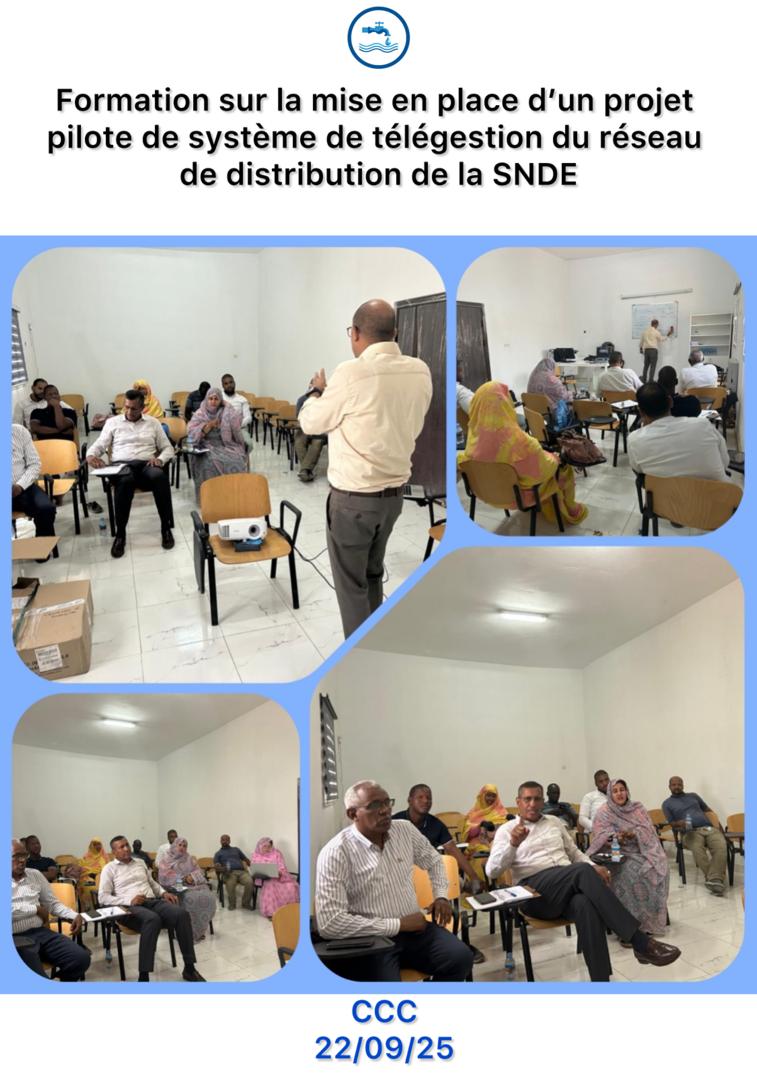
.gif)
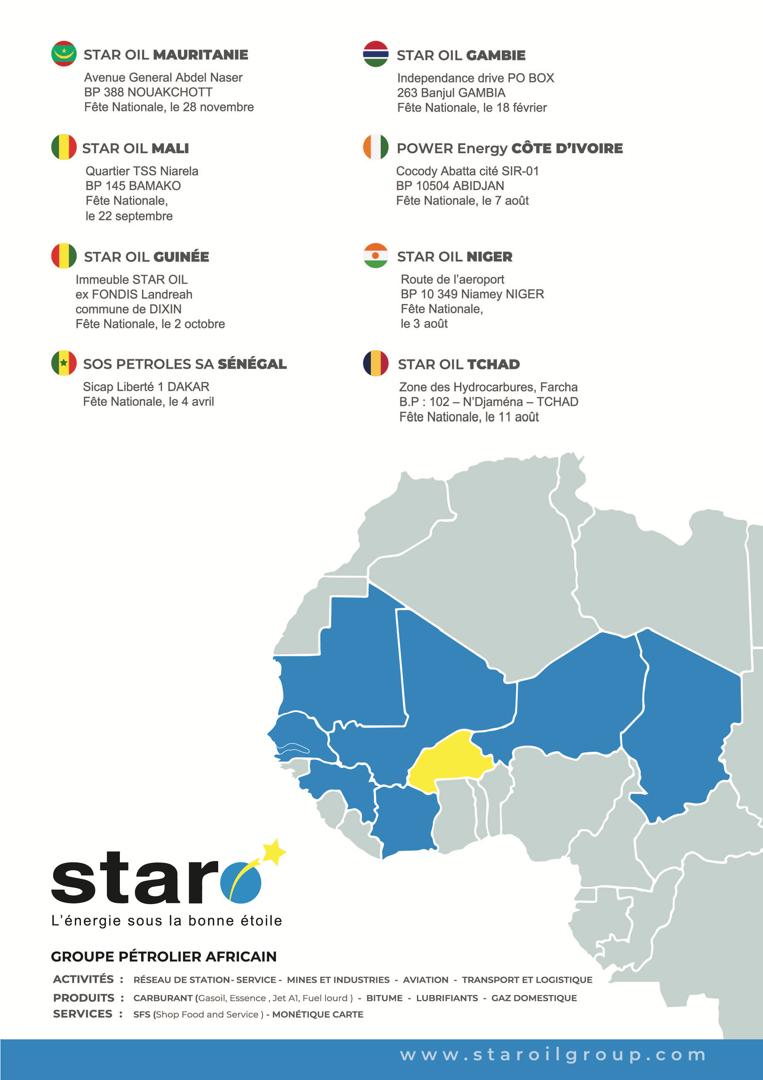

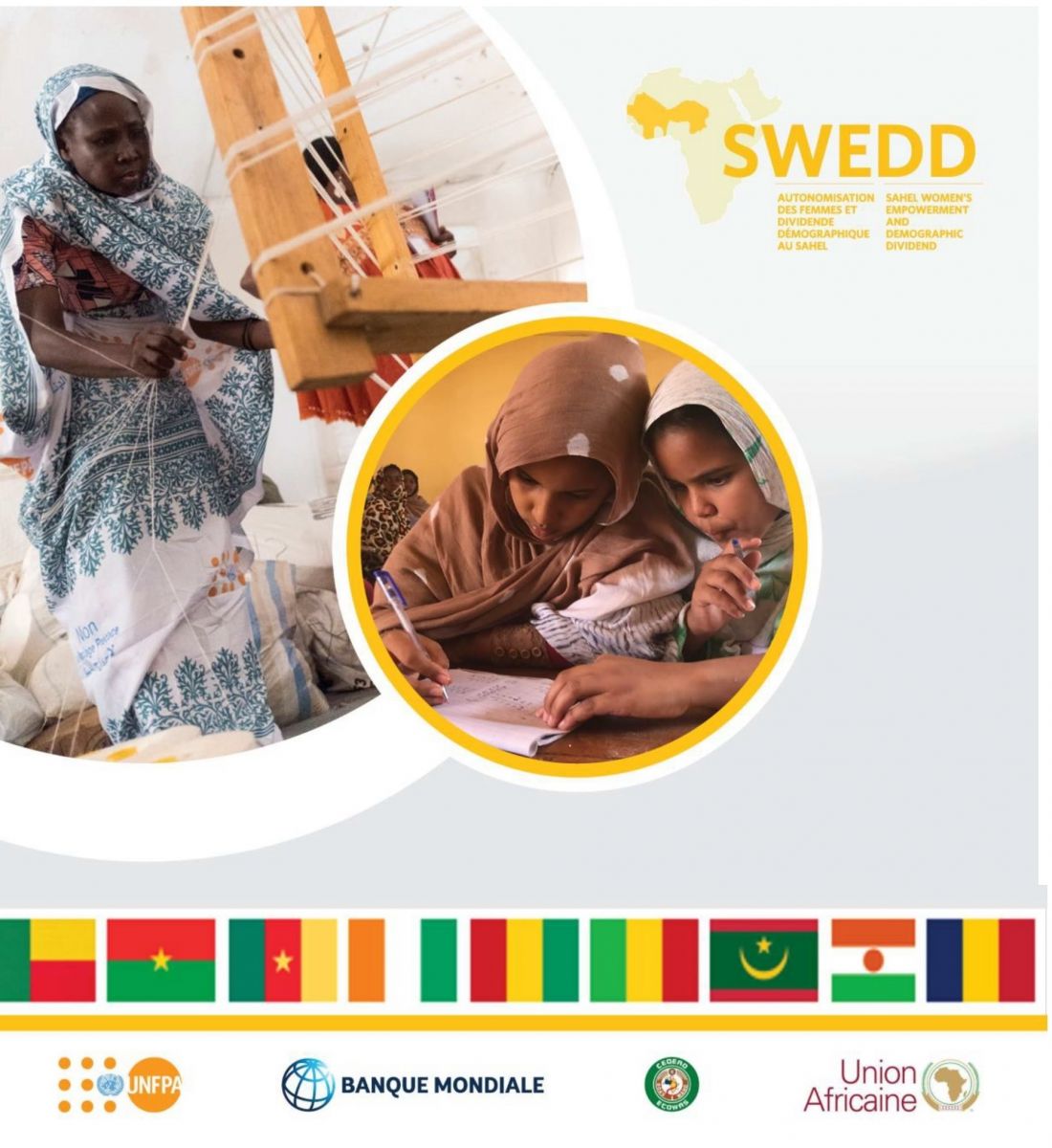
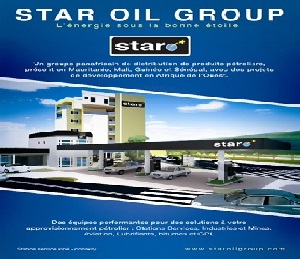




.gif)