
Le proverbe nous enseignait jadis qu’« à beau mentir qui vient de loin ». Il supposait que l’imposture avait besoin du voile de la distance pour prospérer. Aujourd’hui, nous assistons à une mutation plus profonde et plus inquiétante : le mensonge n’est plus une question d’éloignement, mais une absence de pudeur. Il est le fait de ceux qui, n’ayant jamais connu la morsure de la honte, déversent des flots de paroles qui ne se cristallisent jamais en actes. Même sous le froid polaire de la crise, même face à la rigueur des faits, leur discours demeure une matière informe, visqueuse, incapable d’épouser la forme de la vérité.
C’est précisément ce spectacle désolant qui s’offre à nous. Nous voyons des dirigeants s’épancher en d’interminables « fleuves de pages », catalogues de réussites supposées et de réalisations de papier. Mais derrière cette muraille de verbes, que reste-t-il ? Une population qui observe, incrédule, ce théâtre d’ombres où l’on célèbre la sagesse d’un homme comme une panacée — remède universel à des maux que l’on se refuse pourtant à nommer.
Le tragique confine à l’absurde dans l’inversion des priorités. On nous somme d’admirer le génie du présent tout en accablant le passé. On nous explique, avec une audace qui laisse pantois, que la condamnation de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz émane d’une justice indépendante ; dont acte. Pourtant, le Premier ministre actuel, qui fut naguère sa boussole financière, affirmait en son temps que la figure du chef était une préoccupation plus brûlante et nécessaire que l’accès des populations à l’eau ou à l’électricité. C’était là une manière insidieuse de préparer l’opinion à l’inacceptable : la transgression flagrante de la Constitution pour un troisième mandat. L’indécence atteint son paroxysme lorsque l’on constate que cette dévotion d'apparat s’efface devant l'inhumanité : ce même collaborateur n’a pas même daigné présenter ses condoléances à son ancien mentor lors du décès de son père.
Peut-on raisonnablement nourrir un peuple de ces rancœurs politiques lorsqu’il a soif ? Peut-on prétendre éclairer l’avenir d’une nation avec les décombres calculés du simulacre, alors que les foyers sont plongés dans l’indignation et le dénuement ?
Ce spectacle est celui d’un pays victime de ceux-là mêmes qui ont la charge de l’administrer. Le mirage des mots tente de justifier la cruauté des actes, et le pouvoir, affranchi du réel, ne se mesure plus qu’à l’aune de sa propre froideur. Cette politique n’est plus une gestion de la cité ; elle est une esthétique du vide. En substituant le culte de la personnalité aux services de base, on consacre une rupture définitive entre le sommet et la base. On oublie qu’un dirigeant n’est pas une idole à sacraliser, mais un mandataire à juger.
Cette réalité révèle une seconde nature, profondément cynique : celle d’une vénération de circonstance. Tant que l'homme exerce, on lui voue un culte ; qu’il soit évincé, et le voilà plongé dans une solitude glaciale. Au premier désaccord avec le nouveau locataire du palais, il se métamorphose en paria, méprisé par ces mêmes collaborateurs qui, déjà, ne voient plus que l’éclat du successeur.
Pour une gouvernance assainie
La seule issue durable pour briser cette culture de l’hypocrisie consiste à écarter ces « caméléons » des organes de l’État. Tant qu’ils y demeurent, ils considèrent l’allégeance servile comme un bouclier contre toute exigence de compétence. Le culte du chef devient alors une monnaie d’échange, un capital symbolique leur assurant protection et privilèges au détriment de l’intérêt général. Cette dynamique n'est pas le fait d'individus isolés, mais d'un système qui confond loyauté institutionnelle et dévotion personnelle.
C’est pourquoi la reconstruction passe nécessairement par une justice véritablement indépendante, immunisée contre les pressions de l’Exécutif. Non pour régler des comptes, mais pour restaurer la confiance et neutraliser cette armée silencieuse qui prospère dans l’ombre du pouvoir. Une justice autonome n’est pas une menace pour l’État : elle est son dernier rempart contre la banalisation du mensonge et l’effondrement moral de la nation. La grandeur d’une gouvernance ne se mesurera jamais au nombre de pages de ses rapports, mais à la dignité retrouvée de ses citoyens.
Eléya Mohamed
Notes d'un vieux professeur






.gif)
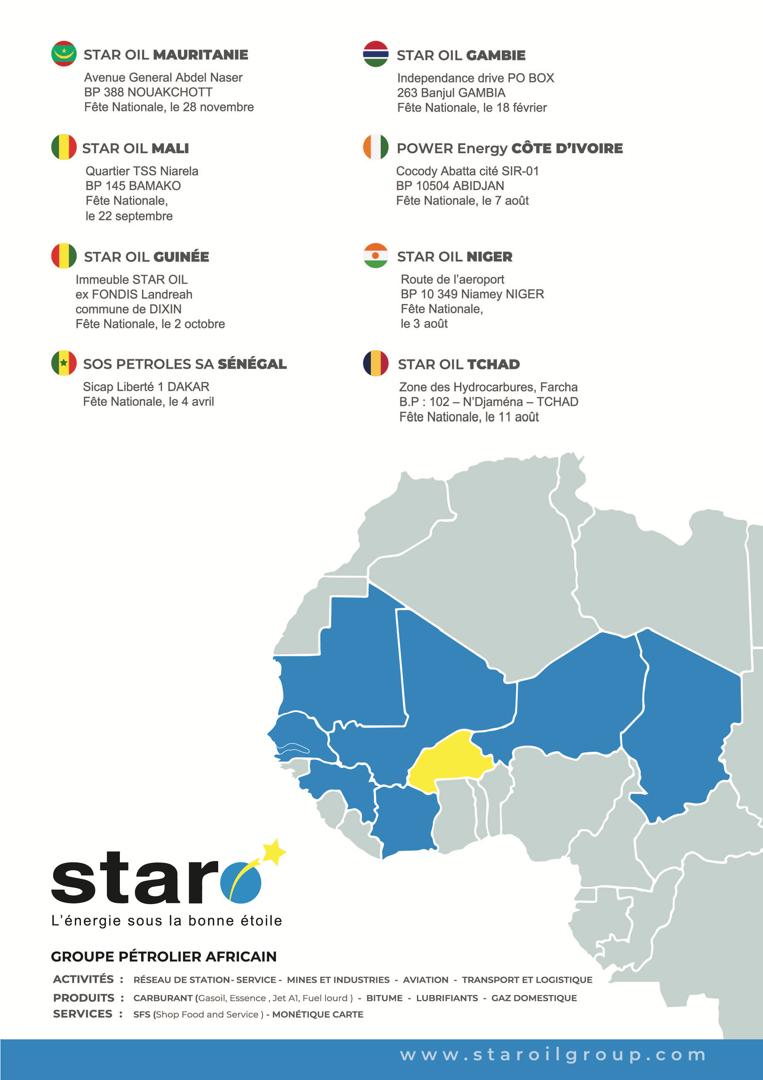







.gif)