
‘’Le Sommet US-Afrique fut un point culminant de ce processus de transformation du regard que les Américains, notamment la classe politique et les hommes d’affaires, portent sur le continent’’
Afroline.org : Vous êtes fin connaisseur de la politique africaine des Etats-Unis. Qui décide quoi sur l’Afrique à Washington ? Où se situent les centres névralgiques qui déterminent les relations entre les Etats-Unis et l’Afrique ? Enfin, quel est, aujourd’hui, le poids de l’Afrique dans la politique étrangère américaine ?
Chris Fomunyoh : Washington accueille plusieurs centres de décisions qui déterminent, notamment, les choix stratégiques des Etats-Unis en matière de politique étrangère. Cette politique s’articule autour de trois centres de pouvoir : le pouvoir exécutif, représenté par la Maison Blanche et l’administration, dont, évidemment, le Département d’Etat, qui est l’équivalent d’un ministère des Affaires étrangères africain ; le pouvoir législatif, incarné par le Congrès ; et, enfin, une société civile très diversifiée. Compte tenu des principes érigés par le système constitutionnel américain, chacun de ces acteurs, en particulier la Présidence et le Congrès, se voient attribuer des pouvoirs précis et une capacité d’influer sur l’élaboration de la politique étrangère du pays. Le Département d’Etat gère de manière opérationnelle cette politique étrangère ; de conséquence, donc, les relations entre les Etats-Unis et l’Afrique. Ses activités sont coordonnées par la Maison Blanche qui agit pour le compte du Président. Il y a ensuite le Congrès, l’organe législatif du pouvoir fédéral américain qui, sur la base du premier article de la Constitution, se considère sur le même pied d’égalité que le pouvoir exécutif. En fonction des intérêts des membres qui composent les différentes commissions législatives du Congrès, ce dernier peut peser énormément sur les politiques américaines en Afrique. Aux Etats-Unis, le Congrès détient les clés du budget fédéral : il peut demander, à l’exécutif, d’arrêter certaines initiatives ou, au contraire, lui mettre à disposition des ressources additionnelles, pour en favoriser d’autres. Enfin, il ne faut pas oublier les organisations de la société civile, les instituts de recherche et autres think-tank qui influencent, de manière indirecte, la politique américaine, à travers leurs actions sur le terrain, le lobbying ou la publication d’articles. Tant le pouvoir exécutif que le législatif entretiennent des échanges permanents avec ces acteurs.
Bref, derrière les déclarations officielles du Département d’Etat, les choix stratégiques effectués, à Washington, sont le résultat de relations complexes, entre une multiplicité d’acteurs et de centre d’intérêts divergents. A l’heure où nous parlons, je pense qu’il y a une volonté de Barack Obama de marquer son passage à la Maison Blanche dans les rapports entre les Etats-Unis et l’Afrique. Bien sûr, compte tenu de ses origines et de ses déclarations de politique générale, il aimerait léguer quelque chose au continent africain. On se souvient du discours qu’il a prononcé, en 2009, à Accra, lors de son premier mandat, et la tournée effectuée en 2013, sur le continent africain. De même, le premier Sommet US-Afrique a été un grand succès. Il s’y est engagé à continuer de soutenir l’Afrique, dans plusieurs domaines, notamment l’économie, les droits de l’homme et la bonne gouvernance.
- Mais la politique africaine d’Obama n’a pas répondu, après son élection et son discours à Accra, aux attentes des peuples africains. Pourquoi ?
- Je comprends leur déception et le fait qu’Obama n’ait pas été à la hauteur de leurs attentes ; en tout cas, lors de son premier mandat [2009-2013, ndlr]. Ces attentes ont été, par ailleurs, exprimé bien avant Accra. Lors de son élection en 2008, l’effervescence fut énorme, et pas uniquement en Afrique. Je me souviens qu’à l’époque les gens se disaient : « Pour la première fois de leur histoire, les Etats-Unis d’Amérique ont, non seulement, élu un président noir-américain, mais, surtout, un président dont le père est africain ». Il y avait un attachement presque sentimental à Obama, à un tel point que sa politique africaine semblait dès le départ compromise. Et les espoirs étaient d’autant plus grands que ses prédécesseurs, notamment Bill Clinton et Georges W. Bush, avaient beaucoup œuvré pour le continent.
- Quelles sont les ruptures et les continuités par rapport aux prédécesseurs ?
Bill Clinton avait déjà lancé certaines initiatives que Bush et, ensuite, Obama ont adoptées ou poursuivies. C’est le cas de la convention de libre-échange AGOA (African Growth and Opportunity Act) entre les Etats-Unis et l’Afrique, adoptée par Bush, lors de son arrivée au pouvoir, et poursuivie par Obama qui œuvre pour qu’elle soit renouvelée en 2015. Il y a également continuité dans le cadre de l’aide au secteur de la santé, à travers le projet PEPFAR (President's Emergency Plan for AIDS Relief), une initiative lancée par George Bush pour renforcer les capacités de lutte contre le Sida et que Barack Obama a décidé de maintenir. Par contre, je vois une rupture dans l’approche de ces trois présidents américains envers le continent africain. Clinton avait un lien très affectif avec l’Afrique, on constatait, d’ailleurs, une certaine complicité avec les chefs d’Etat africains. Bush a, lui aussi, beaucoup œuvré pour le continent et je pense qu’il a vraiment mis le paquet, notamment sur le Sida, les réformes du secteur de la sécurité et le renforcement des forces africaines, dans les missions de maintien de la paix. Avec Barack Obama, il y a une narration et des affinités presque naturelles mais on constate aussi une rupture, dans la mobilisation des ressources publiques américaines, avec une baisse d’attention dans l’assistance directe au continent africain.
- L’image de l’Afrique a bien changé au cours de ces dix dernières années. Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui louent la renaissance économique du continent africain et les opportunités qu’il offre aux investisseurs étrangers. Est-ce que la perception de l’Afrique a réellement changé aux Etats-Unis ?
- Cela fait désormais un certain temps que le monde entier évoque les énormes opportunités économiques qu’offre l’Afrique, ses potentialités et l’importance d’y nouer des partenariats. Cela a évidemment eu un impact aux Etats-Unis et je crois que le Sommet US-Afrique fut un point culminant de ce processus de transformation du regard que les Américains, notamment la classe politique et les hommes d’affaires, portent sur le continent. Un vent d’optimisme était vraiment en train de souffler aux Etats-Unis. Malheureusement, Ebola a freiné cet enthousiasme. Avec cette épidémie, nous sommes retombés dans un cycle d’images négatives. Vue de loin, certains sont convaincus que c’est toute l’Afrique qui est contaminée par le virus, avec toutes les conséquences que cela implique. C’est encore le même continent qui demande de l’assistance et qui n’a pas les infrastructures sanitaires nécessaires pour combattre certaines épidémies. Malheureusement, il nous faudra du temps pour retrouver l’effervescence qui animait les Américains au début de l’année.
- Concrètement, quel est l’impact d’Ebola, auprès de l’opinion publique, du Congrès et du secteur privé américains ?
- Les trois fronts sont touchés. Dans les anciennes démocraties, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, l’opinion publique a une forte influence dans les décisions politiques. Un membre du Congrès est obligé de prêter attention aux appels et aux intérêts de ses électeurs, surtout lorsque l’opinion publique manifeste une certaine appréhension par rapport à un phénomène négatif qui apparait dans un pays africain ou dans une autre région du monde. L’impact est tout aussi néfaste dans le secteur privé. Lors du Sommet US-Afrique, beaucoup de conventions avaient été signées, ainsi que des mémorandums d’entente avec des hommes d’affaires qui envisageaient d’envoyer des représentants d’entreprises pour des missions de prospection dans certains pays d’Afrique de l’Ouest.
On sait que la Guinée est en train de développer son secteur minier, qui a un très grand potentiel et qui a été fortement promu, lors du Sommet. Cependant, puisque les voyages vers ces pays sont désormais limités, ces missions seront beaucoup moins ambitieuses.
Les économies des pays affectés, notamment celles de la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée vont en prendre un coup, parce que les échanges, avec les Etats-Unis, ne sont plus ce qu’ils étaient il y a encore quelques mois. Sur le plan interne, le pouvoir d’achat et la productivité sont à la baisse et les conséquences de cette épidémie vont se faire malheureusement ressentir à moyen et à long terme.
- Les relations avec les Etats-Unis sont-elles uniquement touchées dans les pays affectés ou également dans d’autres régions ?
On espère qu’il n’y ait aucun impact sur les relations entre les investisseurs américains et d’autres pays africains. Malheureusement, il faut se rendre à l’évidence. Le public est souvent mal informé et les Américains ont tendance à oublier que l’Afrique n’est pas un grand pays mais un continent, composé de cinquante-quatre Etats indépendants. Il y a également une certaine psychose vis-à-vis de l’épidémie. La plupart des gens ne connaissent pas les mécanismes du virus ou les mesures à prendre, pour réduire les risques de contamination, ce qui les pousse à éviter la totalité du continent, au lieu de se limiter aux pays affectés.
- Concernant le sommet USA-Afrique d’août dernier, certains experts ou représentants de la société civile retiennent que les intérêts économiques et sécuritaires des Etats-Unis ont pris le dessus sur des défis cruciaux, comme la démocratie, la bonne gouvernance ou le respect des droits de l’homme. Partagez-vous ce sentiment ?
- Effectivement, je m’attendais à ce que la démocratisation et la bonne gouvernance soient à l’ordre du jour. Cependant il faut reconnaître que ces sujets ont tout de même été débattus. L’administration Obama avait défini, au préalable, trois grands thèmes de discussion : relations commerciales et investissements, paix et sécurité, et gouvernance. C’est au sein de ce dernier thème qu’eurent lieu des échanges sur la jeunesse, l’engagement civil, les droits de l’homme et la bonne gouvernance. Par rapport à il y a vingt ou trente ans, ce ne sont plus des sujets tabous, réservés aux non-africains. Aujourd’hui, on trouve des pays et des chefs d’Etat qui ont fait énormément de progrès et qui ouvrent ce débat à l’intérieur même du continent.
- Quels sont les chefs d’Etat ou les pays qui sont considérés comme des modèles par l’administration américaine ?
- Plusieurs pays africains ont accompli énormément de progrès, au cours des deux dernières décennies. Je pense, par exemple, au Sénégal, au Botswana et à la Zambie, qui réalisent une alternance politique normale, ou au Ghana qui n’a pas subi de revendications violentes, malgré des élections très serrées en 2012. Même le Kenya, qui a pourtant connu une situation très difficile en 2007, s’est ressaisi, avec des résultats acceptés par la majorité des Kenyans et de la classe politique, lors des élections de 2013. Il reste évidemment des chefs d’Etat réticents qui essayent d’éterniser leur pouvoir mais je constate, tout de même, une amélioration dans l’approche de la démocratie et la bonne gouvernance.
- L’Indice Ibrahim de la gouvernance africaine (IIAG) 2014, publié le 29 septembre dernier, montre que « le niveau global de la gouvernance sur le continent africain a progressé entre 2009 et 2013 ». Malgré cela, les résultats soulignent aussi des tendances préoccupantes, notamment au niveau de la catégorie Développement économique durable, dont la tendance à la baisse est due notamment à un recul inquiétant des sous-catégories Gestion publique et environnement des entreprises, ainsi que Sécurité et Etat de droit. Au-delà de la crise Ebola, malgré les belles annonces du président Obama, au Sommet de Washington, et sa volonté de rattraper le retard accumulé, par les Etats-Unis, dans leurs échanges commerciaux avec les pays africains, ne pensez-vous pas que ces mauvais résultats constitueront un frein, pour les investisseurs américains en Afrique ?
- Les crises réduisent presque toujours les échanges entre le pays affecté et le reste du Monde, nuisant aux possibilités d’investissement et à l’établissement de partenariats commerciaux avec le secteur privé. C’est la situation où se trouvent, malheureusement, plusieurs Etats africains aujourd’hui. Aucun investisseur ne s’hasarde au Sud-Soudan, par exemple, un pays qui avait pourtant bien démarré et suscité beaucoup d’espoir. De même pour la République Centrafricaine, qui a énormément de potentiel mais où les investisseurs ont été refroidis par une succession de crises politiques et de conflits armés. En règle générale, l’instabilité politique freine l’intérêt et l’engagement économique des Américains. Cela dit, il reste des pays qui ne tiennent aucun compte de ces considérations et s’engagent en Afrique publiquement ou à travers des investisseurs privés, indépendamment du contexte.
- Dans ce contexte, les Etats-Unis et l’Europe semblent les acteurs les plus sensibles à la bonne gouvernance. L’Union africaine semble, quant à elle, marquer le pas, même si, de l’avis de certains experts, les raisons en sont évidentes : certains chefs d’Etat violent les droits de l’Homme ou ne respectent pas la bonne gouvernance. Mais l’Union africaine n’a-t-elle pas un rôle à jouer là-dedans ? Vous paraît-elle avoir acquis un certain pouvoir ou les attentes sont-elles déçues ?
- Je pense qu’il est trop tôt pour dire si les attentes ont été déçues ou non. Nombreux sont ceux qui ont applaudi la transformation de l’Organisation de l'unité africaine (OUA) en Union africaine (UA). Ce changement semblait marquer la fin d’un ‘’syndicat de chefs d’Etat’’, pour privilégier les intérêts des citoyens africains. Cette tendance s’est confirmée en 2007, lorsque l’UA a adopté la « Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance », auxquels s’ajoutent des mesures de paix et de bonne gouvernance promus à travers le NEPAD (New Partnership for Africa's Development). Cependant, ces dispositions modernes et globalement acceptées ne sont pas appliquées rigoureusement. Il serait temps que l’Union africaine se reprenne en main et fasse entendre sa voix dans les crises sécuritaires, politiques et économiques qui touchent le continent.
- L’implication, de plus en plus appuyée, des USA en Afrique, notamment dans la bande saharo-sahélienne, fait face à l’avancée de la Chine sur le continent. Comment l’Afrique peut-elle construire son unité, dans ce duel de titans ? Le dernier Sommet Afrique-USA vous paraît-il avoir fourni de réelles réponses en ce sens ?
- Je ne crois pas que ce Sommet ait eu pour objectif de contrecarrer la percée de la Chine sur le continent africain. Il faut reconnaître que cette percée est réelle et qu’on voit les Chinois intervenir, en de nombreux secteurs, dans beaucoup de pays africains et sans poser de conditionnalité, que ce soit dans le contexte des droits de l’homme ou de la gouvernance. De plus en plus de personnalités africaines, issues du monde politique ou de la société civile, sont critiques des relations entre leurs pays et la Chine. Des critiques s’élèvent même au sein du secteur privé africain, qui ne bénéficie que rarement des relations sino-africaines car la Chine vient uniquement pour exploiter des ressources, par contrats dont les clauses, signées dans l’opacité la plus totale, ne sont pas connues. Ce genre de pratiques ne permet pas au continent et à ses populations de se développer durablement.
- Mais il n’y pas que des critiques. Les Africains aiment à rappeler que les Chinois construisent des routes, des ponts, qu’ils ils mettent en place des infrastructures, un secteur longtemps déserté par les Occidentaux…
- La Chine a, en effet, beaucoup investi dans les infrastructures ; surtout dans les pays où il y en a très peu. On ne peut pas en vouloir aux gens d’apprécier un nouveau stade de football, une nouvelle route ou un chemin de fer. C’est tout à fait normal que les investisseurs qui contribuent au développement économique d’un pays soient appréciés. Mais, après les premières euphories, les gens ont commencé à se poser des questions sur la possibilité d’un renforcement des capacités des Africains. On voit, encore aujourd’hui, des sociétés chinoises publiques et privées débarquer sur le continent avec des projets clés en main et des employés chinois à tous les niveaux, alors qu’en la quasi-totalité des pays africains, le chômage reste très élevé, en particulier chez les jeunes, pas assez souvent embauchés, et, lorsqu’ils le sont, les emplois sont extrêmement précaires. D’autre part, les partenariats, entre le secteur privé africain et les sociétés chinoises, sont quasi inexistants. S’il y a un travail d’entretien à effectuer sur un grand projet d’infrastructures réalisé par les Chinois, ces derniers feront toujours appel à leurs compatriotes. Par ailleurs, les transactions sino-africaines, en contrepartie des investissements, favorisent l’exploitation des ressources naturelles du continent, sans que les populations ou leurs représentants, au niveau de l’Assemblée nationale ou du Parlement, puissent avoir la possibilité de contrôler la régularité des clauses d’échanges ou la transparence.
- Vous avez parlez d’un changement de perspectives du côté africain. Mais qu’en est-il du côté chinois ?
- L’approche de la Chine aujourd’hui s’est quand même améliorée par rapport à il y a dix ou vingt ans. Prenons l’exemple du Sud-Soudan. La Chine ne voulait pas se mêler aux négociations pour l’indépendance entre le SPLA et le régime de Khartoum. Elle s’est seulement impliquée lorsque les autres pays partenaires au développement ont fait pression sur Pékin. Autre exemple de rupture avec sa politique de non-ingérence, la Chine contribue, désormais, aux missions de maintien de la paix en Ethiopie et au Liberia. Mais les ruptures ne relèvent pas uniquement d’un changement de stratégie opéré à Pékin.
Au Tchad, où la Chine investit dans le secteur pétrolier, un gouvernement africain a, pour la première fois, dit à la Chine de s’en aller avec ses entreprises et investisseurs. Petit à petit, la Chine va se rendre à l’évidence qu’elle ne pourra pas toujours agir dans l’opacité car le climat qui règne en Afrique, dans le milieu des investissements, est en train d’évoluer dans le bon sens.
- Est-ce le résultat de pressions effectuées par les Africains ou bien par les investisseurs occidentaux qui demandent, à leurs diplomaties, de les aider à contrecarrer les Chinois ? L’Union Européenne essaie, par exemple, de pousser le secteur privé européen à investir sur le continent africain mais les entreprises européennes se plaignent de devoir respecter des règles qui ne sont pas imposées aux Chinois ou à d’autres acteurs comme les Indiens ou les Brésiliens. Quel est votre avis ?
- Je n’ai pas constaté un lobbying spécifique de la part des investisseurs américains, auprès des membres du Congrès, pour faire pression sur les investisseurs chinois. Mais je sais que, sur certaines questions africaines, le département d’Etat américain a régulièrement des échanges avec leurs homologues chinois. Je ne serais pas surpris que les Américains y partagent, avec les Chinois, le fond de leur pensée sur l’approche de Pékin en Afrique. Depuis les années 1970, une loi contre la corruption a été adoptée, le Foreign Corrupt Practices Act, qui interdit les pourboires et la corruption de la part des sociétés américaines à l’étranger. Cette loi est passée au moment où les entrepreneurs et investisseurs étrangers avaient cette tendance à insérer des pourboires dans les profits et les bilans de leurs entreprises. Mais cela n’a pas empêché les entrepreneurs américains de respecter leur propre législation, même si cela les mettait dans des situations désavantageuses par rapport à leurs concurrents.
- Dans la plupart des pays africains, et notamment dans la bande saharo-sahélienne, les capacités d’intervention de l’Etat, dans les actions de développement, se situent dans l’ordre du kilomètre carré quand la vie sociale, citoyenne ne dépasse guère l’hectare. Dans ce sens, pensez-vous que ce décalage peut être une opportunité, pour générer un développement conséquent de la démocratie directe, pour peu qu’il soit soutenu ? Est-ce que le NDI développe des initiatives pour le renforcement de la démocratie au niveau local ?
- Dans sa théorie sur la démocratie, le philosophe politique Alexis de Tocqueville avait beaucoup misé sur la démocratie locale qui, selon lui, permet aux citoyens de mieux s’organiser et de mieux gérer la vie au quotidien. Il faut reconnaître que c’est une des choses qui a fait défaut au continent africain après les indépendances. Beaucoup de pays africains francophones ont adopté un modèle de présidentialisme à la française, basé sur la Constitution de 1958 qui donnait quasiment les pleins pouvoirs l’exécutif et, sur le plan géographique, à Paris. Par conséquent, dans beaucoup de pays les pouvoirs économique, politique, financier et culturel se trouvent dans la capitale alors qu’en zone rurale, il n’y a aucune d’institution qui permette une gestion décentralisée des institutions ou des ressources. Au fil du temps, nous nous sommes rendu compte que cela avait des effets néfastes. Les populations ont fini par ne pas s’identifier au pouvoir central. Cela explique, par exemple, qu’en République Démocratique du Congo, les populations situées à l’est du pays se sentent plus connectées avec leurs voisins des pays limitrophes qu’avec Kinshasa, située à des milliers de kilomètre. A l’heure actuelle, beaucoup de pays africains entament une réflexion sur la décentralisation et l’importance de céder une partie du pouvoir et des ressources au niveau local. Le Niger et le Mali sont en train de mettre en œuvre cette décentralisation ; je ne serais pas surpris si la Mauritanie prenait le même élan. C’est une façon de gérer à la base certaines crises, avant qu’elles ne deviennent nationales.
- Un peu avant le sommet, Barack Obama a confirmé son engagement envers la jeunesse africaine. Qu’attend exactement le président américain de tous ces jeunes qu’il a invités à découvrir les Etats-Unis ?
- Tout le monde se rend à l’évidence que l’Afrique est un continent jeune. Il y a des pays où les jeunes constituent entre 50 et 60 % de la population. Le président Obama a lancé une initiative – « Jeunes leaders africains » – pour les motiver à s’impliquer davantage dans l’évolution politique et économique de leurs pays, mais, aussi, pour envoyer un message fort au continent, lui signifier que c’est maintenant qu’il faut investir dans cette jeunesse africaine, parce qu’elle va constituer les leaders de demain. Le message est en train de passer : avant même de recevoir les chefs d’Etats africains, lors de son arrivée au pouvoir en 2008, le président américain avait invité cent jeunes leaders africains à la Maison Blanche. Aujourd’hui, le programme compte plus de cinq cents bénéficiaires. Lors du sommet, Obama a annoncé vouloir soutenir plus de mille jeunes leaders en 2015 et fonder des centres de soutien en différentes régions du continent. L’engagement de l’administration Obama, pour encourager et soutenir la jeunesse africaine, est donc réel. Il serait important que cette initiative soit pérennisée après le départ d’Obama. Cela va permettre, aux jeunes africains, de mieux se connaître, s’entraider et à nouer des relations transfrontalières. De plus, ils pourront entrer en réseau avec les leaders économiques et politiques du monde entier.
- Il existe aussi des présidents africains qui misent sur les nouvelles générations américaines. Le président rwandais, Paul Kagame, se rend très souvent aux Etats-Unis où il multiplie les visites dans les universités américaines. Est-ce un cas isolé ?
- Le cas Kagamé n’est pas isolé : avec le renouvèlement de la classe politique en Afrique de l’Ouest, on voit de plus en plus de chefs d’Etat jeunes qui se sentent à l’aise dans les universités et qui, lors de leurs passages aux Etats-Unis, se permettent d’aller dans les grandes écoles, afin d’échanger avec la jeunesse américaine. Je crois c’est un phénomène qui nous honore et qui souligne, aussi, la globalisation des opportunités qui existent pour ceux qui veulent faire prospérer l’image de leurs pays. En adoptant cette approche, Kagamé a beaucoup œuvré pour le Rwanda. C’est la raison pour laquelle, après les évènements malheureux de 1994, le Rwanda est en train de rebondir et on le cite, souvent, comme un pays qui a réalisé des réels progrès ces dernières années.
- Quel regard portez-vous sur les relations entre Washington et Kigali ?
- Le soutien des Etats-Unis reste assez élevé. Il y a une appréciation des progrès qui ont été réalisés par ce pays et des actes qui continuent à être posés, afin de favoriser un climat des affaires plus propice. Je pense, notamment, à la facilitation des visas, les relations commerciales entre le Rwanda et les autres pays de la communauté des Etats de l’Afrique de l’Est, le développement des infrastructures, etc. Globalement, ces actions suscitent l’admiration de l’administration américaine mais, en même temps, les gens commencent à se poser des questions sur la pérennisation de la paix et de la prospérité, après l’ère Kagamé. En effet, plus on s’approche de la fin de son deuxième mandat, plus les Américains se demandent si le président rwandais respectera la Constitution de son pays. Les évènements du Burkina Faso n’ont fait que renforcer l’intérêt américain sur les prochaines élections rwandaises.
- Parlons du NDI. Consacré au développement de la démocratie dans le monde, il est proche du parti démocrate américain. Dans quelle mesure cette affiliation influe-t-elle sur les orientations et les analyses stratégiques de votre organisation sur l’Afrique ?
- Cette affiliation au Parti Démocrate des Etats-Unis est réelle. La présidente de notre conseil d'administration est Madeleine Albright, l’ancienne secrétaire d’Etat américain sous la présidence de Bill Clinton. Mais, au-delà de cette affiliation politique, la législation américaine nous interdit de nous immiscer dans la politique intérieure des Etats-Unis. Le NDI n’est donc pas impliqué dans le débat entre les démocrates et les républicains. La loi nous impose, aussi, la neutralité, dans la mise en œuvre de nos activités qui sont, donc, non partisanes : on ne choisit pas nos partenaires en fonction de leur affiliation politique. Qu’ils soient de droite ou de gauche, nous travaillons avec l’ensemble des partis politiques et des organisations de la société civile.
- Quelles sont les activités et les grandes orientations stratégiques du NDI en Afrique ?
- Nous menons des activités dans tous les secteurs relatifs à la démocratie et à la bonne gouvernance L’accent est mis sur le renforcement des capacités de nos partenaires, qu’ils soient des partis politiques, des organisations de la société civile, ou même des institutions représentatives, comme les assemblée nationales ou les parlements. Le NDI a des bureaux dans 65 à 70 pays à travers le monde entier. Au fur et à mesure que les systèmes politiques des pays africains évoluent, les nouveaux acteurs qui arrivent sur la scène politique et civile d’un pays peuvent bénéficier d’un appui dans la formation, l’échange d’informations, la mise à disposition de publications étrangères pour leur permettre d’intégrer tous ces éléments dans la mise en place de leurs propres institutions. La stratégie globale du NDI est vouée à transmettre cet appui aux correspondants locaux de notre institut, de façon viable. Dans l’observation des élections, un domaine dans lequel le NDI intervient beaucoup, nous collaborons étroitement avec les organisations de la société civile qui se mobilisent, à chaque élection, pour déployer des observateurs sur le terrain. Le but est de transférer nos connaissances et notre méthodologie, afin que ces pays puissent organiser leurs élections, sans recourir aux observateurs internationaux. Les investissements effectués en Afrique portent aujourd’hui leur fruit car de nombreuses organisations effectuent désormais un travail de très haut niveau.
- Entretenez-vous des actions ciblées en direction des media africains ?
- Il y a d’autres structures comme Freedom House qui sont spécialisées dans le renforcement des media. Mais nous essayons de nous adapter et d’intégrer les media dans la mise en œuvre de nos programmes car leur impact sur les pays en voie de développement est important, notamment avec l’arrivée des media sociaux qui constituent une nouvelle méthodologie de communication. En matière d’observations des élections, quand j’ai débuté au NDI, il y a de cela vingt ans, l’observation électorale était une machine très lente. Il fallait envoyer des observateurs sur le terrain, avec des fiches à remplir à la main et attendre un ou deux jours, pour collecter les données, puis les exploiter, avant de faire notre rapport. Aujourd’hui, l’observation se fait avec les téléphones mobiles, des messages textos qui sont captés par les ordinateurs, et vous êtes en mesure de faire des rapports dans les heures qui suivent la fermeture des bureaux de vote. La révolution technologique nous pousse à réélaborer notre travail.
- Le terrorisme est désormais une préoccupation majeure sur le continent africain. Concrètement, comment les Etats-Unis entendent-ils aider ou aident-ils des pays comme le Nigéria et aussi le Cameroun, touchés par Boko Haram ? Peut-on espérer des actions décisives, avant que celui-ci ne déclare un khalifat et un Etat, repaire pour les extrémistes ?
- Jusqu’en 2009, tout le monde pensait que Boko Haram était un problème interne au Nigeria. Etant donné que le ce pays a beaucoup contribué aux missions de maintien de la paix au Liberia, en Sierra Léone et au Soudan,, nous étions persuadés que le gouvernement nigérian allait être capable de gérer ce problème avant qu’il ne devienne une crise sous-régionale ou internationale. Malheureusement, le phénomène Boko Haram a pris de l’ampleur, non seulement, dans la partie nord-est du Nigeria, mais aussi dans les pays limitrophes, notamment le Cameroun, les pays du bassin du lac Tchad et jusqu’au Niger. Aujourd’hui, ses leaders ne cachent pas leur volonté d’étendre leur mouvement terroriste en République Centrafricaine et de s’aligner avec d’autres mouvements djihadistes dans le monde. Si Boko Haram réussit s’allier avec les Shabaab de la Corne de l’Afrique, c’est tout le continent qui sera déstabilisé. Cette sonnette d’alarme a poussé à une prise de conscience sur le phénomène qui doit, dès lors, être géré de façon beaucoup plus volontariste. La lutte contre Boko Haram ne peut pas être léguée uniquement au gouvernement Nigérian, qui a, par ailleurs, fait malheureusement preuve d’une certaine faiblesse et inefficacité, dans la gestion de la crise. Certains pays, comme le Cameroun, en ont subi les conséquences et on souhaiterait que cette région du bassin du lac Tchad puisse retrouver une certaine accalmie, afin que ses populations ne soient plus exposées au terrorisme, à moyen et long terme, et que les activités économiques ne soient plus menacées.
- Au Cameroun, il n’y a pas que Boko Haram qui agite les esprits. Le pays doit également faire face à la succession de Paul Biya, et certains experts redoutent un scenario semblable à celui de la Côte d’Ivoire, suite à la mort de Houphouët Boigny. Y-a-t-il péril en la demeure ?
- Nous avons tous suivi ce qui s’est passé en Côte d’Ivoire. Malheureusement, lorsqu’un leader politique reste trop longtemps au pouvoir, que le pouvoir politique devient aussi personnalisé, qu’il n’y a pas d’institutions en mesure de gérer la passation de service, tous les scénarios sont possibles, y compris les pires. Au Cameroun, nous avons un chef d’Etat âgé de 81 ans, au pouvoir depuis 32. Si ce pays est démocratique comme nous aimons le dire, la succession et l’alternance ne devraient faire l’objet de débats et de discussions. On ne peut pas étouffer ce processus, au risque de le voir éclater au grand jour et sous d’autres formes. Nous serons confrontés à la réalité, qui fait que nous sommes tous des êtres humains, et qu’il faut donc penser au lendemain, sans les acteurs actuels. Pour moi, c’est une démarche tout à fait normale. Étant donné que les prochaines élections sont prévues pour 2018, nous avons encore le temps pour voir plus clair sur les intentons du président actuel. Cela nous donne la possibilité de renouveler la classe politique et je crois que, si cette possibilité est mise à profit, le Cameroun n’aura pas besoin de connaître ce qu’a vécu la Côte d’Ivoire, après le départ de Houphouët. Il en sera autrement, si d’autres acteurs préféraient continuer l’œuvre de la classe politique actuelle, de préserver cette gestion si particulière de l’Etat. Au niveau démographique, il y a moins de 3 % de la population camerounaise âgée de 75 ans et plus, tandis que celle de moins de 45 ans représente plus de 85 %. Ces chiffres devraient nous faire réfléchir. Ils signifient qu’avec une telle structure démographique, le pays ne peut pas continuer à être dirigé par des personnalités qui ont plus de 80 ans. Mais je reste confiant. A l’heure où nous parlons, je ne crois pas que le Cameroun connaîtra un avenir turbulent.
- Les prochaines élections soient prévues pour 2018. Est-ce une chance, pour le Cameroun, d’effectuer cette transition en douceur ?
- C’est une chance, surtout que le débat se tient sur la place publique. Il faut continuer de la sorte, car cela va permettre aux gens de s’exprimer et, au moment venu, la question sera résolue sans émotion. Très souvent, c’est lorsque le sujet ne fait pas l’objet de débat qu’on arrive à une situation critique ; subitement, les gens abordent la question avec beaucoup d’émotions. Je crois que si les Camerounais continuent à discuter et à se confronter publiquement, durant les quatre prochaines années, un consensus national pourra se développer et au moment venu, tout se déroulera de façon paisible et sans heurts. C’est ce que je souhaite au Cameroun.
- Dans un dossier spécial consacré au Cameroun, le magazine panafricain Notre Afrique vous cite parmi les jokers de l’opposition. Comment vous vous placez sur l’échiquier de ce pays ? Quelles sont vos ambitions ?
- Je suis très flatté par la couverture du magazine Notre Afrique. Je crois que les Camerounais sont pour la plupart très fiers de ce que je fais pour le développement de notre continent. Je le ressens lorsque je reçois des appels, des emails et lorsque je visite le pays, les gens me disent qu’il faut que je continue à œuvrer pour l’Afrique. Vous savez, les Camerounais sont panafricanistes et j’ai un devoir civique dans ce sens. J’ai eu la chance d’évoluer d’abord au Cameroun puis aux Etats-Unis. J’ai pu acquérir une certaine expertise sur les questions de bonne gouvernance. Mes compatriotes s’attendent donc à ce que je puisse mettre mes connaissances et mes relations au service de notre pays.
De Joshua Massarenti et Sofia Christiensen (Afronline.org), en collaboration avec Aminata Traoré (Les Echos du Mali) et Sophie Blais (Afronline.org)
Interview réalisée par Afronline.org, Sud FM (Sénégal), Le Calame (Mauritanie), Les Echos/Réseau Jamana (Mali), L’Enquêteur/Radio Anfani (Niger), Radio Horizon FM (Burkina Faso), L’Autre quotidien (Benin), Mutations (Cameroun) et Addis Fortune (Ethiopie)




.gif)
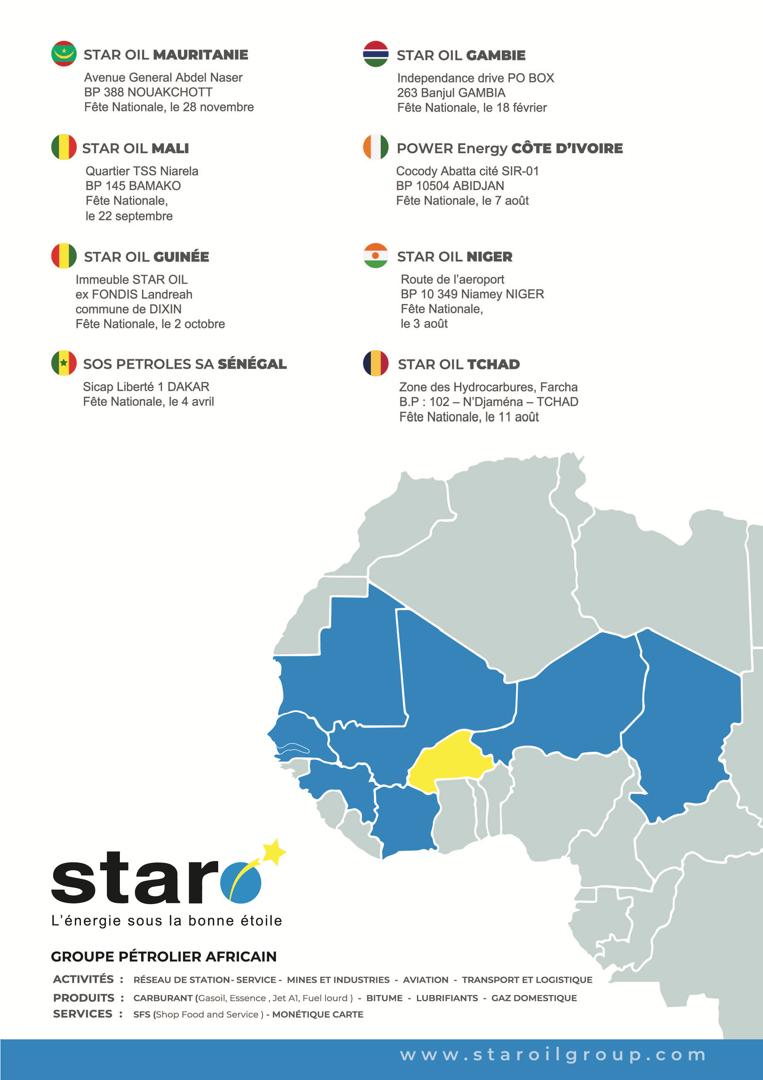







.gif)