Par Ian Mansour de Grange – consultant, chercheur associé au LERHI – faculté de Nouakchott
Dans la complexité des paramètres influant sur le développement d’une nation, on a de grandes difficultés à concilier considérations globales et locales, court terme et long termes, rigueur administrative et adaptabilité au changement, cohérence et fluidité des échanges. Sans être une panacée universelle, l’approche-filière du développement constitue une alternative à des démarches thématiques trop souvent cloisonnées, sinon trop générales. Encore faut-il prendre la peine d’en bien cerner le genre et ses limites. Essayons, en ce premier article d’une nouvelle série, d’en esquisser les concepts-clés.
La notion de filière prend naissance dans une perception globale du cycle production-consommation. On tend à y considérer tout produit commercial comme un être existentiel soumis à des conditions spécifiques d’émergence, d’élaboration, de logistique, d’usage et de recyclage, impliquant des stratégies et des bilans interactifs, sur différents plans variablement concordants : énergétique, écologique, social, économique, etc. Rapidement, la question de la concordance envahit le champ de l’analyse et la gestion des priorités se pose, avec insistance. Qui décide, oriente, harmonise, et selon quels critères ?
Le label AOC
La question est étroitement liée au niveau de complexité concerné. Si l’on parle de la filière mondiale du poulet, par exemple, on est, bien évidemment, à un tout autre degré de concertations qu’en la région de Bresse (France), célèbre pour son label A.O.C. de production aviaire. Mais, dans l’un et l’autre cas, c’est, banalement, la compétition des intérêts partisans qui détermine les règles du jeu. Dans la mesure où celle-là assure, à tous les plans existentiels du produit en question, une représentativité conséquente dans les orientations de la filière, on distingue, de mieux en mieux, les possibilités d’une durabilité accrue de celle-ci, profitable, en fin de compte, à toutes les parties. Dès lors, la notion de partenariat tend à supérer à celle de compétition. On entre dans les perspectives de l’autonomie solidaire.
Mais de qui et de quoi parle-t-on, avec ces beaux mots ronflants ? Les intérêts convergents des multinationales, plus généralement des entreprises hégémoniques, référencés sur des paramètres irrémédiablement réducteurs – on le voit, journellement et de plus en plus dramatiquement, dans le secteur, gigantesque, des industries pétrolières et dérivées – divergent, banalement, de ceux de la planète Terre, de sa biosphère, de ses habitants, imposant aux Etats, aux peuples et à leur environnement, des contraintes dont le terme de rentabilité se raccourcit, d’année en année. A l’évidence, il manque une régulation, humainement réfléchie, des balances compétition/solidarité, connectivité/autonomie, incluant tous les niveaux existentiels des phénomènes, naturels ou non, convoqués par nos activités laborieuses. Se dispenser de celle-ci, c’est abandonner, aux processus naturels de régulation vitale – « dérèglements » compensateurs divers : climatiques, électromagnétiques, biologiques, voire sismiques – la tâche de remettre de l’ordre sur notre planète, au prix, probable, d’une grande part, tant qualitative que quantitative, de notre Humanité.
L’alternative, on s’en rend compte, avec une acuité croissante, depuis, à peine, une cinquantaine d’années, sollicite toute une complexité d’actions et de réactions, diverses et concertées, du plus local au plus global – et inversement – mettant en réseaux, emboîtés et interactifs, des organisations de plus en plus précisément adaptées à des conditions d’existence diversifiées et réévaluées ; sinon en permanence, du moins périodiquement ; à l’aune des équilibres fondamentaux du vivant. Cette référence appuyée au vivant est le paramètre véritablement nouveau qui distingue l’approche-filière contemporaine de sa consœur des années cinquante et antérieures, quasiment entièrement fondée, quant à elle, sur une vision mécaniste et quantitative de la richesse et de son accroissement. Cette courte vue considérait, dans la logique de ses assises, la concentration du pouvoir – capital, décision, communication – en des espaces-temps restreints et standardisés, comme condition intrinsèque de l’ordre et du développement. Or, l’effondrement est un corollaire – un avatar, est-on tenté de dire – de la concentration, d’une manière analogue aux rapports entre complexité et entropie : plus on accumule d’énergie ou d’informations au sein d’un même système, plus s’élèvent les potentialités de litiges, l’instabilité augmentant asymptotiquement jusqu’à atteindre un point de rupture décisif.
Le partage, condition du progrès
On comprend mieux, à présent et a contrario, le sens de l’autonomie solidaire. Plus elle se développe aux étages inférieurs de la complexité, plus s’allège les rôles et la lourdeur des étages supérieurs : le développement naît d’une connectivité accrue et diversifiée, d’une fluidification des échanges d’énergie, d’une répartition soigneusement réfléchie des masses et des responsabilités. A la différence des modèles mécanistes, où l’enrichissement des uns signifiaient, fatalement, l’appauvrissement des autres, on perçoit que l’équité – qui n’est, évidemment pas, uniformisation égalitariste – est, objectivement, une nécessité rationnelle du développement durable. Le partage est la condition même du progrès.
Cette conviction nous permet d’envisager, sous une toute autre perspective, les aspects techniques de l’approche-filière. Trois clés d’analyse sont, à chaque niveau, constamment sollicitées : que doit-on produire ? Comment ? Quand et dans quelles limites ? En développant la prospection de ces interrogations sur différents plans – en particulier : écologique, social, technologique et économique – on voit, rapidement, apparaître les zones de convergence, de conflits potentiels et de négociations impératives, indiquant les meilleures pistes de bonne gouvernance de la filière en question. Cette phase, essentielle à la durabilité de cette dernière, implique des coûts, élevés, qui posent la problématique des répartition des efforts entre producteurs et consommateurs, de l’implication des services publics et associatifs, locaux, nationaux, voire internationaux, adaptée à l’impact réel de la filière dans l’environnement, au sens le plus large du terme, tenant compte de la multiplicité de ses plans d’intervention.
L’élévation de la qualité constitue, dès lors, la voie naturelle de la bonne gouvernance d’une filière. Elle en est tout à la fois l’objet, le moteur et le fruit. Aussi donne-t-elle, presque toujours désormais, matière à contrat – on parle souvent de « Charte de qualité » – liant tous les acteurs d’une même chaîne de production à des protocoles garantissant, aux consommateurs, un produit remarquable, rigoureusement tracé dans son périple, contenu dans les plus précises limites possibles, justifiant, objectivement, un coût en rapport des attentions fournies. Originalité du terroir et des matières premières, assurance des approvisionnements, élévation et interconnexion constante des compétences et des innovations, codification des flux de connaissance, ajustement réfléchi de l’offre à la demande, limitation des gâchis, marketing ciblé, l’approche-filière répond d’autant mieux à la problématique contemporaine que tous les secteurs de la vie sociale sont conviés à y participer : le secteur privé, en tous les points de la chaîne, de l’extraction des matières premières au recyclage des déchets ; le secteur associatif, dans la gestion de la coopération et de la cohésion des intérêts privés ; le secteur public, enfin, dans la réglementation des codes et la régulation générale du marché.
Démarche de riches ? L’opinion selon laquelle les pauvres n’auraient pas les moyens de se payer le « luxe de la qualité » est l’argument favori des profiteurs de tout poil, qui misent sur le n’importe quoi, à bas prix, à durée de vie minimale, sans aucune considération de santé publique ni de salubrité environnementale. Celle-là n’abuse que les ignorants. Sitôt que s’élève la conscience des peuples – et la responsabilité de leurs élites est, ici, clairement en cause – ceux-ci entendent vite leur intérêt à acheter mieux en achetant moins. Seraient-ils également convaincus des possibilités qu’offre leur propre environnement, fût-il des plus rudes ou dégradés, à générer des qualités distinctives, à la portée de leur génie spécifique, que la lutte contre la pauvreté triompherait bien vite. La Mauritanie est un désert, dit-on : des trésors y reposent, ni toujours enfouis, ni invariablement morts… (à suivre).



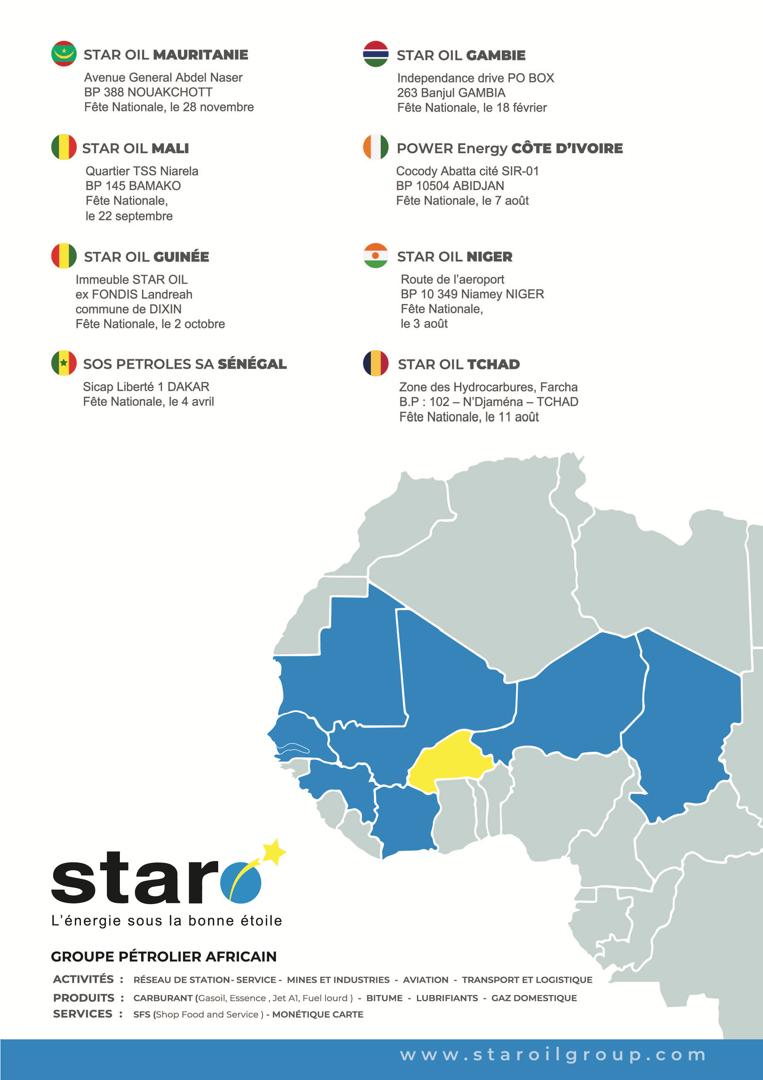








.gif)